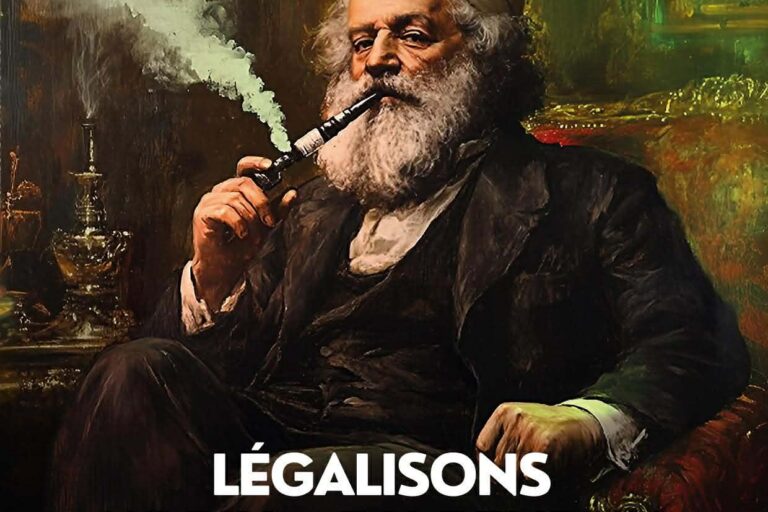Palestine : penser la stratégie, au-delà des évidences militantes
La Palestine n’est pas seulement le nom d’une injustice historique ni celui d’une résistance qui force l’admiration. Elle est aussi, depuis plusieurs décennies, le lieu d’un problème politique non résolu : celui de la stratégie de libération. La persistance de l’occupation, la fragmentation territoriale, la division institutionnelle palestinienne et l’isolement régional ne peuvent être expliqués uniquement par la violence et la puissance de l’ennemi. Ils obligent à interroger la manière dont la lutte elle-même a été pensée, organisée et orientée.
C’est dans ce contexte qu’a été publié récemment, sur le site de Révolution Permanente, un article intitulé « Palestine : quelle stratégie pour la libération ? ». Le texte a le mérite de poser frontalement une question trop souvent évacuée à gauche. Il identifie avec justesse plusieurs impasses réelles : la faillite d’Oslo, la subordination aux régimes arabes, l’épuisement de certaines formes de lutte et la nécessité de rompre avec toute illusion institutionnelle. Mais en prétendant tirer de ces constats une orientation stratégique, l’article tend à substituer à l’analyse concrète des rapports de forces une série d’affirmations de principe : indépendance de classe énoncée abstraitement, appel à une révolution régionale conçue comme horizon général, et disqualification implicite des formes existantes de résistance palestinienne.
Le problème n’est pas ici l’excès de radicalité, mais plutôt l’orientation parfois schématiquement gauchiste du texte : la confusion entre la justesse d’un principe et la construction d’une stratégie ; le refus de penser les médiations, les fronts, les phases et les contradictions internes d’une lutte réelle ; la tentation de se placer en surplomb du mouvement existant plutôt que de travailler en son sein. Une telle posture peut sembler intransigeante ; elle laisse pourtant intacte la question décisive : comment une lutte de libération devient-elle une force capable de vaincre, et pas seulement de durer ou de témoigner ?
Cette difficulté apparaît de manière particulièrement nette dans le traitement des formes populaires de résistance, notamment islamo-nationalistes. Plutôt que d’être analysées comme des faits sociaux et politiques historiquement produits — enracinés dans des transformations de classe, des défaites accumulées et une situation coloniale spécifique — elles tendent à être appréhendées comme des impasses stratégiques en soi. Or, une analyse matérialiste ne commence pas par disqualifier les formes existantes de mobilisation ; elle cherche à comprendre leur fonction, leurs contradictions et les conditions dans lesquelles une lutte pour l’hégémonie peut s’y déployer.
Ce texte ne se propose donc ni de défendre les orientations dominantes du mouvement palestinien, ni de condamner idéologiquement ses formes de résistance. Il part d’un autre point de vue : réintroduire la question stratégique sur des bases matérialistes, en s’appuyant sur les débats du marxisme arabe révolutionnaire, sur l’histoire concrète des mouvements palestiniens et sur les discussions stratégiques qui traversent le monde arabe depuis des décennies.
La thèse défendue est simple : la libération de la Palestine ne viendra ni de la gestion institutionnelle de l’occupation, ni de la célébration abstraite de la résistance, ni de l’affirmation incantatoire de principes justes. Elle suppose une stratégie de longue durée, capable d’articuler lutte nationale et lutte sociale, unité populaire et indépendance politique, résistance armée et organisation des masses, horizon régional et construction patiente de l’hégémonie. C’est à cette condition seulement que l’indépendance de classe cesse d’être un slogan pour devenir une force matérielle.
I. Un diagnostic souvent juste… mais une stratégie qui s’évapore
1) Ce que l’article de Révolution Permanente voit correctement (et qu’il faut conserver)
Commençons par rendre à l’article de Révolution Permanente ce qu’il a de plus utile : il prend au sérieux la question stratégique, au lieu de se contenter d’une indignation morale (même légitime). Et, surtout, il prend appui sur des éléments matériels.
D’abord, son bilan du tournant du Fatah vers la logique du « mini-État » puis d’Oslo est construit autour de la constitution d’intérêts de classes : la direction nationale s’arrime à deux fractions bourgeoises (diaspora capitalisée dans le Golfe, bourgeoisie locale arrimée aux dispositifs coloniaux), et l’« autonomie » devient un dispositif de pacification et d’accumulation sous tutelle israélienne. Le texte insiste sur cette dimension économique et sociale (marché captif, main-d’œuvre, intermédiaires), jusqu’à la transformation de l’Autorité en police supplétive.
Ensuite, l’article a le mérite d’affronter sans euphémisme une vieille question : celle des limites historiques d’une partie de la gauche palestinienne. RP vise en particulier l’usage qu’a fait le FPLP d’une grammaire « tiers-mondiste/maoïsante » et de la « guerre populaire prolongée », en la reliant à une logique de fronts nationaux où le prolétariat sert d’appoint, au lieu de constituer un pôle autonome. Que l’on partage ou non la totalité de cette lecture, elle pointe un problème réel : la difficulté à produire, durablement, une alternative hégémonique à l’intérieur même du mouvement national.
Enfin, l’article insiste sur une leçon dure, mais solide : le cadre régional n’est pas un décor. Les régimes arabes peuvent « soutenir », mais aussi utiliser, monnayer, étouffer — et l’histoire palestinienne est traversée par cette contradiction. Sur ce point, l’article plaide pour que la libération soit pensée dans un horizon régional, et non comme une affaire strictement « palestinienne » décrochée des rapports de forces du Proche-Orient.
Jusqu’ici, on a un ensemble de constats globalement robustes. Le problème commence au moment où l’article veut transformer ce diagnostic en stratégie.
2) Là où ça bascule : quand l’indépendance de classe devient un substitut de stratégie
À lire RP, on a parfois l’impression qu’il suffirait d’identifier correctement les trahisons, les capitulations et les dépendances, puis d’affirmer trois ou quatre principes (indépendance de classe, rupture avec les régimes, horizon régional) pour « tenir » une stratégie. Or c’est précisément le point où, dans une tradition marxiste-léniniste au sens non dogmatique du terme, on parle de gauchisme : non pas parce que les principes seraient faux, mais parce qu’ils sont traités comme s’ils dispensaient du travail le plus difficile — celui des médiations.
Une stratégie n’est pas une liste d’ennemis, ni un vœu pieux. Elle suppose au minimum : une définition de la lutte, une appréciation du rapport de forces, une théorie opératoire (pas un vernis), et un programme politique, militaire et organisationnel. C’est exactement ce que formulait Habash dès 1969, dans un texte de combat : « Porter les armes ne suffit pas », et sans analyse concrète des forces, des alliances, de l’ennemi, il n’y a pas de programme révolutionnaire digne de ce nom.
Or, dans l’article de RP, on trouve bien une formule qui ressemble à une conclusion stratégique — la perspective d’une révolution régionale portée par les masses — mais on cherche longtemps l’architecture qui permettrait d’y parvenir : quelles formes de front ? quelle articulation entre unité nationale et lutte d’hégémonie ? quelles institutions de lutte, quels cadres populaires, quelle doctrine de durée ? Sur ce point, la « révolution régionale » fonctionne trop souvent comme un horizon qui remplace le chemin.
Le problème se voit encore mieux dans le traitement de la question nationale. RP critique à juste titre les effets politiques d’une collaboration de classe au sein du mouvement national. Mais il tend à rabattre la lutte nationale sur la direction bourgeoise qui la capture, comme si la nation n’était qu’un écran idéologique. Or, dans une formation coloniale, la lutte de libération nationale n’est pas un supplément d’âme : elle est la forme historique concrète que prend la lutte des classes elle-même, parce que l’ennemi central n’est pas seulement « une bourgeoisie », mais une structure coloniale qui organise l’exploitation, l’expropriation et la fragmentation. Mahdi Amel l’exprime avec une netteté rare : en situation coloniale, « la révolution socialiste est inséparable de la libération nationale ».
Dit autrement : critiquer les directions bourgeoises est nécessaire, mais ce n’est pas suffisant. La question stratégique n’est pas de « sortir » de la lutte nationale pour atteindre enfin la lutte de classe pure ; elle est de savoir comment construire, à l’intérieur du bloc national-populaire réellement existant, une force capable d’en disputer l’hégémonie.
C’est ici qu’une expérience historique comme celle retracée par Kazziha sur les trajectoires du mouvement nationaliste arabe est utile : les mouvements peuvent souffrir moins de « trop de décentralisation » que de l’abandon de leur indépendance organisationnelle — autrement dit, la question décisive n’est pas d’énoncer la bonne ligne, mais de tenir les formes d’organisation qui permettent de ne pas être absorbé, tout en restant en prise avec les masses.
Enfin, dernière bascule — et elle est politique : RP s’expose à traiter les formes islamo-nationalistes surtout comme un problème à contourner, là où une approche matérialiste devrait d’abord les saisir comme des faits sociaux et politiques produits par l’histoire palestinienne. Sans idéaliser qui que ce soit, les travaux de Dot-Pouillard, Alhaj et Rébillard montrent par exemple que le Jihad islamique palestinien ne se laisse pas réduire à l’imaginaire d’un jihad transnational : il est d’abord un acteur palestinien, radical contre Israël, mais recherchant aussi une certaine unité interne, avec des paradoxes qu’une analyse stratégique doit intégrer plutôt que balayer.
Le point n’est pas de déplacer la critique vers une querelle d’étiquettes. Il est plus simple : une stratégie de libération ne peut pas commencer par excommunier les formes populaires existantes de la résistance ; elle doit comprendre comment elles tiennent, ce qu’elles permettent, ce qu’elles empêchent — et comment y construire un déplacement d’hégémonie.
Si l’on veut sortir de la posture (même « juste ») pour entrer dans la stratégie, il faut donc faire ce que RP réclame sans le faire vraiment : formuler une méthode de guerre politique au sens large — analyse, phases, fronts, instruments, hégémonie.
II. Ce qu’est une stratégie matérialiste — et ce que RP ne construit pas
La difficulté de l’article de Révolution Permanente tient moins à ses prises de position qu’à une absence : il parle de stratégie, mais il ne produit pas les outils qui permettent de passer du diagnostic à une orientation opératoire. Or, dans une lutte de libération, l’écart entre « dire vrai » et « être stratégique » est souvent celui qui sépare une politique qui éclaire d’une politique qui gagne.
1) Stratégie : une grammaire exigeante, pas un horizon
On peut définir minimalement la stratégie comme l’art d’organiser une trajectoire de victoire à partir d’un rapport de forces donné. Cela implique au moins quatre opérations.
a) Nommer la nature de la lutte.
Une lutte n’est pas seulement « juste », elle est déterminée : ici, une situation coloniale (et plus précisément de colonisation de peuplement), où l’adversaire ne cherche pas seulement à dominer, mais à remplacer, fragmenter, expulser, administrer et reconfigurer le territoire. Dire cela n’est pas un slogan : c’est ce qui conditionne toutes les questions suivantes (front, temporalités, institutions de lutte, formes de violence et de masse). RP évoque bien cette réalité, mais sans en tirer une doctrine.
b) Évaluer les forces réelles.
Non pas « le peuple » en général, mais les forces organisées, leurs bases sociales, leurs ressources, leurs dépendances, leurs fractures, leurs relais régionaux et internationaux. Habash insistait déjà sur ce point : une stratégie commence par l’appréciation des forces — les siennes, celles de l’ennemi, celles des alliés et des adversaires indirects — faute de quoi l’action se réduit à la bravoure.
c) Définir des phases et des objectifs intermédiaires.
Une stratégie n’est pas une proclamation (« révolution régionale ») : c’est une séquence de tâches, avec des critères de passage. Or, chez RP, l’horizon régional tend à fonctionner comme solution générale, sans articulation claire à une progression de lutte, à des institutions populaires, ni à des formes de front.
d) Produire des instruments : organisation, programme, doctrine.
Sans programme politique et militaire, sans formes d’organisation capables de tenir dans la durée, la lutte se condamne à l’improvisation. RP, lui, critique — souvent à raison — mais il reste étonnamment avare en doctrine positive.
2) Indépendance de classe : un principe nécessaire, mais insuffisant
Là où l’article de RP s’expose au gauchisme, c’est lorsqu’il traite l’indépendance de classe comme si elle valait stratégie. Le principe est juste : sans autonomie politique, l’énergie populaire est capturée, convertie en monnaie diplomatique ou neutralisée par des appareils. Mais il manque deux choses.
a) L’indépendance ne se décrète pas : elle se construit dans des formes.
Ce qui protège l’autonomie, ce ne sont pas d’abord des déclarations, mais des formes organisationnelles, des ancrages sociaux, des mécanismes de décision, des ressources propres, et une capacité à ne pas être absorbé tout en restant dans le mouvement réel. L’histoire des recompositions autour de Habash et du mouvement national arabe, telle que l’analyse Kazziha, montre bien que la question décisive n’est pas seulement la « bonne ligne », mais la capacité à tenir une organisation qui ne devienne ni appendice d’un régime, ni simple reflet d’une fraction sociale.
b) Le problème n’est pas « nation vs classe », mais hégémonie dans le bloc national-populaire.
Dans une formation coloniale, la lutte nationale n’est pas un décor idéologique : elle est l’espace concret où se joue la lutte pour la direction politique. Mahdi Amel est précieux ici, précisément parce qu’il refuse les raccourcis : la libération nationale et la transformation sociale ne se succèdent pas mécaniquement ; elles s’impliquent, se tendent, se conditionnent.
Cela change la question : il ne s’agit pas de sortir du national, mais d’y mener une bataille d’hégémonie — donc de front, de programme, d’organisation, et de durée.
3) Front : l’outil que RP laisse dans l’ombre
Une stratégie matérialiste ne contourne pas la question du front. Elle la met au centre, parce que la lutte de libération ne se mène jamais avec un peuple homogène et une direction idéale.
Un front n’est ni une fusion, ni une pure cohabitation : c’est une technique politique qui permet d’unifier l’action contre l’ennemi principal tout en maintenant la lutte interne pour la direction. Autrement dit : unité dans l’action, séparation dans l’organisation, clarté dans le programme. RP insiste sur la rupture avec les directions capitulardes, mais il discute peu les modalités concrètes par lesquelles une force révolutionnaire travaille avec des forces non révolutionnaires (ou non marxistes) sans se dissoudre — alors que c’est souvent là que se joue la possibilité même d’une hégémonie.
Sur ce point, l’expérience palestinienne est un laboratoire cruel : l’unité nationale peut être une condition de survie, mais aussi une forme de neutralisation si elle se paie par le silence sur les contradictions sociales et les dépendances. C’est précisément pourquoi une politique de front exige une grammaire fine — et pas seulement des anathèmes.
4) Islamo-nationalismes : ne pas excommunier, analyser — et agir
Pour rester matérialiste (et éviter toute pente anti-islamiste), il faut être strict : on n’analyse pas un courant par son vocabulaire religieux, mais par sa base sociale, ses fonctions politiques, ses contradictions et ses formes d’encadrement populaire.
Les travaux d’Alhaj, Dot-Pouillard et Rébillard sont utiles parce qu’ils obligent à sortir des clichés : le MJIP, par exemple, ne se réduit pas à une logique de jihad global ; il se pense d’abord comme acteur palestinien, cherchant l’unité nationale, combinant radicalité externe et pragmatisme interne dans certaines séquences.
Cela ne fait pas de ces mouvements une direction « suffisante » pour une libération. Mais cela impose une conséquence stratégique simple : on ne construit pas l’hégémonie en parlant sur les masses depuis l’extérieur ; on la construit en intervenant dans les formes existantes de mobilisation, en y menant la bataille politique sans les diaboliser ni les idéaliser.
On peut donc formuler le cœur du désaccord avec RP de manière nette : l’article identifie des impasses, mais ne propose pas la mécanique stratégique qui permettrait d’en sortir. Or, cette mécanique commence toujours par une question concrète : quel bloc populaire construire, avec quelles forces, sur quel programme, et par quelles institutions de lutte ?
III. Reposer la question nationale : non pas un « habillage », mais le terrain réel de l’hégémonie
Si l’on veut sortir d’une critique purement négative (pointer les trahisons, dénoncer les impasses), il faut reprendre la question nationale palestinienne au niveau où elle se joue réellement : non comme un discours que des élites utiliseraient à volonté, mais comme une forme historique de politisation populaire produite par la colonisation, l’expulsion, la fragmentation du territoire, l’exil et la gestion sécuritaire permanente. C’est aussi, qu’on le veuille ou non, le langage dans lequel se nouent — et se dénouent — les alliances, les fronts, les unités et les guerres intestines.
L’article de Révolution Permanente a raison de rappeler que des directions bourgeoises ont souvent capturé cette forme nationale pour la convertir en monnaie diplomatique ou en appareil de domination interne. Mais il incline à traiter la nation comme un obstacle à dépasser plutôt que comme un champ de bataille. Or, dans une situation coloniale, ce « champ » n’est pas optionnel : c’est l’espace même où se détermine la possibilité d’une politique révolutionnaire.
1) La nation comme forme populaire : ce qu’on rate quand on la réduit au « nationalisme »
Dans une colonie de peuplement, l’ennemi principal ne se contente pas d’exploiter : il organise la dépossession, l’enfermement, la séparation, l’illégalité programmée, la fragmentation des corps et des espaces. Le fait national, ici, n’est pas une simple « idée » : il est une expérience sociale cumulative, une mémoire, une géographie, une administration de l’humiliation, un régime de mobilité et d’immobilité. On ne « sort » pas de cette forme par la force du raisonnement ; on la travaille politiquement.
Sur ce point, la tradition marxiste arabe la plus rigoureuse est souvent plus précieuse que les caricatures occidentales du « nationalisme ». Mahdi Amel insiste sur une idée décisive : en condition coloniale, la libération nationale n’est pas un prélude moral à autre chose, elle est une dimension constitutive du processus révolutionnaire lui-même — précisément parce que l’État colonial organise la formation sociale entière.
Cela ne signifie pas que toute politique nationale est « progressiste », encore moins que toute direction nationale mérite soutien. Cela signifie qu’on ne comprend rien à la dynamique des masses si l’on traite la nation comme une simple superstructure interchangeable.
2) La vraie question : pas « nation ou classe », mais qui dirige le bloc national-populaire
Une stratégie matérialiste ne pose pas le problème en termes de purification : « sortir du national, enfin devenir de classe ». Elle pose la question en termes d’hégémonie : quelle force sociale, quel programme, quelles institutions conduisent la lutte nationale — et à quelles fins ?
C’est ici que l’histoire des organisations arabes et palestiniennes sert d’école. L’articulation national/social n’est ni automatique ni paisible : elle se fait à travers des crises d’organisation, des débats de ligne, des dépendances régionales, des tentatives de fusion, des scissions — bref, par un travail politique concret, pas par un schéma.
Ce que cette histoire enseigne, c’est que l’alternative n’est jamais « national pur » contre « social pur ». L’alternative réelle est : national sous hégémonie bourgeoise (qui conduit à la négociation, à la gestion, à la police) ou national-populaire sous hégémonie populaire (qui transforme l’unité en instrument de lutte, et non en clôture).
De ce point de vue, le bilan sévère de RP sur Oslo et la mutation du Fatah est utile, mais il manque une précision stratégique : ce n’est pas seulement un « mauvais choix » ou une « capitulation ». C’est la stabilisation d’un bloc social déterminé, avec ses intérêts, ses ressources, sa rente politique, et ses appareils.
Une stratégie révolutionnaire ne répond pas à cela par un rejet moral ; elle répond par une contre-construction : institutions populaires, autonomie matérielle, cadres d’organisation, programme, et politique de front.
3) « Unité nationale » : pas une vertu, une technique de guerre politique
Un des points les plus sensibles — et souvent maltraité par la gauche — est celui de l’unité nationale. On oscille entre deux erreurs.
- Première erreur : l’unité comme fétiche, qui interdit la critique, neutralise les contradictions sociales, et finit par protéger les appareils dominants.
- Seconde erreur : l’unité méprisée comme « compromis », au nom d’une ligne pure, ce qui revient souvent à laisser intact le monopole de la représentation populaire par les forces dominantes.
L’unité, en situation coloniale, n’est ni un absolu ni un tabou : c’est une question d’efficacité politique. Elle peut être vitale pour tenir contre la fragmentation imposée ; mais elle peut aussi devenir une camisole si elle sert à étouffer la bataille d’hégémonie.
L’unité n’est pas seulement un slogan des directions « séculières ». On la retrouve comme objectif explicite dans certaines organisations islamo-nationalistes, mais sous une forme pragmatique : limiter les affrontements intestins, préserver des passerelles, maintenir un cadre d’action national, tout en conservant une radicalité contre l’occupant.
Ce constat ne « valide » aucune direction ; il impose une exigence stratégique : si l’unité est un terrain, alors la question devient comment la disputer — et pas comment la nier.
4) La conséquence pour notre critique de RP
C’est ici que notre désaccord avec RP peut être formulé de manière tranchante mais juste.
RP voit bien la capture bourgeoise de la cause nationale. Mais l’article tend à conclure comme si la lutte nationale devait être dépassée par un saut direct vers une politique de classe déjà constituée — ce qui revient, en pratique, à se placer à côté du mouvement réel.
Une stratégie matérialiste part de l’inverse : puisqu’on ne choisit pas la forme nationale — elle est imposée par la structure coloniale — on doit y mener une bataille prolongée pour l’hégémonie, en combinant front d’action, autonomie politique, organisation populaire et programme.
Reste alors la question la plus délicate, et souvent la plus mal posée : comment mener cette bataille d’hégémonie dans un champ palestinien où les formes islamo-nationalistes jouent un rôle central, sans tomber ni dans l’anti-islamisme de principe, ni dans le romantisme de la « résistance pure » ?
IV. Islamo-nationalismes : analyser sans excommunier, lutter sans se dissoudre
Si l’on veut parler de stratégie sans tricher, il faut affronter un fait massif : dans la Palestine contemporaine, une part décisive des formes d’encadrement populaire, de discipline collective, de travail social et de résistance armée s’est reconstituée — partiellement — autour d’organisations se réclamant de l’islam. On peut le regretter, s’en réjouir, ou s’en tenir à distance : cela ne change rien au problème. Une politique matérialiste ne commence pas par dire ce qui devrait exister ; elle part de ce qui existe, et elle demande : qu’est-ce que cela produit, pour qui, contre qui, et avec quelles contradictions ?
C’est précisément le point où une partie de la gauche bascule dans un double piège : soit l’anti-islamisme « de principe », qui confond analyse et réflexe identitaire ; soit le romantisme de la « résistance pure », qui suspend toute critique dès lors qu’il y a confrontation armée avec l’occupant. Le premier est politiquement stérile ; le second est politiquement dangereux. La question stratégique est ailleurs : comment disputer l’hégémonie au sein d’un bloc populaire où ces forces comptent, sans les diaboliser ni s’y dissoudre ?
1) Sortir de la fausse opposition : religion versus progrès
Une clé, ici, est de refuser le cadre purement « civilisationnel » qui parasite trop de discussions. Le critère déterminant n’est pas l’étiquette religieuse, mais le rapport social et politique qu’une force contribue à stabiliser ou à fissurer. Le conflit décisif n’oppose pas « foi » et « raison », mais l’acceptation d’un ordre de domination et les formes de défi qu’il rencontre dans une formation sociale donnée.
Appliqué au champ palestinien, cela implique une règle simple : on ne « classe » pas un mouvement islamiste en fonction de sa rhétorique, mais en fonction :
- de sa base sociale (classes et fractions mobilisées),
- de ses fonctions (encadrement, redistribution, discipline, contrôle, services),
- de ses alliances et dépendances,
- et des contradictions qu’il ouvre ou qu’il ferme dans la lutte nationale.
Cette méthode a un avantage politique immédiat : elle interdit le glissement anti-islamiste, parce qu’elle ne parle pas des croyances mais des rapports de forces.
2) Le Jihad islamique palestinien : un cas qui oblige à la précision
Le livre de Wissam Alhaj, Eugénie Rébillard et Nicolas Dot-Pouillard est précieux pour une raison : il montre, dans le détail, combien les catégories rapides (« islamisme », « jihad », « radical », « réactionnaire ») produisent souvent plus de paresse que d’intelligence.
Le MJIP apparaît comme un acteur d’abord palestinien, dont l’horizon est la lutte contre Israël, et non l’exportation d’un jihad déterritorialisé. Il se caractérise par une radicalité dirigée vers l’ennemi colonial, tout en adoptant, sur plusieurs séquences, une posture plus prudente dans l’ordre interne : pas de programme d’islamisation coercitive comparable à d’autres expériences, et une insistance récurrente sur des formes d’unité nationale (au sens d’évitement des guerres intestines et de maintien d’un cadre palestinien commun).
Ce point est décisif pour notre critique de RP. Non pas pour « réhabiliter » qui que ce soit, mais pour rappeler ceci : si une organisation islamo-nationaliste peut combiner une forte capacité de résistance et une politique d’unité interne, alors on ne peut pas traiter l’ensemble du champ islamiste comme une simple impasse stratégique à excommunier. On est obligé de raisonner plus finement : en termes de tendances, de contradictions, de configurations, et de possibilités d’intervention.
3) Ce que l’article de RP rate ici : la différence entre critique politique et disqualification
L’article de Révolution Permanente tend à enfermer les forces islamistes dans une formule globale : elles seraient incapables de « rompre » avec l’orientation qui a mené à l’impasse, même lorsqu’elles incarnent la résistance armée.
Le problème n’est pas de critiquer : une critique marxiste peut être très dure, y compris envers des forces populaires réelles. Le problème est la forme stratégique de la critique. Une critique opératoire devrait répondre à des questions concrètes :
- Quels rapports ces forces entretiennent-elles avec les masses (services, discipline, représentation, mobilisation) ?
- Quelles dépendances régionales les traversent, et comment ces dépendances limitent-elles leur autonomie ?
- Quels compromis internes rendent leur « unité nationale » possible — et quelles tensions sociales elles contiennent ou déplacent ?
- Quelles ouvertures existent, où peut s’inscrire une bataille d’hégémonie ?
Sans ces questions, la critique devient une disqualification. Et la disqualification a un effet politique connu : elle laisse intacte la capacité de ces forces à représenter le peuple, tout en plaçant la gauche « révolutionnaire » dans la position confortable — et stérile — de témoin extérieur.
4) Une orientation matérialiste : front d’action, séparation organisationnelle, bataille d’hégémonie
Si l’on veut rester à la fois matérialiste et non anti-islamiste, une ligne minimale devrait tenir ensemble trois exigences, qui peuvent sembler contradictoires mais ne le sont pas.
a) Un front d’action contre l’ennemi colonial.
Là où la colonisation fragmente, l’unité d’action est une condition de survie. Elle n’implique ni adhésion idéologique, ni silence sur les contradictions sociales. Elle implique une hiérarchie des combats : dans l’affrontement principal, l’unité tactique peut être nécessaire.
b) Une séparation organisationnelle et programmatique claire.
L’unité d’action n’est pas la fusion. L’erreur historique de nombreuses forces révolutionnaires, dans des contextes comparables, a été de confondre front et dissolution. L’expérience palestinienne l’a payé cher : dès que l’autonomie matérielle et organisationnelle est perdue, la « ligne » devient une opinion.
c) Une bataille patiente d’hégémonie au sein du bloc populaire.
L’enjeu n’est pas d’arracher les masses à leur forme nationale ou religieuse « par décret », mais de déplacer progressivement la direction politique, en liant la lutte nationale à des intérêts sociaux, à des formes de pouvoir populaire, à une capacité d’organisation durable.
Ce triple mouvement — front d’action, autonomie, hégémonie — est précisément ce qui manque au texte de RP, qui flotte entre une dénonciation juste des impasses et une incapacité à dire comment intervenir dans un champ réel où ces forces comptent.
Reste une question que l’on ne peut pas éviter : si la bataille d’hégémonie ne se mène ni par l’excommunication, ni par la fusion, alors il faut parler de l’outil central de toute stratégie de libération : le front, ses règles, ses risques, et ses conditions de succès — notamment face aux États de la région, aux appareils de rente, et aux mécanismes d’instrumentalisation.
V. Le front comme instrument, pas comme slogan
À ce stade, une chose devient claire : parler de stratégie en Palestine, c’est forcément parler de front. Non pas au sens d’une formule magique (« l’unité ! »), mais au sens d’une technique politique difficile, pleine de risques, qui vise à organiser l’action commune contre l’ennemi principal sans abandonner la lutte pour la direction du mouvement. C’est exactement le point où l’article de Révolution Permanente reste en suspens : il diagnostique des captures, des capitulations, des dépendances — mais il dit peu de la mécanique qui permettrait d’éviter qu’une force révolutionnaire soit marginalisée ou absorbée.
Le front n’est pas la fusion. C’est un agencement instable, fait pour durer assez longtemps pour produire des effets matériels (tenir contre la fragmentation, accumuler de la force, protéger des espaces d’organisation), mais jamais assez « total » pour dissoudre les différences de programme. Dans une formation coloniale, cette distinction est vitale : l’ennemi cherche justement à casser toute capacité d’action collective par la division territoriale, la guerre psychologique, l’asphyxie économique et la concurrence entre appareils. Un front d’action peut donc être une condition de survie politique. Mais il peut aussi devenir un mécanisme d’étouffement si l’unité sert à sanctuariser une direction dominante, à neutraliser la critique, ou à transformer la discipline contre l’ennemi en discipline contre le peuple.
La tradition du mouvement palestinien connaît cette ambivalence de l’intérieur. Aucune organisation ne peut se contenter d’une radicalité déclarative ou d’une bravoure armée ; sans programme et sans analyse des forces, la lutte se condamne à l’improvisation, et l’improvisation finit toujours par coûter politiquement au camp populaire. Ce qu’il vise, au fond, c’est la même question : comment un front ne devient-il pas un paravent derrière lequel des appareils gèrent la lutte — ou l’échangent — au lieu de la conduire ?
C’est ici que l’on doit être précis sur les États et les régimes de la région. L’article de RP a raison de rappeler l’instrumentalisation, parfois cynique, parfois sanglante, dont la cause palestinienne a souvent fait l’objet. Mais une stratégie ne se contente pas d’affirmer « rupture avec les régimes » : elle doit distinguer ce qui relève du soutien tactique (logistique, sanctuaire, flux matériels), de la dépendance stratégique (capture politique, chantage, conversion de la lutte en variable d’ajustement), et de l’intégration organique (quand l’appareil devient une excroissance d’un État). La question de l’autonomie n’est pas secondaire : elle est souvent la condition matérielle pour que la « ligne » ne soit pas qu’un discours.
Or c’est là que l’on peut retourner RP contre lui-même, mais sans polémique : en dénonçant (justement) les formes de collaboration et de dépendance, RP laisse entendre qu’il suffirait de se tenir « pur » pour échapper aux mécanismes d’absorption. En réalité, dans un champ colonisé et militarisé, ce qui protège une force populaire, ce sont des ressources, des réseaux, des cadres, une implantation sociale, une capacité d’éducation politique, et des formes de décision qui rendent l’appareil redevable aux masses. Sans cela, on peut proclamer mille fois l’indépendance : on la perdra au premier étranglement. Dans une formation coloniale, la question n’est pas seulement de « s’opposer » à l’impérialisme ; elle est de construire, au sein même du bloc national, une direction capable de lier libération nationale et intérêts sociaux populaires — autrement dit de faire de l’unité un instrument de lutte, pas un couvercle.
Cela vaut aussi pour l’ « unité nationale » à l’intérieur du champ palestinien. On a trop souvent une discussion moraliste : l’unité serait une vertu en soi, ou bien une compromission en soi. La réalité est plus brutale : l’unité est une fonction. Elle sert soit à empêcher la colonisation d’exploiter les fractures, soit à protéger des appareils qui se financent et se reproduisent dans la division. L’unité n’est donc pas seulement un mot d’ordre des élites « séculières » : elle peut être une politique concrète — contenir la guerre interne, préserver un cadre palestinien, maintenir des passerelles — sans que cela prouve la « bonté » d’une direction. Ce genre de précision oblige à sortir des jugements globaux, et donc à penser stratégiquement : que fait l’unité, dans telle séquence ? qui en profite ? qui la paie ? que permet-elle d’accumuler ?
Au fond, la question du front se résume à une exigence simple, mais lourde : tenir ensemble l’unité d’action contre l’ennemi principal et la lutte pour l’hégémonie au sein du peuple. Si l’on renonce à l’unité d’action, on se condamne à parler dans le vide. Si l’on renonce à la lutte pour l’hégémonie, on se condamne à servir d’appoint à une direction qui finira tôt ou tard par négocier, gérer, ou se transformer en appareil de police — ce que RP décrit très bien à propos d’Oslo, mais sans tirer toutes les conséquences organisationnelles.
C’est ici que se prépare la question suivante, la plus explosive, et souvent la plus caricaturée : la place de la lutte armée. Non pas comme fétiche, non pas comme faute morale, mais comme élément d’une stratégie qui vise l’accumulation de pouvoir populaire. C’est là que l’on peut mesurer si un front est un outil de libération ou un dispositif de reproduction des appareils.
VI. La lutte armée : ni fétiche, ni faute morale — une question de direction politique
Arrivé à ce point, on touche au nœud le plus sensible, et sans doute le plus maltraité, des débats sur la Palestine : la lutte armée. C’est ici que les discussions basculent le plus vite soit dans la célébration incantatoire, soit dans la mise à distance morale. Or, d’un point de vue matérialiste, ces deux postures sont également stériles. La question n’est pas de savoir si la violence est « bonne » ou « mauvaise », mais ce qu’elle fait politiquement, à qui elle profite, et dans quelle architecture stratégique elle s’inscrit.
L’article de Révolution Permanente formule une critique juste lorsqu’il affirme que la violence, lorsqu’elle est coupée d’une stratégie, peut se retourner contre ceux qu’elle prétend défendre. Mais cette critique reste incomplète tant qu’elle ne débouche pas sur une doctrine positive. Dire que la violence « sans stratégie » est une impasse ne suffit pas ; encore faut-il dire quelle articulation entre lutte armée, organisation populaire et direction politique permet d’éviter cette impasse. À défaut, on reste dans une position négative, qui dénonce sans orienter.
La tradition révolutionnaire palestinienne a pourtant produit, très tôt, des formulations d’une grande sobriété sur ce point. Le FPLP insiste, dès la fin des années 1960, sur une idée simple et dure : porter les armes n’est jamais en soi une garantie de radicalité ni d’efficacité. Sans analyse concrète de la situation, sans appréciation des forces, sans programme politique clair et sans organisation capable de durer, la lutte armée se réduit à une succession d’actes héroïques — et l’héroïsme, laissé à lui-même, est politiquement coûteux.
Ce rappel n’a rien perdu de son actualité. Il vise moins les combattants que les directions : ce sont elles qui transforment l’action armée en stratégie, ou qui la laissent dériver en substitut de politique.
Dans une situation de colonisation de peuplement, la lutte armée n’est ni contingente ni facultative. Elle s’impose, d’une manière ou d’une autre, parce que l’ennemi n’exerce pas seulement une domination économique ou juridique, mais un contrôle militaire permanent, appuyé sur la terreur, l’encerclement et la punition collective. Mais reconnaître cela ne dit encore rien de son usage politique. Une action armée peut renforcer la capacité d’auto-organisation populaire ; elle peut aussi la court-circuiter. Elle peut ouvrir des espaces de mobilisation ; elle peut aussi concentrer toute la légitimité sur un appareil militaire, au détriment du pouvoir populaire.
C’est précisément ici que la critique de RP manque de profondeur stratégique. En soulignant, à juste titre, que certaines séquences de lutte armée ont servi l’ennemi en isolant la population ou en facilitant la répression, l’article suggère que le problème réside principalement dans le choix de la violence elle-même. Or, l’histoire palestinienne — comme d’autres histoires de libération — montre que le problème est rarement l’existence de la lutte armée, mais sa substitution à la politique. Lorsque l’action militaire devient le lieu exclusif de la décision, lorsque les masses sont réduites au rôle de spectatrices ou de victimes collatérales, lorsque la stratégie se confond avec la capacité de nuisance, alors la lutte s’épuise, même si elle se maintient longtemps.
Une approche matérialiste conduit à poser la question autrement : la lutte armée contribue-t-elle à construire des formes de pouvoir populaire, ou bien tend-elle à les dissoudre ? Est-elle subordonnée à un projet politique explicite, ou bien devient-elle le projet lui-même ? Est-elle articulée à des formes d’organisation sociale, de solidarité matérielle, de décision collective, ou bien fonctionne-t-elle comme un appareil séparé, qui parle au nom du peuple sans être contrôlé par lui ?
Sur ce point, les débats autour des organisations islamo-nationalistes sont éclairants, précisément parce qu’ils obligent à sortir des schémas. Certaines de ces organisations ont cherché, à des degrés divers, à articuler action armée, encadrement social et maintien d’un cadre national commun, plutôt qu’à absolutiser la dimension militaire. Cela ne constitue pas un modèle, encore moins une garantie. Mais cela oblige à une exigence analytique : si l’on veut critiquer la lutte armée, il faut le faire à partir de ses effets politiques concrets, et non à partir d’un rejet abstrait ou d’une attente messianique de la « bonne » insurrection.
En situation coloniale le problème n’est jamais de choisir entre violence et non-violence comme entre deux morales concurrentes. Le problème est de savoir si la lutte — armée ou non — contribue à déplacer le rapport de forces en faveur des classes populaires, ou si elle consolide, sous couvert de radicalité, des formes de pouvoir séparées.
Appliquée à la Palestine, cette perspective interdit deux raccourcis symétriques : celui qui sacralise la résistance armée comme essence de la libération, et celui qui la condamne comme impasse sans proposer d’alternative crédible dans un contexte de domination militaire totale.
On peut alors formuler une ligne simple, mais exigeante : la lutte armée ne peut être qu’un moment d’une stratégie de libération, jamais son substitut. Elle doit être subordonnée à une direction politique capable d’articuler unité nationale, organisation populaire, bataille d’hégémonie et horizon régional. C’est précisément ce chaînon que l’article de RP appelle sans le construire : une doctrine qui permette de juger non pas la violence en général, mais son inscription dans un projet de pouvoir populaire.
C’est à partir de là que la dernière question stratégique s’impose : si la lutte armée, le front et la bataille d’hégémonie ne suffisent pas isolément, comment penser l’échelle régionale — non comme une incantation, mais comme un champ de forces, de contradictions et de possibilités concrètes ?
VII. Le régional : horizon nécessaire, incantation dangereuse
Arrivé ici, on peut enfin aborder ce que l’article de Révolution Permanente place au centre de sa conclusion : la perspective régionale. Sur le fond, l’intuition est juste. La Palestine n’est pas une enclave isolée ; elle est enchâssée dans un ordre régional structuré par l’impérialisme, la contre-révolution arabe, les accords de normalisation, la rente sécuritaire et la gestion autoritaire des sociétés. Penser la libération palestinienne sans ce cadre, c’est se condamner à l’illusion.
Mais c’est précisément parce que cet horizon est indispensable qu’il devient dangereux lorsqu’il est traité comme une formule de sortie plutôt que comme un problème stratégique à part entière. Là encore, l’article de RP bascule trop vite du constat à l’énoncé : la révolution régionale apparaît comme une solution générale, presque comme une évidence, là où elle devrait être posée comme une construction longue, conflictuelle, profondément inégale.
Le premier problème est temporel. Une stratégie matérialiste distingue toujours les rythmes : celui de la lutte palestinienne, celui des sociétés arabes, celui des États, celui des recompositions impériales. Confondre ces temporalités revient à suspendre la stratégie palestinienne à un événement extérieur dont personne ne maîtrise ni le déclenchement ni la forme. L’histoire récente l’a montré avec cruauté : les soulèvements arabes ont ouvert des possibles immenses, mais leur écrasement a aussi renforcé l’encerclement de la Palestine. Faire de la révolution régionale une condition préalable revient, de fait, à reporter indéfiniment la question stratégique palestinienne.
Le second problème est politique. Dire « régional » ne dit rien, en soi, des forces sociales en présence. Or le monde arabe n’est pas un sujet homogène : il est traversé par des clivages de classe profonds, par des États contre-révolutionnaires puissants, par des bourgeoisies compradores, par des appareils militaires et sécuritaires intégrés à l’ordre impérial. Une stratégie sérieuse ne peut pas se contenter d’invoquer “les masses de la région” ; elle doit dire où, comment, par quels relais, avec quelles alliances sociales une dynamique régionale peut se construire. Sans cela, le régional devient une abstraction consolante.
C’est ici que les travaux d’Ali Kadri apportent un correctif utile, même indirectement : la région n’est pas seulement un espace politique, c’est une formation économique violente, structurée par la destruction de forces productives, la prolétarisation forcée, l’extraction de valeur et la guerre permanente. Penser le régional, ce n’est donc pas seulement appeler à la solidarité ; c’est penser les conditions matérielles dans lesquelles des luttes sociales peuvent converger, ou au contraire être étouffées avant même de se reconnaître. Autrement dit, sans ancrage social et organisationnel, l’horizon régional reste un mot d’ordre sans prise.
Le troisième problème, enfin, est stratégique au sens strict. En faisant du régional un horizon global, RP tend à escamoter la question décisive : comment une force palestinienne autonome agit-elle ici et maintenant, tout en s’inscrivant dans un cadre régional hostile ? Une stratégie matérialiste répondrait en termes de médiations : réseaux transnationaux concrets, luttes anti-normalisation, liens syndicaux et populaires, travail politique dans les diasporas, capacité à transformer chaque crise régionale en opportunité de politisation — sans attendre un grand basculement général.
C’est ici que l’on peut formuler, sans polémique mais avec netteté, le désaccord final avec RP. L’article identifie correctement la nécessité d’un horizon régional ; mais faute de penser les médiations, il transforme cet horizon en substitut de stratégie. Or, du point de vue marxiste-léniniste, ce sont précisément les médiations — fronts, organisations, institutions populaires, luttes d’hégémonie, temporalités différenciées — qui font la différence entre une orientation révolutionnaire et une posture.
Au terme de ce parcours, le désaccord avec l’article de Révolution Permanente peut être formulé simplement. Le texte pose de bonnes questions, et il nomme des impasses réelles. Mais il reste prisonnier d’une illusion fréquente à gauche : croire qu’il suffit d’énoncer des principes justes pour produire une stratégie.
Or, la libération de la Palestine ne se jouera ni dans la pureté idéologique, ni dans l’excommunication des formes existantes de résistance, ni dans l’invocation incantatoire d’un horizon régional. Elle se jouera dans une lutte prolongée pour l’hégémonie, au sein d’un bloc populaire anticolonial réel, traversé de contradictions, où se combinent unité d’action et conflit politique, résistance armée et organisation des masses, autonomie stratégique et inscriptions régionales concrètes.
Ce que l’histoire du mouvement palestinien, du marxisme arabe révolutionnaire et des luttes anticoloniales enseigne, c’est une leçon peu spectaculaire mais décisive : on ne choisit pas les formes initiales de la lutte, mais on peut choisir de les transformer. Et cette transformation ne se fait ni par décret, ni par surplomb, mais par un travail politique patient, conflictuel, souvent ingrat — le seul, pourtant, qui permette à une cause juste de devenir une force capable de vaincre.
Selim Nadi (membre du QG décolonial)