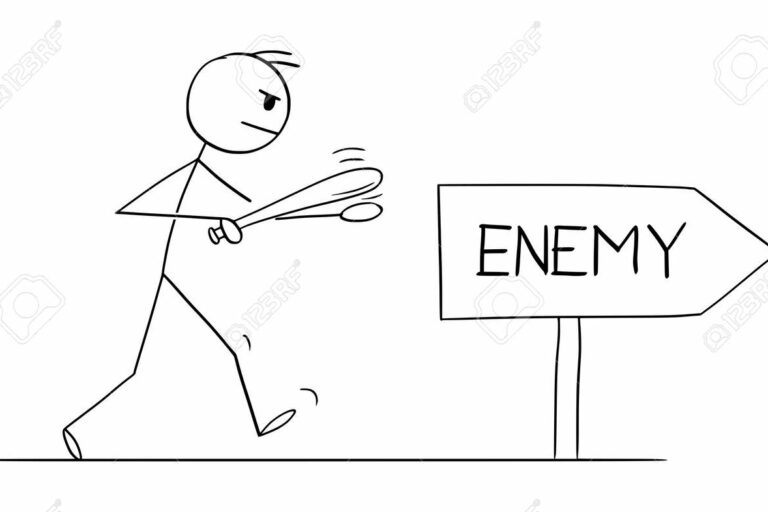Avec l’aimable autorisation des éditions La Fabrique, nous publions l’introduction du livre « Beaufs et barbares, le pari du nous » d’Houria Bouteldja dont la sortie est prévue le 20 janvier 2023.
L’ange Gabriel (as) demanda : « Informe-moi au sujet de l’heure du Jour Dernier et parle-moi de ses signes annonciateurs », et le Prophète (sws) lui répondit : « … lorsque tu verras les va-nu-pieds, mal vêtus, nécessiteux qui gardent les troupeaux se faire élever des constructions de plus en plus hautes. »
Hadith rapporté par Mouslim
« Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue ; voici le moment de […] détruire ceux qui détruisent la terre. »
L’Apocalypse selon saint Jean
C’est la fin du monde.
La Torah, la Bible et le Coran l’ont annoncé. On aura beau scruter l’horizon, on n’y verra que des cieux brunissant et des soleils ténébreux. Tous les signaux sont au rouge. J’aimerais parler d’espoir mais je sens bien que le mot est ringard.
C’est la fin du monde. Nos certitudes fondamentales, notre vision moderne d’un progrès matériel, moral et éthique illimité n’est plus. Que ce soit à cause de la menace d’une guerre nucléaire, d’un virus ou du dérèglement climatique, il n’est plus aucune utopie, aussi désirable soit-elle, capable de l’emporter sur notre lucidité ou notre résignation. Les esprits les plus sécularistes et les plus scientifiques commencent à converger avec les croyants. Ils partagent désormais un imaginaire commun : la fin est pour bientôt.
C’est un bon début. Allons plus loin et considérons la puissance de la pensée négative. Considérons son pouvoir et prenons-le pour appui. Pas pour accélérer cette fin mais pour rendre au désespoir sa dimension métaphysique. Ce n’est plus l’espoir qui nous fera vivre, mais le désespoir. En voilà une perspective concrète et matérialiste ! La fin du monde comme mythe mobilisateur et, in fine, comme nouvelle conscience positive. Le poète n’a-t-il pas dit : « Là où croît le péril, Croît aussi ce qui sauve » ?
Le monde est mort, vive le monde !
Si pour les monothéismes la fin du monde est une certitude, l’heure à laquelle elle adviendra est un secret. Un secret que l’homme moderne plus qu’aucune autre créature terrestre aura contribué à éventer. Si elle semble si proche désormais, il se pourrait qu’elle puisse encore être repoussée, si tant est que notre volonté collective soit d’en finir avec le monde tel qu’il existe. Ce monde est capitaliste. Ce monde, c’est la destruction du vivant. Ce monde, c’est la guerre. Il faut y mettre fin. Maintenant.
Mais si le capitalisme est partout, les nations les plus responsables de la fin du monde sont, la plupart, localisées en Occident. C’est de là que j’écris, du cœur du capitalisme français. C’est là que mon désespoir s’épanouit. C’est là que mon espoir doit renaître, là que je dois envisager la fin de ce monde. Comme je mesure le défi qui consiste à tenir une ligne dans les ruines des espoirs politiques, autant rester réaliste et exiger l’impossible, non ? L’impossible, ce sera ça : la fin de ce monde. Le NOUVEL ESPOIR.
Nous avons l’Idée, le mythe mobilisateur. Nous connaissons l’Ennemi. Il nous faut maintenant une volonté collective et une stratégie globale pour « détruire ceux qui détruisent la terre ». C’est là que les choses se compliquent car les forces populaires capables de mettre fin à ce monde sont désunies, séparées, voire opposées les unes aux autres. Le pari, c’est de trouver le moyen de les unir. Les facteurs de la désunion sont nombreux mais parmi les plus structurels, les plus anciens et les plus effectifs, il y a la division raciale. C’est à ce nœud que je consacre ce livre.
Faut-il être fou pour s’obstiner à croire à la formation d’un bloc historique capable de s’organiser, de résister voire de prendre l’ascendant sur l’ennemi ? Un bloc qui réussirait l’unité de ses classes populaires, fort d’une stratégie de conquête du pouvoir et de l’État ? S’il y a bien une unité qui s’affirme dont le triomphe est annoncé, c’est celle de la suprématie blanche, dernier et ultime recours du bloc bourgeois occidental ébranlé de toutes parts par les crises sociales et politiques qu’il ne cesse de provoquer et qu’il aggrave jour après jour. Dans l’attente du big one, cette déflagration dont on ne connaît pas vraiment l’ampleur mais qu’on pressent gigantesque (la fin ?). De ce point de vue, la France est un cas d’école mais notre compréhension de ce qui nous arrive ne saurait se passer d’une analyse du capitalisme comme d’une totalité. C’est connu de tout marxiste digne de ce nom mais il importe d’en rappeler ici les grands traits. Une telle analyse doit d’abord et avant tout replacer l’État français et sa politique dans l’espace mondial – le « système-monde », dirait Wallerstein –, qui voit s’affronter les puissances d’argent. Un espace qui est tout à la fois une combinaison de dynamiques économiques, dominées par le capital financier, et de logiques géopolitiques qui s’imposent à n’importe quel État du fait même qu’il est inscrit dans cet espace mondial impérialiste. Deux contraintes ont perturbé le système-monde au xxe siècle, laissant une trace indélébile et traumatisante dans les pays capitalistes avancés : la révolution russe et les luttes de libération du tiers-monde. Mais depuis l’effondrement de l’URSS, la plupart des entraves géopolitiques sont tombées. Le capital jouit d’une liberté sans limites pour exploiter les hommes, la terre et l’environnement. Après la disparition de « l’empire du mal », il a fallu trouver un nouvel ennemi capable d’unifier contre lui le bloc impérialiste. La révolution iranienne, la montée de l’islam politique, puis les attentats djihadistes en ont fourni l’occasion, où s’est élaborée la base idéologique de cette unité. Car cette guerre nécessite l’union nationale du peuple avec ses dirigeants ou, pour le dire autrement, l’alliance de la bourgeoisie avec les classes subalternes blanches contre les damnés de la terre à l’extérieur, et contre les indigènes à l’intérieur. Tant que le consentement populaire est acquis, les forces de l’ordre, la police et l’armée restent à l’écart de la vie publique et laissent le gouvernement arbitrer. Mais si le consentement s’effrite, ce qui est la tendance qu’on observe dans l’abstention massive ou la révolte sociale, l’armée peut s’autonomiser et « prendre ses responsabilités ».
Dans ce contexte, où la gauche radicale et l’antiracisme politique sont devenus insignifiants, où la sociale démocratie qui faisait office d’amortisseur a été liquidée, où l’extrême droite s’épanouit et où les thèmes de l’immigration et de l’islam prennent une place centrale dans le débat public, il devient urgent de renouveler nos analyses sur l’État et sur le caractère organique de la race comme technologie d’organisation de la société. Ce sera la première ambition de ce livre.
Le racisme est-il une passion des élites comme le suggère Jacques Rancière ou au contraire une passion de « prolos » comme semble le penser une grande partie du champ politique républicain, notamment à gauche ? Y a-t-il un racisme d’État comme l’affirment un certain nombre de militants et chercheurs tels Fabrice Dhume ou Éric Fassin ou alors un État raciste ? Mon hypothèse est que la race est consubstantielle de la formation des États modernes. Dès lors, l’analyse consistant à opposer « racisme d’en haut » et « racisme d’en bas » ou à innocenter l’État en faisant du racisme une variable conjoncturelle manque de pertinence : il existe une relation dialectique entre les deux que l’idée gramscienne d’« État intégral » peut nous aider à comprendre.
Gramsci définit l’« État intégral » comme une « hégémonie cuirassée de coercition » constituée des appareils d’État, de « la société politique » et de « la société civile ». C’est une unité dialectique des instances de la société civile et de la société politique, l’« ensemble des activités pratiques et théoriques grâce auxquelles la classe dirigeante non seulement justifie et maintient sa domination, mais réussit à obtenir le consentement actif des gouvernés ». Mais quel est le rôle de la race dans tout ça ? Je propose de faire la démonstration suivante : l’« État intégral » est un État racial intégral . C’est une idée qui peine à s’imposer en France tant elle est combattue alors que sous d’autres cieux elle est au moins débattue : l’État racial existe et l’État français en est un. En effet, si Gérard Noiriel, René Gallissot ou Suzanne Citron ont magistralement décrit les mécanismes qui, depuis la Révolution française mais surtout depuis la troisième République, ont « nationalisé les Français » à travers un pacte social/national, si de très nombreux penseurs marxistes dont Nicos Poulantzas et Antonio Gramsci ont pensé l’État capitaliste, il manque à l’analyse sa substance raciale, notamment pour ce qui concerne l’État français. Établir ce fait permettra aussi d’étudier sous le prisme de la race la relation qui s’est nouée depuis deux siècles entre l’État, la société politique et la société civile en France.
Gramsci n’a jamais prétendu faire de l’État, de la « société civile » et de la « société politique » des absolus, c’est-à-dire des permanences échappant à l’histoire. Il a reconnu lui-même qu’il s’agissait de distinctions d’ordre « méthodique » et non « organique ». Je profite de cette mise au point pour avertir que je prendrai moi-même des libertés avec la définition que Gramsci donnait de ces instances. D’abord, je reprendrai à mon compte la définition poulantzassienne selon laquelle « l’État n’est pas un bloc monolithique, mais un champ stratégique » qui « concentre non seulement le rapport de forces entre fractions du bloc au pouvoir, mais également le rapport de forces entre celui-ci et les classes dominées ». Ensuite, je limiterai l’analyse de la « société politique » aux organisations politiques et syndicales qui représentent l’opposition de classe au bloc au pouvoir. Enfin, la « société civile » sera envisagée sous la catégorie floue de « peuple », et de son unité constitutive dans les États modernes qu’on appelle « citoyen ».
On aura tôt fait de critiquer cette approche comme trop mécaniciste, trop systématique et on n’aura pas complètement tort. Si j’assume ici le prisme de la race comme étant à la fois essentiel et constamment occulté, cela ne préjuge pas des autres déterminismes historiques qui relèvent d’autres logiques. La race est une dimension de l’histoire, elle n’est pas toute l’histoire.
Ma seconde ambition, qui est aussi une ambition gramscienne, est de ne pas renoncer à « l’optimisme de la volonté » et à l’utopie, expression tellement galvaudée qu’elle en a perdu sa force révolutionnaire. Je voudrais ici lui donner un nouveau souffle. L’idée est la suivante : l’État (racial) intégral, aussi tentaculaire soit-il, n’épuise pas l’humain ni sa capacité à rompre ses chaînes et à chérir sa liberté. Dans le scaphandre, il est un papillon. Ce papillon aime la vie et ne rêve que d’une chose : s’échapper. Comment comprendre autrement l’optimisme de la volonté cher au révolutionnaire sarde ? Et comment ne pas en faire le substrat philosophique de toute stratégie politique ? Ou, pour le dire autrement, comment espérer renverser les formes de l’exploitation capitaliste sans d’abord croire ? Sans croire qu’une foi, qu’un objectif et qu’une stratégie sont capables de former une nouvelle communauté politique, un « nous » révolutionnaire ? À cette fin, il m’a fallu identifier deux sujets révolutionnaires : les Beaufs et les Barbares. « Beaufs » et « Barbares » ne sont pas mes mots. Ce sont ceux du mépris de classe et du racisme. Ce sont ceux de l’ennemi principal. Les mots dans lesquels il a enfermé d’un côté le prolétariat blanc et de l’autre le prolétariat indigène, ceux dont il connaît le potentiel politique et qu’il a réussi à opposer et à neutraliser, souvent avec la complicité des premiers. Résultat : les « beaufs » disent « eux » quand ils parlent des « barbares » et, inversement, les « barbares » disent « eux » quand ils parlent des « beaufs ». Le projet : remplacer « eux » par « nous ».
Je l’avoue, c’est un bien curieux mot que ce « nous ». À la fois diabolique et improbable. Au moment où, d’un côté, les « je » et les « moi » plastronnent et où, de l’autre, le « nous » de la suprématie blanche s’épanouit, il est même presque incongru. A fortiori quand on sait que les différentes composantes et sous-composantes de ce grand « nous » – fanonien – sont presque toutes aussi incertaines les unes que les autres. Le « nous » des classes populaires blanches ? Improbable. Celui des indigènes ? Une blague. La rencontre de ces deux « nous » : un mirage. Leur union au sein d’un bloc historique ? Une chimère. Je me suis donc lancée dans l’écriture d’un livre presque injustifiable à mes propres yeux en m’accrochant à la branche fragile de cet adage populaire aussi juste que dérisoire : « tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir». Le NOUVEL ESPOIR. Car, si j’ai grand-peine à me convaincre qu’une telle unité est possible, je ne me résous pas à l’idée que tout n’aura pas été tenté. Aussi faut-il commencer par ce qui l’empêche.
Haut les cœurs !
Houria Bouteldja