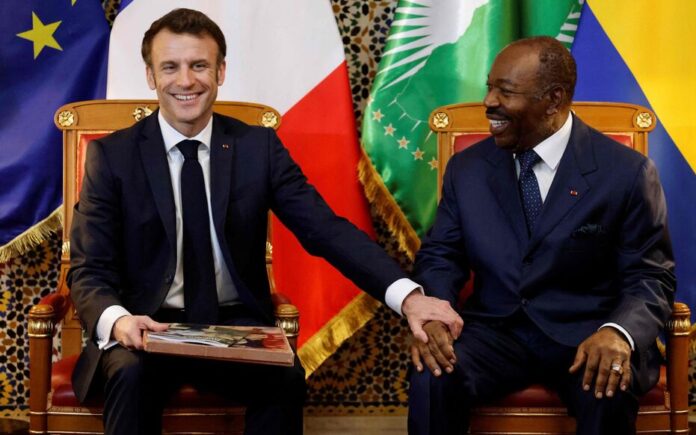Nous vivons dans un monde qui, depuis des siècles, avec l’esclavage, la colonisation, le capitalisme racial et l’impérialisme, est devenu un monde inhabitable et irrespirable pour des millions de personnes sur la planète. Littéralement. Ce n’est pas une métaphore.
Il y a plus de morts chaque année d’air pollué que de toute autre cause. Des millions d’enfants naissent avec des maladies respiratoires dans le Sud global. Ce sont des exemples d’une vulnérabilité à une mort prématurée que fabrique le capitalisme racial. C’est sa signature. Et les catastrophes climatiques exacerbent ces inégalités structurelles. Nous l’avons vu lors des inondations au Pakistan, ou lors du tremblement de terre en Turquie : qui sont les premières victimes ? Ce sont les peuples du Sud global, et parmi ces premières victimes, les femmes noires, indigènes, racialisées, les enfants, les vulnérables sont les plus touchées. Et ces inégalités structurelles sont augmentées, accrues, par le perfectionnement des outils de surveillance, de répression, et de criminalisation que déploient l’État. Cette extension de la criminalisation fait partie de l’appareil de l’État. Il n’y a pas que la prison, il y a les amendes, les interdictions, les retraits de permis, tout cela qui cherche à nous empêcher d’agir. Nous avons eu l’extraordinaire mobilisation à Sainte Soline et l’incroyable déploiement et brutalité de forces armées mais n’oublions pas les meurtres de jeunes Noir.es et de jeunes Arabes, l’humiliation subie par des d’enfants noirs et racisés forcés de se mettre à genoux par garde mobiles et gendarmes. N’oublions pas. Mais n’oublions pas non plus que la France n’est pas seulement ici, mais c’est cet État colonial-racial qui envoie des gendarmes en Guyane réprimer, emprisonner, frapper des jeunes qui se mobilisent contre la déforestation de terres amérindiennes et occupent ces terres contre cette destruction ; c’est cet État colonial-racial qui prive les Antillais d’eau et a empoisonné pour des générations les sols et les rivières de Guadeloupe et de Martinique avec le chlordécone ; c’est cet État colonial-racial qui prépare pour ce mois-ci à Mayotte une opération militaire d’expulsion massive de Comoriens en envoyant cinq escadrons de gendarmes, où le directeur de l’Agence de santé Régionale qui propose que toutes les femmes qui se présenteront à l’hôpital soient stérilisées.
C’est cet État colonial-racial contre lequel nous devons nous battre. Partout la terre se soulève. Partout. Ce qui fait le plus peur au pouvoir ce sont ces zones autonomes que nous construisons, et nos ancêtres sont les communautés marronnes, enfuies de la plantation qui ont défié, défié chaque jour, le pouvoir esclavagistes. Puis les maquis, les luttes pour la libération nationale, les luttes antiracistes, anticapitalistes, toutes, ont chaque fois, défié, défié, l’État colonial-racial !
Il faut briser la paix armée que nous propose l’État, la paix armée c’est cette fausse paix qui est assurée par la police, l’armée, et le tribunal. Il faut imposer une paix révolutionnaire contre cet état de guerre permanente qui nous est faite tous les jours. Aujourd’hui les zones à défendre, les communautés, toutes les formes de défense des communs se battent contre cette paix armée. Nous luttons pour une paix révolutionnaire et que la terre se soulève et que nous accompagnons ces soulèvements.
Françoise Vergès