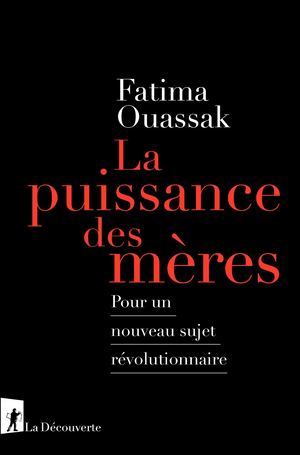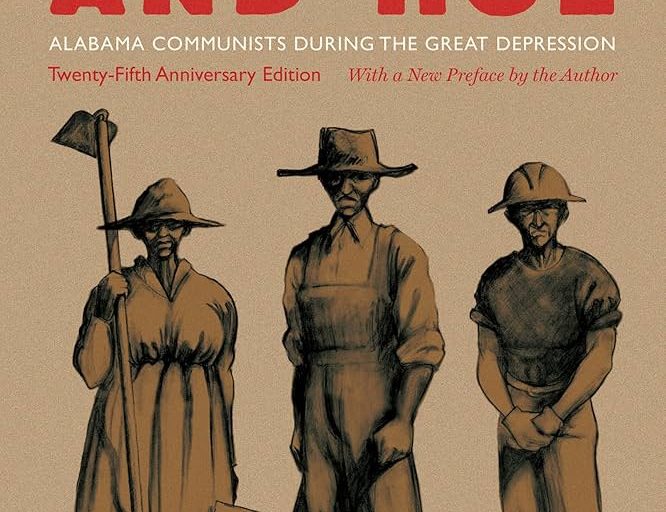À propos de La puissance des Mères : Pour un nouveau sujet révolutionnaire (La Découverte, 2020), de Fatima Ouassak
Faire des mères non pas seulement un sujet politique, mais un sujet révolutionnaire tel est le projet ambitieux de Fatima Ouassak dans son premier essai La Puissance des Mères, Pour un nouveau sujet révolutionnaire, sorti cet été aux éditions La Découverte. Affirmant que les Mères sont invisibilisées et snobées par les luttes féministes, elle souhaite les réhabiliter en démontrant le caractère révolutionnaire intrinsèque au statut de mère, et donc l’importance de les mettre à la tête de nos luttes politiques.
La Mère, une figure boudée par le féminisme
« nous devons nous engager dans une lutte collective (…). Pour cela, il faut déployer la puissance des mères, il faut nous muer en sujets politiques, retrouver notre puissance de dragon. Car notre pouvoir de faire le monde est immense. (…) Il ne faut plus nous contenter d’être des femmes ou des parents. Nous devons aussi nous libérer et exister politiquement en tant que mères, nous organiser en tant que telles partout, dans tous les espaces sociaux. » (p. 22-23)
Le projet d’élever les mères au rang de sujet révolutionnaire est ambitieux, d’autant plus qu’il s’agit d’une question peu abordée par le mouvement féministe au sein de la gauche radicale[1], alors même que la figure de « La Mère » est régulièrement mobilisée par les partis conservateurs, voire d’extrême-droite. Elle est même une figure revendiquée par des courants et penseurs masculinistes comme image idéalisée de « la femme » acceptant le destin social lié à son genre. Alain Soral a même plusieurs fois opposé le modèle de « la mère » – forte, dévouée autant à son mari, à ses enfants qu’à la nation, embrassant fièrement son rôle de nourrice, au service du collectif – à « la féministe », jeune femme revêche, animée par l’idéologie individualiste prônée par la logique néo-libérale décadente, dans un projet de pseudo émancipation contre-nature voué à l’échec puisqu’elle chercherait à singer le rôle de l’homme.
En ce sens, Fatima Ouassak nous incite à réhabiliter la figure de la mère en l’arrachant des mains des conceptions conservatrices afin que les forces progressistes s’y attardent davantage et lui accordent la place qui lui est due. En outre, cette perspective pourrait nous donner la possibilité de proposer une meilleure prise en charge des problématiques propres à la condition de mère. Sa critique sur l’absence de cette problématique dans les théories féministes peut paraître sévère. Nombreux sont, en effet, les travaux et textes féministes qui montrent comment les femmes sont tout aussi condamnées que conditionnées au rôle de mère, celui-ci étant présenté comme naturel, comme un accomplissement de leur destinée et de leur féminité. De même, de nombreux écrits se sont intéressés aux maternités d’un point de vue féministe[2]. Ces analyses montrent qu’on ne peut parler de la fonction de « mère » sans croiser les analyses avec les conditions spécifiques de sa réalisation : sociales, raciales, économiques, sanitaires. Et que la condition des mères, tant en termes d’oppression que de résistance, est bien difficile à appréhender comme condition unique politisable comme un seul bloc. Par ailleurs, les théories féministes qui s’attachent à la réflexion autour du « care » travaillent en creux cette question des maternités dans le cadre du capitalisme reproductif, mais aussi comme puissance d’agir, à partir de laquelle des alternatives pourraient être esquissées. Cependant ce n’est pas le manque de prise en compte du conditionnement des femmes comme futures mères que F. Ouassak semble viser, mais plutôt le manque de considération pour les femmes qui sont déjà mères et pour les tâches qui pèsent sur elle. Ainsi, F. Ouassak plaide pour la possibilité de faire de la mère un sujet politique à part entière, faisant un sort à cette identité apathique conditionnée par une socialisation sexiste en lui reconnaissant ses potentialités révolutionnaires sous-estimées par les théories féministes.
Nous pourrions, pour contredire cela, citer les travaux des féministes matérialistes et marxistes, comme par exemple ceux de Christine Delphy ou Paola Tabet dans un genre ou Silvia Federici dans un autre, qui se sont intéressées au rôle essentiel des femmes (en tant que mères et épouses) dans le capitalisme : celui de la reproduction, du travail domestique ou encore de l’élevage[3] des enfants – devant s’assurer de la mise au monde, de l’éducation, de la santé, du bien-être etc. de l’ouvrier, élément crucial du mode de production capitaliste. Cette approche à l’avantage de dévoiler le rôle essentiel des femmes (notamment en tant que mères) dans ce système, d’autant plus que leur travail est gratuit et invisibilisé. Il est d’ailleurs étonnant et regrettable de noter l’absence de ce champ théorique, pourtant très productif, dans le présent ouvrage.
De plus, les critiques qu’adresse F. Ouassak au féminisme vis-à-vis de la figure de la mère nous paraissent parfois confuses, notamment lorsqu’elle se désole que les féministes aient « certainement contribué à produire une culture politique qui tend à réduire les mères à leur statut de femme » (p. 195). En effet, le rôle de mère n’est-il pas intrinsèquement lié à la domination des femmes ? N’est-ce pas à partir de leur statut de femmes et de la division genrée des rôles qu’instaure la société patriarcale que s’est construit le statut de « mère » ? Que serait une mère qui n’appartiendrait pas à la catégorie femme ? N’est-ce pas à partir de critères essentialistes attribués à la féminité que s’est bâti le rôle de mère ?
Mais peut-être que le principal reproche de l’auteure aux féministes est d’avoir négligé les problématiques pratico-pratiques, matérielles, terre-à-terre de ces femmes au profit de la théorie (même si cela nous semble exagéré). Loin de théoriser la place de la mère dans le capitalisme, F. Ouassak s’attarde davantage sur les problèmes du quotidien qu’elle doit affronter, notamment avec ses enfants. Elle revendique une approche à l’écoute du terrain et de la réalité vécue par les mères, en particulier celles non-blanches vivants dans les « quartiers populaires » (nous reviendrons plus loin sur ce terme). De plus, F. Ouassak semble épouser une logique selon laquelle les problématiques principales des mères ne se situent pas seulement dans leur condition propre, mais sont intrinsèquement liées aussi à celles vécues par leurs enfants. C’est en ce sens-là que F. Ouassak se distingue. En accordant une place centrale à l’individu qui fait d’elle une mère : son enfant. C’est même dans cette relation mère/enfant que résiderait son caractère révolutionnaire. Aimant leurs enfants, inquiète pour leur avenir et cherchant le meilleur pour eux, elles seraient nécessairement poussées à changer le monde actuel.
Anticipant le reproche d’enfermer les mères dans le rôle qui leur serait dévolu (l’élevage des enfants), elle affirme très justement, que ce n’est pas elle qui fige ces rôles, mais qu’ils le sont déjà, et qu’elle préfère, avec pragmatisme, composer avec la réalité telle qu’elle est. Les femmes sont contraintes de s’occuper des tâches domestiques même si elles les contestent, et son livre n’est pas responsable de cet enfermement, il le constate. Dès lors, elle cherche à redonner à ces mères une plus grande visibilité et une place plus importante dans les luttes politiques, qui ne se limiteraient plus au foyer domestique.
Ainsi, F. Ouassak a pour projet de politiser le rôle de la mère. Le livre en est l’élément le plus théorique, mais elle s’est aussi attachée à mettre en pratique ce dessein. Afin de prouver que l’idée n’est pas utopique, elle montre que les mères des quartiers commencent à s’organiser dans des projets politiques à travers la présentation de plusieurs organisations qui agissent d’ores-et-déjà sur le terrain. Là où le bât blesse, c’est que ces trois organisations sont ses propres créations et qu’elle en est la principale cheville ouvrière. Reste que ces initiatives existent et qu’elles peuvent être le début d’un réel mouvement puisque F. Ouassak ne cache pas ses prétentions : se développer à l’échelle nationale, voire internationale.
Si nous ne pouvons que saluer cette volonté de politiser le statut de mère tout en lui donnant une place prépondérante, on ne peut que regretter que son objectif théorique ne soit pas mené à sa fin. Alors même que nous voudrions la suivre dans sa séduisante idée directrice, une fois la lecture du livre terminée un goût d’inachevé reste en bouche. En effet, une question nous taraude tant la démonstration parait bancale : en quoi la mère est-elle une figure révolutionnaire ? Et faut-il parler des mères en général ou de certaines mères ?
Il faut dire que le projet est (trop ?) ambitieux et, souffrant d’un manque de clarté théorique et politique, il tombe à plat. Le caractère révolutionnaire du livre nous laisse sceptique, tant par son fond conformiste que par ses propositions réformistes. Mais c’est surtout d’un point de vu antiraciste et décolonial qu’il pose problème. Présenté par certains comme une avancée pour la cause, il marque, au contraire, une véritable régression en procédant, d’une manière sophistiquée, à une disqualification de la lutte antiraciste. Nous allons tâcher, dans les lignes qui suivent, d’expliquer nos réserves et notre perplexité.
L’amour des mères est-il révolutionnaire ?
L’ambition de faire des mères le sujet révolutionnaire capable de changer le monde serait rendu possible par l’idée que les mères partageraient une inquiétude commune permettant de les unifier : l’inquiétude qu’elles auraient pour l’avenir de leurs enfants confrontés à de multiples dangers, de l’inégalité scolaire au chômage, jusqu’à la catastrophe climatique. C’est ici que résiderait l’élément principal permettant, d’après F. Ouassak, de parler d’un nouveau sujet révolutionnaire : les mères auraient un intérêt à construire un monde meilleur dans lequel leurs enfants pourraient s’épanouir. L’amour maternel serait donc au cœur du potentiel révolutionnaire, et l’élément moteur de la création d’un « nouveau sujet révolutionnaire ».
Le livre achevé, nous ne sommes guère convaincus par cette idée. Alors qu’elle nous promet un plaidoyer pour l’émergence d’un véritable sujet révolutionnaire, F. Ouassak semble zapper une étape pourtant primordiale : la démonstration de son caractère révolutionnaire. L’amour maternel comme argument principal n’est ni suffisant, ni acceptable pour valider le caractère révolutionnaire de la qualité de mère, et ce pour plusieurs raisons :
La première est que cette conception de l’amour maternel est essentialiste, voire naturaliste puisqu’elle postule que la mère serait naturellement (que ce soit par les lois de la nature ou de la biologie) amenée à aimer sa progéniture. Or, nombreux sont les exemples, que ce soit chez les humains ou chez les animaux, de mères n’éprouvant aucun d’amour pour leurs progénitures, voire même ayant des sentiments totalement contraires. Les raisons peuvent être très diverses : enfant non désiré, difficultés à accepter le rôle de mère, sentiment d’asservissement, personnalités fragiles, problèmes psychiques etc. Ou simplement le fait de vivre dans une période historique et/ou une société dans lesquelles « l’amour maternel » n’est pas une valeur sociale… Car oui, « l’amour maternel » comme nous l’entendons aujourd’hui n’est en rien inné, ni intrinsèque au statut de génitrice, mais bien une construction sociale. Et même une construction sociale relativement récente, qui coïncide avec la naissance de la Nation, première mère du peuple (d’où sa popularité dans les forces conservatrices). En d’autres termes, l’amour maternel dont nous parle F. Ouassak, et les formes qu’il prend, nous apparaît davantage être une conception moderne et occidentale (puisqu’elle prend forme dans le modèle familial nucléaire), et non une valeur universelle et transhistorique. Il est à noter d’ailleurs qu’une partie des féministes a revendiqué, en opposition à cette idée de la mère exemplaire et aimante, le statut de « mauvaise mère », comme une réponse en pied de nez à l’injonction à l’amour pour leurs enfants, valeur morale bien peu ancrée dans la matérialité des relations…
Toutefois, nous pourrions faire preuve de mansuétude et mettre entre parenthèses ce contre-argument en partant du présupposé que la conception moderne et occidentale de l’amour maternel soit devenu hégémonique, et donc universellement partagée par l’ensemble des mères du monde. La proposition de la mère comme sujet révolutionnaire n’en est pas plus satisfaisante car il manque un élément crucial : le partage d’intérêts communs. Nous touchons ici l’un des principaux obstacles au projet de l’auteure. Les mères du monde partagent-elles les mêmes intérêts ? Nous pouvons en douter. Pour que ce soit le cas, il faudrait que ces mères partagent aussi les mêmes caractéristiques sociales que ce soit en termes économiques ou raciaux. Ce qui n’est pas le cas, sauf à considérer la mère (et son enfant), comme une catégorie abstraite, transclasse et transraciale, une figure qui surpasse les stratifications sociales de toutes sortes. Nous tomberions alors dans un idéalisme naïf qui ne peut être accepté par une militante dont la prétention est de s’ancrer dans le concret et le terrain. La « mère » dont parle F. Ouassak est une figure qui n’existe que dans le monde des idées. Dans la réalité, la catégorie « mère » est extrêmement hétérogène, les mères sont aussi séparées entre elles par des frontières de classe et de race. Elles ne partagent qu’une caractéristique : celle d’avoir un enfant.
Ces différences empêchent de penser une catégorie sociale homogène de « mère ». Il en est de même de l’espoir, des exigences, des attentes qu’elles ont vis-à-vis de leurs enfants, sans oublier que ces derniers ne seront pas confrontés aux mêmes difficultés. Les mères ne prodigueront pas la même éducation, les mêmes valeurs, les mêmes codes et surtout les mêmes capitaux économiques et culturels à leurs enfants selon qu’elles seront riches ou pauvres. Par conséquent, ces derniers seront inégalement armés pour affronter le monde. Les mères sont confrontées à des problématiques et difficultés bien différentes selon leur identité de classe ou de race. De plus, la forme de l’amour qu’elles auraient toutes pour leurs enfants et le monde meilleur qu’elles rêveraient de construire pour eux seront alors fortement déterminés par leurs appartenances sociales. L’exemple de l’école, central dans le livre, en est une parfaite illustration. F. Ouassak souligne que les parents ont intérêt à investir l’école parce qu’elle reproduit les inégalités, et que leurs enfants y sont discriminés. Mais ce n’est pas le cas de tous les enfants. Toutes les mères ne voient pas leurs progénitures discriminées par l’institution scolaire. Seulement celles des catégories populaires et/ou non-Blanches. Les enfants des autres mères sont, eux, favorisés. L’investissement du monde scolaire par les parents donnera alors deux stratégies différentes : l’une promouvant le changement et l’égalité, l’autre défendant le statut-quo et la méritocratie.
Nous pouvons déjà cerner en quoi l’amour de ses enfants comme valeur au cœur du potentiel révolutionnaire pose problème : l’amour que porte les mères pour leurs enfants, et les façons dont elles l’expriment, le matérialise, est déterminé par leurs conditions extra-maternelles. Surtout dans une société capitaliste où le cadre scolaire favorise la compétition, cet amour des enfants les poussent quand elles en ont les moyens à favoriser leurs enfants. L’inégalité scolaire étant un avantage pour certaines d’entre elles, elles auront davantage intérêt à être les défenseuses de la légitimité du classement scolaire. L’amour des enfants amène donc les mères à adopter des stratégies diverses, contradictoires et même conflictuelles entres elles. Prenons de nouveau l’exemple de l’école : Dans son livre, F. Ouassak évoque la question des cartes scolaires et des parents de classe moyenne qui font tout pour la détourner afin que leurs enfants aillent dans des écoles plus huppées. Mais justement, cette stratégie mise en place par ces parents n’est-elle pas liée à l’amour qu’ils portent à leurs enfants ? La mère qui se bat pour inscrire sa progéniture dans une école de meilleure qualité n’est-elle pas en train d’exprimer l’amour qu’elle porte à son enfant, et de faire preuve de sa puissance de mère qui peut se démener et développer de multiples stratégies pour lui assurer le meilleur avenir possible ? D’ailleurs, les mères des classes populaires n’emprunteraient-elle pas les mêmes stratégies si elles en avaient les moyens ? Nous pourrions le penser, d’autant plus lorsqu’on sait que les groupes subalternes ne sont pas imperméables à l’idéologie dominante. Sinon il serait impossible de comprendre la prégnance du mythe de l’école égalitaire et l’adhésion à l’idée de méritocratie dans ces milieux.
Certes, certains pourraient nous rétorquer que F. Ouassak parle plus spécifiquement des mères des quartiers populaires (et non-blanches). Effectivement, elle en parle, puisqu’elles sont les plus dominées. Toutefois, elle manque de clarté sur leur identité de sujet révolutionnaire. Elle postule que toutes les mères ont une puissance révolutionnaire : « Mères du monde entier, liées par notre amour de mères, liés par notre amour entre mères, unissons-nous pour reprendre le pouvoir qui nous a été confisqué, et prendre le pouvoir politique ! » (p. 251). Si les principaux exemples cités concernent les mères « des quartiers populaires », son projet ne s’adresse pas à elles seules, mais à toutes les mères. Le flou entre « la mère », et « les mères des quartiers populaires » est sans cesse entretenu tout le long du livre, sûrement pour faire tenir debout sa théorie de « la mère » comme sujet révolutionnaire tout en l’illustrant par des exemples de mères des quartiers d’immigration. Seulement, cette combine ne peut résister à une analyse sérieuse, car au bout de ce processus c’est bien la figure abstraite de la mère qu’elle présente comme dénominateur commun de la lutte révolutionnaire. Refusant de choisir et de circonscrire, elle rend son projet caduc, mais surtout affaiblit la cause anti-raciste.
Invisibilisation (sophistiquée) de l’anti-racisme
Ouassak parait tiraillée dans cette paradoxale volonté de faire de la figure de la mère un acteur révolutionnaire tout en se faisant la porte-parole des mères indigènes. Ce paradoxe se voit notamment dans sa difficulté à aborder la question raciale de front et à la noyer dans une sémantique économiciste (qu’elle nomme « sociale »), moins clivante. Elle ne cesse alors de multiplier les gages de bonne volonté, en assurant ne pas vouloir se noyer dans la question « identitaire » et « raciale » en favorisant la question « sociale » (p. 247) – perpétuant ainsi l’idée que la race ne serait pas une question sociale (que serait elle alors ?). On pourrait nous opposer que c’est faux, que F. Ouassak aborde abondamment la question du racisme en centrant le propos sur la condition des mères des quartiers or c’est là que se joue l’insidieuse relégation de la question raciale. Elle opère sur plusieurs plans, entretenant un flou constant qui donne l’impression de parler de racisme tout en évitant de trop en parler, c’est-à-dire en respectant la limite imposée par une certaine gauche blanche à laquelle l’auteure semble vouloir donner des gages.
Nous pouvons déjà nous arrêter quelques instants sur le terme « quartiers populaires » usée jusqu’à la moelle et qui a pour effet pervers d’euphémiser la question raciale. Nous avons déjà abordé dans un autre article les raisons pour lesquelles cette formule posait problème[4], il est tout de même utile d’y revenir ici car l’usage qu’en fait F. Ouassak est symptomatique du prisme « quartierisme ». Le terme « quartier populaire », maintenant devenu la norme dans le langage de la gauche mais aussi dans l’antiracisme gauchisant, est un qualificatif commode pour minorer la question raciale tout en feignant d’en parler. En effet, dire d’une personne qu’elle est « des quartiers populaires », est la nouvelle façon de sous-entendre qu’elle est non-Blanche. Cette pirouette est pratique pour la gauche et ses alliés, puisqu’elle donne l’impression de parler de race, tout en centrant sur la question dite « sociale », sur le paradigme de la classe. Car « quartiers populaires » renvoient davantage à leurs conditions économiques, voire leur situation géographique plutôt que raciale. Même s’il est clair que les sujets sont les Noirs et des Arabes, nous comprenons que la priorité est donnée à la lecture de classe.
Du point de vue de l’antiracisme politique, cette dénomination est simplement nuisible : à la fois elle minore la race et en même temps la circonscrit à un territoire géographique, comme si tous les non-Blancs vivaient dans ces zones, et comme si la discrimination n’était liée qu’à l’appartenance à ces territoires paupérisés et stigmatisés. Alors même que, comme le rappelle Abdelmalek Sayad[5], si ces territoires sont stigmatisés c’est parce qu’il sont habités et occupés par des individus racialisés négativement : les indigènes. Chez F. Ouassak cette tare est particulièrement prégnante, autant dans son livre que dans ses interviews. Alors qu’elle nous livre durant de longues pages le descriptif des discriminations proprement racistes dont sont victimes les mamans indigènes, elle explique que ce sont des discriminations vécues par les parents vivant dans « les quartiers populaires ». Mais est-ce réellement parce qu’elles habitent ces quartiers que ces femmes subissent des remarques racistes, que ce soit sur leur voile, leur supposé situation de polygamie ou leur propension à faire trop d’enfants ? Ou que leurs enfants subissent des discriminations à l’école ou sur le marché du travail ? Quand, au début du livre, elle nous livre l’expérience de ces mères invitées à retourner en Afrique (p. 13) si elles ne sont pas satisfaites de l’école publique, n’est-ce pas plutôt en raison de ce qu’elles sont plutôt que de l’endroit où elles habitent ? Une personne blanche habitant dans les quartiers subit-elle le même genre de remarque ? Ces expériences sont-elles partagées indifféremment par tous les « habitants des quartiers populaires », ou seulement par les non-Blancs ? Cette substitution de leur identité raciale par l’identité territoriale, masquant les raisons profondes de leur discrimination, atteindra un point culminant chez F. Ouassak dans une interview ou elle préfèrera parler « d’effet quartier »[6] pour parler des discriminations subies par les indigènes plutôt que de racisme.
Cependant, l’abandon de la question raciale par l’auteure est parfois plus direct. C’est le cas lorsqu’elle précise, à plusieurs reprises, qu’elle est contre les politiques identitaires et qu’elle ne veut pas se limiter à la question raciale. Elle avoue même que « les accusations de « communautarisme » [les] ont obligées à aller vers les propositions politiques les plus consensuelles et l’approche la plus universelle possible ». Nous sommes donc face à une proposition « révolutionnaire », qui plie devant l’injonction de la gauche de conformer la figure de la mère à « l’universalisme ». Une recherche du consensus, ou plutôt de l’approbation de la gauche, qui la conduit à nous expliquer qu’elle a « mille identités différentes par jour » tout comme ses enfants « ont mille identités différentes par jour » (p. 173), que ses enfants doivent « jongler avec leurs identités » (p. 172), mais que « le plus important c’est que nous aimons nos enfants et qu’ils se savent aimés » (p.173). Ayant du mal à comprendre l’enchainement entre les milles identités de ces enfants et l’amour qu’on leur porte, et surtout ce qu’elle entend par « identité », nous pourrions toutefois rappeler à F. Ouassak que l’important n’est pas tant le nombre d’identités qu’elle et ses enfants peuvent avoir, mais celle(s) à laquelle (auxquelles) ils sont automatiquement renvoyés. Un Noir et un Arabe peuvent bien être des individus pluriels, leur identité raciale reste déterminante. Elle impacte d’une manière prépondérante leur vie et la manière dont ils s’identifient. Il ne faut pas « nous enfermer dans des identités », prévient-elle, et ne pas « contribuer à ce culturalisme ambiant et revenir à la question sociale» (p. 174), avalisant par-là l’opinion des « anti-racialistes » de gauche comme Stéphane Beaud et Gérard Noiriel[7]. Ainsi, là où il faudrait s’interroger sur la responsabilité des institutions qui enferment ces femmes, F. Ouassak préfère croire au mythe d’un choix volontariste qui refuserait crânement l’enfermement. « Yes we can ! ».
La figure de la Mère, un universalisme abstrait
Afin d’éviter de se voir cataloguée comme « communautariste », « racialiste », voire pire, « indigéniste », F. Ouassak tombe dans un universalisme abstrait. Alors que tous les exemples de son livre évoquent les oppressions vécues par les mères indigènes, elle n’économise pas ses efforts pour défendre la figure de la « mère » comme si celle-ci appartenait à un groupe homogène. Il faut dire qu’elle est face à un dilemme : faire un choix « communautariste » en s’adressant avant tout aux mères indigènes, ou celui de « l’universalisme » en s’adressant à toutes les mères, avec le risque de perdre son caractère subversif. Devant cette impasse pratique et théorique qui semble insoluble: « la mère » abstraite aimant son enfant ou « la mère » des cités d’immigration, celle qui aura le plus intérêt à un changement social, F. Ouassak semble préférer sauver son concept qu’elle pense innovant, original, mais aussi unificateur et consensuel. Dit autrement, elle fait le choix d’un projet politique « blanc », intégrationniste et libéral (écologie, bienveillance, modèles positifs, progressiste, etc.), très loin de sa promesse révolutionnaire :
« C’est dans la lutte que nous avons refusé d’être réduite à des mères arabes, noire ou musulmanes. Nous sommes des mères. Nous sommes des sujets politiques. Et nous menons une lutte universelle. » (p. 71). Ce passage, qui pourrait être le condensé de la trame du livre, illustre à la perfection cet abandon de la question raciale, au profit d’une image plus « universelle ». Au demeurant, si nous la suivons dans sa logique, c’est aussi un abandon de la lutte de classe – ou de la question « sociale » pour reprendre ses termes – car l’universalisme qu’elle prône devrait aussi la pousser à refuser d’être « réduites » à des mères de quartiers populaires. Au lieu de refuser cette « réduction », F. Ouassak devrait plutôt se demander comment être arabe/noire/musulmane/précaire questionne les théories féministes et le rôle de mère, quels modèles alternatifs cela peut engendrer, quelles propositions alternatives ces expériences peuvent-elles apporter aux enjeux reproductifs et éducatifs. Au lieu de cela, elle cède de manière déroutante à l’universalisme abstrait.
Comme nous l’avons vu, ce ne sont pas toutes les mères qui ont véritablement intérêt à changer les choses, à s’inscrire dans une perspective révolutionnaire, mais celles des catégories populaires et non-blanches. Ainsi, nous pouvons nous poser une question éminemment importante : l’émergence de la catégorie de “mère” en tant que sujet politique est-elle utile et pertinente? Si tel était le cas, toutes les mères, sans distinction d’appartenance sociale se sentiraient concernées par les problématiques des mères indigènes. En d’autres termes, n’est-ce pas en tant que non-blanches et/ou prolétaires qu’elles sont opprimées plutôt qu’en tant que mères?
Or, F. Ouassak elle-même se concentre sur les mères des quartiers d’immigration. Ce sont elles qui sont dans les situations les plus précaires, les plus stigmatisées, les plus discriminées et dont les enfants connaissent les plus grandes difficultés. Il faut le souligner : l’identité de mère n’est pas centrale ici. Elle n’est pas superflue, car il y a effectivement quelque chose d’important qui se joue autour de ce statut cependant c’est secondaire. Les mères immigrées sont effectivement au « croisement » de « plusieurs oppressions », si on devait parler comme les féministes intersectionnelles. Leur appartenance de classe (populaire), de race (non-Blanche) et de genre (femme) ont une incidence sur les oppressions qu’elles subissent et sur la façon d’aborder et de vivre le rôle de mère. Toutefois, il serait erroné de tomber dans une vision abstraite de cette « intersection » des oppressions. Lorsque nous lisons La Puissance des Mères, nous pouvons observer que le déterminant principal de leur condition n’est pas tant leur rôle de mère (ou de femme) ou leur appartenance de classe, mais bien leur appartenance raciale, leur statut d’Indigène. Certes, ce n’est pas « purement » la seule question « raciale » (ça ne l’est jamais), mais c’est l’élément principal. Elles vivent le racisme en tant que mère, mais ce n’est pas le rôle de mère qui explique le racisme qu’elles subissent. Toutes les formes de stigmatisations identifiées par F. Ouassak tournent autour des préjugés raciaux, que ce soit la propreté des enfants, ou le laxisme des parents. D’ailleurs, l’exemple qu’elle donne sur le soupçon de communautarisme dont elle est elle-même victime lorsqu’elle aborde l’enjeu des plats végétariens à la cantine est lui-même l’illustration que le stigmate déterminant qui pèse sur elle est racial. Elle n’aurait pas reçu ce genre de remarque si elle avait été une mère blanche, quand bien même elle habiterait un quartier. Etant donné la pression, on comprend mieux le choix des plats végétariens plutôt que halals…
A partir de là, nous pouvons nous interroger sur l’enthousiasme avec lequel ce livre a été reçu par le milieu antiraciste, tant il marque pour nous un véritable recul puisque, tout en feignant d’en parler, il place la race au second plan, voire prend ses distances avec les analyses « trop » portées sur la question raciale, ou « identitaire ». Car, cette relégation de la question antiraciste porte non seulement sur l’euphémisation de la sémantique décoloniale, mais aussi sur l’effacement de toute allusion à la théorie et aux luttes antiracistes. Alors qu’il paraît évident que ces personnes sont confrontées à des problématiques avant tout raciales, F. Ouassak nous propose, comme « outils de libération » le « féminisme et l’écologie » (p. 170). Nous ne pouvons qu’être tristement étonnés. En quoi le féminisme ou l’écologie peuvent-ils être une solution lorsque ces mères sont accusées de communautarisme ou d’islamisme ? Alors qu’elle accusait les féministes de réduire les mères à leur statut de femme, n’est-elle pas elle-même en train de faire exactement la même chose ?
L’auteure assure que, malgré le prix que cela coute, elle refuse « radicalement les injonctions à mettre de côté la question raciale » (p. 246), mais force est de constater que les actes ne suivent pas les paroles. Cette question est sacrifiée pour des causes plus consensuelles, comme l’écologie, dont elle affirme, sans sourciller, qu’il est un combat que « les mères des quartiers populaires, et derrière elles tous les habitants des quartiers populaires, ont tout intérêt à mobiliser pleinement », car c’est un « outil de libération qui répond le mieux aux inégalités et aux injustices que subissent nos enfants, et qui portent le mieux nos aspirations et nos espoirs » (p. 236). L’écologie voie de libération que les indigènes devraient favoriser car la plus efficace pour lutter contre les discriminations subies ? Il fallait l’oser. Alors qu’il apparaît clairement que les mères décrites souffrent de racisme, et qu’elles auraient tout intérêt à s’identifier avant tout comme femmes non-Blanches des quartiers, F. Ouassak procède à un renversement de la réalité en écartant les rugosités sociales et en faisant le choix de la catégorie « mère », somme toute assez inoffensive. Elle se sent alors autorisée à plaider pour une union de toutes les mères, ce qui implique nécessairement, en l’absence d’un propos clair sur la question, les mères Blanches et/ou bourgeoises.
Un projet qui n’a de révolutionnaire que le nom
La décevante différence entre les annonces et la réalité se retrouve aussi dans la promesse d’un projet politique révolutionnaire que nous ne pouvons que mettre en doute. L’auteure semble plutôt faire partie de ces nombreux sociaux-démocrates qui s’accaparent le mot « révolution » pour donner un vernis séditieux à leurs propos mais en en retirant la substance. Sa fixation sur l’investissement des parents dans l’école est l’un des exemples de cette limite. Seulement cinquante ans après P. Bourdieu et J-C. Passeron, elle nous apprend que le système scolaire est inégalitaire puisqu’il défavorise les classes populaires, voire même que l’école favoriserait la reproduction sociale. F. Ouassak affirme ainsi que la discrimination subie à l’école par « nos enfants » (lesquels ?) a une fonction, celle de les préparer à occuper les postes les plus précaires mais, contrairement aux deux sociologues, elle limite cette discrimination à un simple conditionnement idéologique les préparant à accepter ce destin de dominés. Le problème réside donc dans une « réduction du champ des possibles » qu’il faudrait alors élargir, en redonnant à ces enfants une confiance en soi et en les persuadant qu’ils peuvent, eux aussi, réussir. Une perspective dangereuse puisqu’elle fait fi des conditions matérielles empêchant les enfants indigènes et/ou des catégories populaires de réussir à l’école, puisqu’elle fait reposer cela sur une question de motivation et donc de méritocratie. Peut-être est-ce le cas pour des enfants de politologue, mais en ce qui concerne ceux des classes populaires leur sort est lié à leur faible capital économique et culturel ce qui les condamne d’avance lorsqu’ils seront confrontés à la compétition scolaire.
Une vision faussée et conformiste, l’amenant à faire des propositions tout aussi limitées et peu révolutionnaires, puisqu’elle ne demande, grosso modo, qu’une plus grande égalité au sein de l’école, mais pour y parvenir elle reste cantonnée au simple cadre scolaire ce qui rend ses propositions inefficaces. En effet, d’après elle, il faudrait que les mamans investissent l’école afin d’enrailler le dysfonctionnement qui explique l’échec scolaire. Mais encore fait-il considérer ce fonctionnement comme un dysfonctionnement. En effet, la fonction même de l’école dans le cadre capitaliste est de procéder à une hiérarchisation, un tri et, au bout de la chaine, à une reproduction des inégalités. F. Ouassak voudrait que l’école « retrouve » la mission émancipatrice qui serait la sienne, permettant à chacun d’apprendre et de s’épanouir, avec une vraie égalité. Une telle école a-t-elle jamais existé ? Quant à ces idéaux d’émancipation, ils sont ceux prônés par les classes dirigeantes pour légitimer un fonctionnement inégalitaire, une vision méritocratique dans laquelle l’école, par essence égalitaire, permettrait aux meilleurs de réussir quelles que soient leurs origines sociales. Une blague.
Que les mamans des classes populaires investissent l’école de leurs enfants pour favoriser une plus grande égalité pourra, peut-être, permettre que leurs enfants bénéficient d’un traitement plus juste. Dans le meilleur des scénarii, fortement improbable, ce combat pourrait permettre que les élèves aujourd’hui défavorisés à l’école – les classes populaires et les non-Blancs -, échappent à leur destin. Pour autant, ce ne serait pas la fin d’un système scolaire inégalitaire, puisque, la fonction de l’école reste structurellement la même. « Mais l’école est importante aussi parce qu’elle peut devenir une immense machine à produire de l’égalité, nous dit F. Ouassak, si nous parvenons à l’arracher des mains de la classe dominante et si nous l’investissons » (p. 110), or nous ne voyons pas comment le système scolaire pourrait devenir une machine à produire de l’égalité au sein d’une société foncièrement inégalitaire, et nous parvenons encore moins à voir comment il serait possible d’arracher l’école à la « classe dominante » en restant cantonné au cadre scolaire. Si l’objectif est que les mamans changent l’école, alors le combat se déroule également en dehors de l’école. En l’occurrence, le projet de F. Oussak ressemble davantage à un syndicat de parents d’élèves un peu plus à gauche que la moyenne plutôt qu’à une organisation à vocation révolutionnaire.
Ce n’est cependant pas seulement sur le thème de l’école que nous mettons en doute le caractère révolutionnaire du livre, puisque le doute pèse aussi sur le sujet principal de l’essai, son cœur palpitant. F. Ouassak veut en effet repenser le rôle de la mère dans la politique. Soit. Mais en restant toujours dans le cadre préconstruit de la famille nucléaire, de la famille moderne occidentale. Jamais dans son livre, elle n’invite à repenser à la famille au-delà de ce modèle. Elle ne conçoit la mère que comme une simple filiation entre la femme et sa propre progéniture. Nous l’avons déjà relevé, l’instrumentalisation politique de la mère est une pratique majoritairement de droite. Ce conservatisme autour de la mère (qui n’est pas seulement une construction idéologique, mais se retrouve aussi dans les pratiques des mères elles-mêmes[8]) a plusieurs explications, de son lien avec la naissance de la Nation à son instrumentalisation par l’Eglise, en passant par sa fonction dans le développement du capitalisme. Tous favorisent un modèle familial qui se résume à un couple et des enfants. Le fait est que F. Ouassak ne prend jamais en considération cet état de fait. Certes, elle souhaite s’inscrire dans une perspective plus « pratique » en organisant ces mères « sur le terrain ». Mais son ambition « révolutionnaire » ne peut aboutir si elle reste bloquée dans cette conception de la mère et de la famille, dont la force résiderait dans son lien avec son ou ses enfants, renforçant ainsi le modèle du foyer nucléaire privé si cher au système capitaliste et à l’Etat-Nation comme l’ont démontré les analyses marxistes et décoloniales. Il faut ajouter à cette précision que ce que tient l’auteure du livre pour une évidence, à savoir le potentiel révolutionnaire de la mère, est loin d’en être une. La mère est une figure largement exploitée par la droite et l’extrême-droite. Aux Etats-Unis, par exemple, la mère va de paire avec l’image de la famille traditionnelle et conservatrice, et nombreuses sont les mères de familles blanches ayant voté pour Trump en 2016, et ce toujours par amour pour leurs enfants.
Puisqu’elle s’inscrit dans le féminisme, nous pourrions lui rappeler que cette remise en cause du modèle familial actuel est courante dans ce champ, proposant d’autres alternatives, d’Alexandra Kollontaï qui imaginait que le soviétisme allait conduire inexorablement à la dissolution de la famille car elle n’aurait plus pour fonction de préserver la richesse et que l’Etat se chargerait des obligations qui étaient jadis dévolues à la mère, jusqu’à plus récemment Sophie Lewis et son « féminisme utopique », qui invite à imaginer d’autres formes de modèles familiaux au-delà du cadre capitaliste et hétéronormatif, en passant notamment par la reconnaissance du travail de gestation dans une perspective semi-cynique permettant de court-circuiter la logique de la société salariale. Car réfléchir sur le rôle de la mère conduit nécessairement à réfléchir sur le rôle de la famille et de son modèle.
Mère et famille chez les décoloniaux
Contrairement à F. Ouassak, il nous apparaît évident que les problématiques que rencontrent ces mères sont avant tout raciales, et doivent donc être traitées à travers une dialectique antiraciste. Est-ce à dire alors que le sort des mères doit nous désintéresser ? Non. Mais nous devons l’aborder d’une autre manière. Tout d’abord en délimitant bien la catégorie « mère » et en prenant le chemin inverse de celui emprunté par l’auteure qui refuse d’être « réduite à des mères arabes, noire ou musulmanes » au nom de « l’universalisme » de la mère. Nous devons assumer que ces mères sont opprimées parce qu’Arabes, Noires et/ou Musulmanes, et qu’elles ne peuvent pas décider de l’éluder. Ce n’est pas la figure abstraite de la « mère » que nous devons défendre, mais une partie particulière de celles qui la composent : les mères indigènes. Certes, toutes les mères subissent une forme d’oppression si l’on se focalise sur la question du genre, car elles se voient renvoyer à leur fonction d’élevage et aux tâches domestiques, toutefois, comme le souligne F. Ouassak, il s’agit davantage d’avoir une approche pragmatique en tentant de (re)donner un rôle politique aux mères, plutôt que de déconstruire cette figure. En suivant cette optique, les mères les plus discriminées, stigmatisées, précarisées, qui voient leurs enfants subir le même sort, et qui sont donc les plus susceptibles de vouloir changer les choses, ne sont autres que les mères indigènes.
Avons-nous, nous décoloniaux, notre mot à dire sur ces questions ? Que ce soit autour du rôle de la mère et plus largement de la famille ? Sommes-nous capables de proposer des alternatives au modèle familial moderne et occidental ? Les luttes de l’immigration, dont se revendique à plusieurs reprises F. Ouassak en les limitant au cadre mémoriel, peuvent-elles nous permettre d’apposer un regard innovant ? Il nous semble que oui. Il peut exister une réponse décoloniale à la famille nucléaire, qui s’inspirerait des modèles familiaux précoloniaux mais aussi du Sud actuel, sans pour autant fantasmer un retour au passé, ni même tomber dans une condamnation trop sévère de la famille dans son ensemble comme sphère foncièrement oppressive. Cette proposition pourrait se traduire par la formule suivante : abolir la famille en élargissant la famille.
Le talon d’Achille de la proposition révolutionnaire de F. Ouassak repose essentiellement sur l’amour des mères pour leurs enfants, mais celle-ci se limite à la simple filiation directe mère-enfant, voir parents-enfants. En prenant les mêmes acteurs, c’est-à-dire les mères indigènes, et en s’inspirant de certains modèles familiaux du sud plus larges, une perspective décoloniale pour proposer, par exemple, que ces femmes ne soient pas les mères de leurs seuls enfants, mais de tous les enfants indigènes. Nous éclaterions le cadre de la famille nucléaire privée en faisant que les mères indigènes se sentent responsables de tous les enfants indigènes, et vice-versa. Le lien de solidarité familial s’étendrait ainsi à la communauté. Elles seraient les mères de tous les enfants indigènes, et nous serions les enfants de toutes les mères indigènes. Ainsi, ce serait la cause de tous les enfants indigènes que voudraient défendre ces mères, et non pas seulement les leurs. Et pas spécialement par « amour », mais parce que faisant partie de la même communauté, elles se sentiraient responsables du sort de chacun, comme nous nous sentirions responsables du sort de chacun de nos ainés. Ce qui nous conduirait aussi à repenser le rôle qui est généralement dévolu aux mères, aux tâches domestiques qui leurs sont assignées. Cet élargissement de la famille doit nous amener à imaginer une autre répartition de ces tâches, en faisant appel, par exemple, à une participation plus active des pères, des frères, des oncles, des sœurs, des tantes, des cousins et cousines etc. dans l’élevage de nos cadets.
Pour parvenir à cet objectif, il faudrait surmonter une accusation que craignent beaucoup de sociaux-démocrates : celle de communautarisme. Assumons là. Oui, nous sommes une communauté, nous devons nous sentir liés et c’est déjà le cas, notamment, par exemple, dans le modèle de la Oumma dans lequel les musulmans sont tous des frères et sœurs. La communauté dont nous parlons ici ne repose pas sur un lien biologique, ou culturel, mais sur une condition commune d’indigènes, de dominés face la discrimination raciale et économique. Et cette famille communautaire n’est pas fermée, ses frontières sont souples, floues et fluides, comme le sont déjà les familles indigènes où les oncles, les tantes, les cousins peuvent s’élargir au-delà des règles strictes de filiation. Par conséquent, dans cette communauté familiale sont les bienvenues non seulement les personnes qui partagent les mêmes conditions, mais aussi celles qui souhaitent en faire partie. C’est dans cette perspective, nous semble-t-il, que les mères indigènes peuvent réellement être révolutionnaire dans le plein sens du terme. Une piste que les mamans de Mantes-La-Jolie, à travers le Collectif de Défense des Jeunes du Mantois – que Fatima Ouassak oublie étrangement de citer, alors qu’il s’inscrit clairement dans le projet qu’elle souhaite mettre en avant puisqu’il s’agit d’une auto-organisation de mères de quartiers populaires menant leur combat au nom de l’amour de leurs enfants « qui sont aussi nos enfants à tous »[9], et qu’elles relient le sort à l’ensemble de la domination raciale et impérialiste qui s’exerce à Mantes-La-Jolie mais aussi partout dans le monde.
Les réceptions dithyrambiques de ce livre nous interrogent. Si nous avons insisté davantage dans ce papier sur les carences les plus flagrantes en termes antiracistes, nous pensons aussi, quitte à ne pas respecter la sacro-sainte loi du « premier concerné », que son livre pêche tout autant du point de vue féministe. Il serait intéressant d’analyser les raisons pour lesquelles un livre tel que celui-ci, qui n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, bénéficie d’une telle mansuétude, autant dans la presse institutionnelle que dans les milieux anti-racistes et féministes se déclarant radicaux. Est-ce dû à un déficit en termes de culture théorique, ou alors à une bienveillance partagée et intéressée dans ce petit milieu qu’est la gauche « radicale » ? Reste que, pour revenir au livre en lui-même, les promesses réjouissantes ne sont malheureusement pas tenues, et nous finissons la lecture non pas seulement avec un goût d’inachevé, mais avec la sensation amère que la race, pourtant centrale, a été sacrifiée, pour ne pas dire sabotée.
A la fin du livre F. Ouassak déclare qu’« il faut une offre politique véritablement révolutionnaire » (p. 241). La démonstration n’est hélas pas faite. Nous considérons cependant ce vœu comme une invitation à creuser cette voie mais avec une approche plus décoloniale (intégrant aussi une lecture sérieuse des apports du féminisme matérialiste) qui pourrait ouvrir des perspectives bien plus enthousiasmantes et bien plus…révolutionnaires.
[1] Pour être plus précis, il existe des analyses féministes sur le rôle de la mère selon leur situation sociale, analyses qui peuvent permettre une politisation de ce rôle. Nous pouvons aussi trouver ces questionnements dans les écrits autour du « care », ou dans l’écoféminisme. Il est d’ailleurs intéressant de noter l’absence de références à ces travaux dans ce livre, Fatima Ouassak faisant comme si elle écrivait un nouveau chapitre dans l’histoire de la théorie féministe. Nous y reviendrons
[2] A titre d’exemple : Cardi Coline, Odier Lorraine, Villani Michela, Vorazi Anne-Sophie, « Penser les maternités d’un point de vue féminsite », Genre, sexualité & société, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2016, Maternités : https://journals.openedition.org/gss/3917
[3] Parler d’« élevage » peut surprendre, mais nous reprenons ici les termes utilisés par des féministes matérialistes, comme Christine Delphy. A travers ce terme elles insistent sur le caractère productif de cette fonction attribué aux femmes dans les sociétés capitalistes et patriarcales.
[4] http://indigenes-republique.fr/quartiers-populaires-et-gilets-jaunes-memes-galeres-meme-combat/
[5] Sayad Abdelmalek, La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Editions du Seuil, Paris, 1999. p. 365
[6] https://www.telerama.fr/enfants/lutter-avec-les-meres-contre-leffet-quartier-le-combat-de-fatima-ouassak-6767893.php
[7] https://www.monde-diplomatique.fr/2021/01/BEAUD/62661
[8] Nous pouvons citer en exemple l’ouvrage d’Olivier Schwartz, Le Monde privé des ouvriers, où il montre le rôle joué par les mères ouvrières dans la construction d’une masculinité virile chez leurs enfants.
[9] http://indigenes-republique.fr/pour-une-politique-de-la-maman/