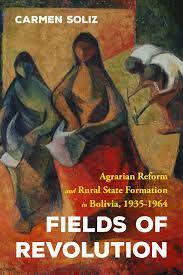À propos de : Carmen Soliz, Fields of Revolution. Agrarian Reform and Rural State Formation in Bolivia, 1935-1964, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2021.
Carmen Soliz est Maîtresse de conférences en histoire de l’Amérique latine à l’université de Caroline du Nord. Dans Fields of Revolution, elle revient sur un cas majeur de réforme agraire en Amérique latine, qui a été l’une des politiques les plus importantes à émerger de la révolution bolivienne de 1952. Elle revient, pour le QG Décolonial, sur certaines des idées majeures de son livre.
- La révolution bolivienne s’est faite dans un contexte plus vaste de changements sociaux en Amérique latine (Guatemala, Cuba, Pérou, Chili) entre les années 1950 et les années 1970. La question de la transformation agraire était centrale dans ces transformations sociales. En quel sens la révolution bolivienne était-elle spécifique concernant la transformation agraire ?
La révolution bolivienne a été un processus politique assez inhabituel en ce qui concerne l’Amérique latine. Elle était aussi profonde et ambitieuse que la révolution mexicaine, pourtant sa réforme agraire n’a pas pris des décennies pour être mise en œuvre, comme ce fut le cas pour le Mexique. La distribution, de fait, des terres paysannes a débuté un an après la Révolution nationale de 1952 et a rapidement pris de la vitesse. La Révolution bolivienne s’est faite concomitamment à la mise en œuvre, par le président du Guatemala Jacobo Arbenz, d’un programme similaire de réforme agraire. Mais contrairement à la révolution guatémaltèque, la Révolution bolivienne n’a pas été renversée par des opérations dissimulées de la CIA. Elle a précédé la Révolution cubaine de sept ans seulement, mais le MNR s’est ouvertement tenu à distance de l’Union soviétique. La réforme agraire bolivienne était tout aussi radicale que les réformes menées par Salvador Allende au Chili en 1970, pourtant, ce à quoi elle est parvenue en termes de redistribution des terres sur les hauts-plateaux et dans les plaines n’a jamais été défait par la réaction conservatrice, comme dans ces pays.
Les transformations du régime foncier et du pouvoir, qui ont débuté en 1952, continuent de façonner la politique contemporaine bolivienne, ce qui fait de ce pays un exemple unique en Amérique latine. La révolution et la réforme agraire ont engendré une profonde démocratisation de l’appareil d’État, l’érosion des méthodes formelles et informelles de pouvoir des propriétaires terriens et l’expropriation de centaines d’haciendas dans les zones les plus densément peuplées du pays (les hauts-plateaux, les plaines et l’écorégion subtropicale de Yungas). Contrairement à d’autres pays d’Amérique latine, comme le Guatemala et le Chili, les régimes militaires réactionnaires n’ont pas osé saper ces conquêtes. Les régimes civils et militaires successifs qui ont suivi le renversement du MNR en 1964 ont cherché à sceller leur alliance avec la paysannerie afin de sécuriser leur propre stabilité politique. À la fin des années 1990, lorsque l’influence de la Central Obrera Boliviana (COB), la Fédération d’ouvriers boliviens, jadis puissante, disparut et que le système traditionnel de parti s’est effondré, le contrôle territorial que les syndicats paysans avaient dans les campagnes leur a assuré un rayonnement national. Ces syndicats paysans ont constitué l’un des plus importants facteurs du refaçonnement du rapport de pouvoir politique dans la nation à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Il est impossible de comprendre l’émergence surprenante d’Evo Morales et le poids politique continu des paysans dans la politique aujourd’hui sans remonter aux racines de cette transformation radicale.
La force contemporaine des mouvements indigènes et paysans en Bolivie découle des rapports particuliers qui se sont développés entre ces communautés et l’État après 1952. Le contrôle territorial effectif que les communautés paysannes et indiennes se sont assuré sur les hauts plateaux et les plaines leur a permis d’avoir une influence politique dans ces régions. L’accès à la terre a donné aux paysans l’accès au pouvoir, comme le suggère l’œuvre classique de Barrington Moore. Jusqu’à aujourd’hui, le soutien politique des syndicats paysans demeure un facteur clé de tout parti politique ou candidat pour se maintenir au pouvoir au niveau national. Une organisation politique par en bas si dense permet d’expliquer l’émergence de dirigeants comme Evo Morales, le premier président indigène de Bolivie. Dans une grande partie de l’Amérique latine, les voix indigènes ont été marginalisées ou n’ont joué qu’un rôle mineur dans la politique nationale. En Bolivie, les mouvements indigènes ont été au cœur de la politique nationale. Ce ne sont pas seulement des alliés des partis politiques progressifs, comme dans le cas de l’Équateur, c’est l’inverse.
- Quel est l’état actuel de l’historiographie sur la révolution bolivienne ? Notamment en ce qui concerne le rôle que la paysannerie a joué dans la révolution, ainsi que le rôle joué par le Moviemiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Le regard porté par les chercheurs sur la révolution et sur la réforme agraire a largement évolué au cours des sept dernières décennies. Dans les années 1950, le MNR contrôlait le récit sur la révolution et la réforme agraire. Le MNR a diffusé l’idée que le parti était la force majeure de transformation dans les campagnes. Cela suggérait que les paysans étaient les bénéficiaires passifs et reconnaissants de la réforme agraire. Les officiels du parti affirmaient que, bien que la nationalisation des mines ait été un produit de la vaste mobilisation des mineurs, les paysans avaient reçu leur terre presque sans combattre. Le MNR a utilisé un fort appareil multimédia (journaux, brochures, statistiques, peintures murales et vidéos) afin de renforcer cette description verticale de la réforme agraire. Cette représentation a façonné la réforme agraire durant des décennies. Faisant écho à cette vision, le politiste américain Robert Alexander a écrit l’une des premières descriptions de la révolution bolivienne en anglais. Il affirme que le leadership du MNR était indubitable : « Pour la première fois, les Indiens avaient un protecteur de leurs intérêts[1]. »
Contre cette vision, à la fin des années 1950, Richard Patch a affirmé que la réforme agraire ne résultait pas de l’initiative du gouvernement, mais plutôt de l’intense pression sociale provoquée par les syndicats auto-organisés dans les vallées de Cochabamba où, immédiatement après la révolution, les paysans ont commencé à se saisir de grandes propriétés. Ce mouvement s’est rapidement propagé à travers les vallées, forçant le gouvernement à décréter une réforme agraire un an après que le MNR ait pris le pouvoir[2]. De l’autre côté, le travail comparatif des anthropologues Dwight Heath, Charles Erasmus et Hans Buechler avance que : « L’idée de la réforme agraire de Bolivie comme ayant été le produit d’actions populaires de la part de la majorité indienne illettrée ne tient pas[3]. » Ces auteurs affirment que les paysans n’ont commencé à s’organiser politiquement que lorsque le MNR a lancé un programme national de syndicalisation paysanne. Selon eux, le syndicat paysan ne se basait sur aucune structure paysanne ou indienne préexistante, que ce soit dans les haciendas ou les communautés libres, mais a plutôt été modelé sur les syndicats ouvriers industriels, quelque peu modifiés afin de convenir au contexte agraire. Renforçant leur vision selon laquelle la révolution était une force s’étant étendue aux campagnes par le haut, ils assurent que personne en Bolivie ne serait d’accord avec Patch. Toutefois, ces auteurs n’approuvent pas entièrement la position du MNR non plus. Ils affirment que : « La réforme agraire bolivienne a été le résultat de nombreuses forces subtiles et entrelacées. N’en faire qu’un processus venant du haut ou venant du bas reviendrait à ignorer le fait que sans dirigeants, il n’y a que des foules sans objectifs et que les dirigeants sans partisans sont impuissants. » Malgré leurs divisions quant à la question de savoir quelles forces se trouvent derrière la réforme agraire, dans les deux perspectives, Ucureña (qui se situe dans la vallée de Cochabamba) se trouvait au centre de la mobilisation politique paysanne.
Un nouvel ensemble de travaux universitaires réexamine, depuis les années 1970, les sources de la mobilisation politique dans les campagnes, et ils sont tous d’accord pour dire que celle-ci a débuté au sommet pour descendre. L’anthropologue Jorge Dandler démontre que les paysans ont organisé les premiers syndicats paysans dans les vallées de Cochabamba plus d’une décennie avant la révolution. Or, selon lui, ni les paysans ni le MNR n’ont été les moteurs de la mobilisation politique paysanne, mais plutôt les courtiers politiques (pour utiliser le concept d’Eric Wolf), tels que les enseignants ruraux et les militants de partis politiques penchant à gauche, comme ceux du Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), le parti de la gauche révolutionnaire. Dandler affirme que le soutien actif non paysan était vital pour connecter les demandes paroissiales paysannes aux idéologies nationales émergentes. Les recherches de Dandler soulignent également la politisation qui a eu lieu à Ucureña. Selon Dandler, les paysans de la vallée se sont accrochés à l’idée d’organiser un syndicat avant les autres paysans à cause des distinctions culturelles et sociales spécifiques à cette région. Selon Dandler, les distinctions entre les Indiens et les peuples métis se sont adoucies depuis le dix-neuvième siècle dans la vallée de Cochabamba, contrairement à l’Altiplano où les distinctions sociales entre Indiens et blancs ont été définies plus fortement. De manière similaire, le politiste James Malloy souligne la spécificité de la mobilisation politique paysanne à Cochabamba (et à Ucureña en particulier)[4]. Malloy affirme que la migration indienne des campagnes vers la ville et notamment vers les mines a été particulièrement importante.
Ces études remettent en question le rôle autoproclamé du MNR dans la direction de la réforme agraire et l’octroi de terre aux Indiens. Elles offrent une description dense des dynamiques politiques des décennies avant et pendant la révolution et élargissent leur vision au-delà du récit officiel du MNR. Toutefois, toutes celles-ci soulignent qu’Ucureña a été le lieu par excellence où cette première politisation paysanne s’est faite. Ces travaux affirment le rôle unique de cette région au sein d’un océan de communautés indigènes et paysannes inorganisées et dépolitisées. Ces auteurs limitent l’organisation politique au cadre du syndicat paysan et toutes les autres formes d’action politique découlent de cette vision.
Débutant au début des années 1980 (bien qu’à distance des débats sur la révolution bolivienne et la réforme agraire), les chercheurs et militants qui se sont rassemblés autour du Taller de Historia Oral Andina (THOA), l’atelier d’histoire orale andine, ont exploré plus en profondeur les luttes politiques indiennes comme paysannes[5]. Silvia Rivera Cusicanqui, Carlos Mamani, Roberto Choque et Esteban Ticona (entre autres) ont dépouillé les comptes-rendus étouffés des luttes indiennes et paysannes depuis la fin du dix-neuvième siècle et à travers la première moitié du vingtième siècle. Silvia Rivera Cusicanqui a étudié le réseau de dirigeants indiens connu sous le nom de caciques apoderados, qui a émergé dans les années 1910, qui a combattu les propriétaires indiens en justice en présentant des titres conférés par la Couronne espagnole afin de démontrer que la communauté était propriétaire de la terre. L’historien Roberto Choque a étudié la lutte des communautés indigènes contre l’empiétement des propriétaires terriens sur leurs terres, en analysant la rébellion indigène de Jesús de Machaca en 1927[6].
Inspirée par ce nouveau travail, Laura Gotkowitz a reformulé la révolution nationale de 1952 comme étant la culmination de luttes rurales remontant aux années 1880. Elle place la politique paysanne et indienne au centre des débats nationaux et remet la révolution de 1952 dans le contexte antérieur aux rébellions qui ont eu lieu en 1899 (la rébellion de Zarate Willka), en 1921 (la rébellion de Jesus de Machaca) et en 1947 (la vaste rébellion sur les hauts-plateaux de La Paz, Oruro et dans les provinces occidentales de Cochabamba). Elle montre comment ce long cycle de mobilisation, impliquant à la fois des efforts légaux et une action directe, a directement façonné les événements de 1952. Ce travail remet en question les conceptions précédentes sur les Indiens et les paysans en tant qu’acteurs politiques marginaux. Pourtant, le travail de Laura Gotkowitz se termine en 1947, et il nous faut toujours comprendre le rôle que les communautés paysannes et indiennes ont joué à l’époque de la révolution, et c’est là l’histoire qui est au cœur de mon livre.
En analysant le rôle des communautés paysannes et indiennes à l’époque de la révolution, les universitaires du THOA étaient très critiques envers le rôle du MNR dans les campagnes. Tout comme dans les travaux universitaires des années 1960 et 1970, ils endossent la vision selon laquelle la réforme agraire a été un programme instauré par en haut. Ils montrent que l’organisation des syndicats paysans et la distribution individuelle de terre parmi les paysans a sapé l’organisation autonome et les systèmes traditionnels de l’autorité indienne. Selon eux, la révolution de 1952 était plus une continuation qu’une rupture avec les projets modernisateurs l’ayant précédée. C’est la sociologue Silvia Rivera Cusicanqui qui articule le mieux l’une des analyses les plus importantes des politiques des années 1950, en maintenant que les politiques « clientélistes » du MNR dans les campagnes durant les années 1950 ont fait passer les paysans de « pongos économiques » (travailleurs serviles) à pongos politiques (clients politiques subordonnés). Selon Rivera Cusicanqui, la réforme agraire a donné au MNR le soutien politique inconditionnel de la paysannerie, qui a permis au parti nationaliste de rester au pouvoir durant douze ans (1952-1964)[7].
Comme on peut le constater, la littérature sur la révolution est devenue de plus en plus critique vis-à-vis du rôle du MNR dans les campagnes. Depuis les années 1980, la plupart des chercheurs ont décrit le MNR comme une force réactionnaire dont l’objectif ultime était de démanteler les luttes politiques autonomes indiennes de longue durable. Il semble y avoir une contradiction dans la tendance de cette littérature. Bien que les chercheurs en soient venus à souligner l’agentivité politique paysanne et indienne avant la révolution, ils ont renforcé la vision selon laquelle les paysans, mis à part à Ucureña, ont passivement mis en œuvre l’agenda politique agraire du MNR après la révolution. À l’exception des premiers travaux de Richard Patch, la plupart des chercheurs considéraient le processus de syndicalisation et la réforme agraire comme des programmes imposés aux paysans par le sommet.
Mon livre, Fields of Revolution : Agrarian Reform and Rural State Formation in Bolivia, 1935-1980, remet en question cette description verticale de la réforme agraire. Mon travail exprime clairement que le timing, la profondeur et le résultat final du processus de réforme agraire, ostensiblement menée par le parti révolutionnaire et les officiels d’État, étaient en fait fondamentalement définis par les initiatives et réponses des forces communautaires paysannes et indiennes « sur le terrain ».
La révolution a mis fin à la vaste accumulation de terre dans les hauts-plateaux et les vallées, a rendu hors-la-loi les rapports de travail propriétaires/colono serviles (c’est-à-dire les péons ou labor-tenants, travaillant pour un propriétaire en échange d’un lopin de terre) et a démantelé le pouvoir des propriétaires dans les campagnes tout comme leur organisation la plus importante, la Bolivian Rural Society (SRB). C’est la révolution ainsi que les alliances tendues bien cruciales entre le MNR et les paysans qui ont finalement démantelé l’élite rurale traditionnelle et influente.
Mon livre revisite également le rôle du MNR dans les campagnes. Comme un certain nombre d’auteurs l’ont suggéré, notamment James Malloy et James Dunkerley, le MNR était une force modérée dans la révolution. L’approche prudente dont a fait preuve le MNR envers la distribution de terres a été évidente dès le début de la réforme agraire, lorsqu’il affirmait habituellement que cette politique ne s’attaquerait pas à la propriété, mais à l’accumulation non productive de terres. En 1952 et en 1953, les discours des dirigeants majeurs du MNR distinguaient souvent deux types de propriétaires terriens : ceux qui étaient directement impliqués dans la production de leur propriété et étaient les propriétaires des entreprises agricoles productives, contrairement aux propriétaires supposément fainéants qui vivaient de la rente paysanne. Malgré le profil modéré du MNR, le parti a pris d’importantes décisions, principalement pour assurer sa propre stabilité politique, qui a changé le rapport de pouvoir dans les campagnes. Premièrement, Paz Estenssoro a démantelé l’organisation la plus importante des propriétaires terriens, la société bolivienne rurale (SRB), sapant la capacité des propriétaires terriens à répondre en tant que classe. Deuxièmement, le MNR a désactivé les conseils ruraux qui, avant 1952, étaient les médiateurs entre l’État et la société rurale, les replaçant dans les syndicats paysans. L’élimination des conseils ruraux et ses institutions de syndicats comme mécanismes de contrôle politique ont transformé les politiques quotidiennes dans les campagnes. Troisièmement, le MNR a défié l’Église, l’un des propriétaires terriens les plus importants en Bolivie. Quatrièmement, Paz Estenssoro – plus pragmatique que dogmatique – a signé le décret pour la restitution de la terre communautaire en 1954, offrant une concession d’État aux luttes politiques indiennes. Ce dernier décret divergeait clairement des notions orthodoxes de modernisation dans les cercles nationalistes et de gauche. Ces quatre décisions ont été des marqueurs politiques ayant contribué à la radicalisation du processus politique.
- En quel sens les indigènes ont-ils joué un rôle dans la mise en œuvre de la réforme agraire ?
Mon travail remet en question les approches antérieures de la réforme agraire qui appréhendaient la réforme agraire de Bolivie comme un processus vertical. Mon livre montre le rôle politique radical joué par les travailleurs des haciendas et les communautés indigènes dans la mise en œuvre de la réforme agraire. Premièrement, contrairement à ce que supposait le MNR, j’ai trouvé que, peu après la révolution, le gouvernement était réticent à amorcer un programme généralisé de redistribution terrienne et a tenté d’introduire un système salarial dans les haciendas. Dans le contexte de la révolution, nombre de propriétaires terriens voulaient mettre en œuvre ce système, mais mon travail révèle que les paysans ont refusé tout nouvel arrangement sans redistribution. En 1954, le gouvernement avait abandonné le projet de prolétarisation rurale. Au cours de l’application de la réforme agraire, les colonos ont étendu les limites de la redistribution de la terre au-delà de larges domaines improductifs. Par conséquent, nombre de propriétés moyennes et productives ont également été expropriées grâce à la pression paysanne.
Deuxièmement, j’affirme que les syndicats paysans ont mené le processus de distribution terrienne parmi les bénéficiaires alors que le gouvernement a rapidement perdu le contrôle du processus. Dans les juridictions agraires, les propriétaires ont souvent dénoncé la croissance continue du nombre de paysans demandant des terres. Nombre de propriétaires terriens se sont plaints que non seulement les colonos dans les domaines, mais également leurs proches sans-terre ont acquis des parcelles de terre, aux dépens de parcelles qui auraient dû demeurer entre les mains des propriétaires terriens. Dans de nombreux cas légaux, les juges locaux et le Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA), le Conseil national pour la réforme agraire, ont restreint la redistribution de terre aux seuls colonos. Pourtant, dans son verdict, reconnaissant à quel point il était difficile d’expulser les paysans qui occupaient déjà l’hacienda, le président déclarait l’expropriation de la propriété en faveur de tous les « colons », qu’il s’agisse de colonos, de travailleurs temporaires ou de paysans sans terre. Le MNR a cédé aux syndicats paysans et leur a permis de définir la distribution de terre parmi les paysans.
Troisièmement, mon travail révèle également l’agenda politique distinct d’anciens comunarios (membres d’anciennes communautés indigènes ayant perdu leurs terres face à l’expansion de l’hacienda et qui sont devenus une force de travail dépendante de leur terre qu’ils utilisaient pour travailler ou des haciendas voisines). J’explore la manière dont les dirigeants des communautés indigènes, qui ont mené l’une des campagnes les plus importantes pour la restitution de terres après la révolution, ont adapté le discours nationaliste après la révolution afin de revendiquer leurs terres. Mal à l’aise avec un agenda gouvernemental qui proclamait « la terre à ceux qui la travaillent », les anciens comunarios déclaraient « la terre à son propriétaire initial ». L’action politique des anciens comunarios après la révolution a réussi à refaçonner l’agenda agraire du gouvernement, et les anciens comunarios utilisaient la nouvelle législation pour regagner les terres perdues aux propriétaires d’hacienda depuis 1900, et dans certains cas même avant 1900. Malgré le discours nationaliste et assimilationniste du MNR proclamant la fin des différences ethniques en Bolivie, le décret restituant les terres a joué un rôle crucial dans la revalidation d’organisations et autorités indigènes traditionnelles. Chaque cas de restitution encourageait les héritiers des comunarios à faire se rappeler leur territoire et histoire collectifs. Le MNR a largement promu l’intégration indienne, si ce n’est l’assimilation, en tant que caractéristique cruciale dans la construction de la nation, mais en pratique la politique de réforme agraire du MNR a fini pas sécuriser les demandes comunarios même lorsque celles-ci ne s’inséraient pas bien dans le programme politique originel du parti.
De plus, mon analyse des affaires judiciaires concernant la distribution de terre montre que l’État n’avait qu’une voix et capacité limitées dans la définition du processus de distribution terrienne parmi les paysans. L’issue finale de ce processus a créé une carte comprenant les parcelles possédées individuellement et collectivement dans une variété de différentes formes, tailles et usages. En fait, le caractère chaotique et inégal de cette carte révèle la force des décisions ascendantes (bottom-up) face à la planification gouvernementale descendante (top-down). Le gouvernement préférait accepter et endosser les plans du syndicat paysan pour la distribution de terre qui étaient enracinés dans des pratiques anciennes plutôt que de risquer d’alimenter le conflit politique dans les campagnes. Considérant la pression politique qu’a rencontrée le gouvernement quasiment dès le début de la révolution, de la part des travailleurs urbains et des mineurs pour radicaliser la révolution, et de la part des secteurs conservateurs de Bolivie ainsi que des États-Unis pour contenir celle-ci, le MNR a cherché à consolider son alliance avec la paysannerie en accommodant son discours nationaliste aux forces politiques locales. Le gouvernement a signé pour l’expropriation d’une propriété, mais n’a, ensuite, joué aucun rôle dans l’organisation interne de la redistribution de terre. En l’absence de cartes ou de recensements et avec très peu de contrôle effectif sur le territoire bolivien, les autorités officielles se sont largement reposées sur les dirigeants syndicaux et les autorités communales afin de mettre en œuvre le long, fastidieux et politiquement moins profitable processus de distribution de terre parmi les paysans.
- En quoi cette réforme a-t-elle fait évoluer les conditions sociales des indigènes en Bolivie ?
Afin de saisir la profondeur de la transformation dont les Indiens/paysans ont fait l’expérience après la révolution, il est nécessaire de se souvenir des conditions de vie des travailleurs des haciendas (que l’on appelle colonos en Bolivie) avant 1952. Le système des haciendas était déjà assez puissant durant la période coloniale. Pourtant, la situation des peuples indiens/paysans s’est aggravée après l’indépendance. En 1825, lorsque la Bolivie est née en tant que nouvelle république, les communautés indiennes contrôlaient deux tiers des terres cultivables de Bolivie, mais dans les années 1950, elles n’en possédaient plus que 26 %. Une telle perte de propriété reflétait une attaque contre la propriété collective indienne par l’implantation du libéralisme dans les campagnes à travers l’expansion du système de l’hacienda. La privatisation de terres n’a pas seulement dépouillé les communautés indiennes de leurs anciennes propriétés, elle a également transformé un grand nombre de leurs membres en travailleurs subalternes. Dans ce système de travail, les colonos travaillaient sur une propriété de bailleurs environ cinq jours par semaine sans compensation économique. Dans leur travail, ils avaient la charge du labourage, de la plantation, de la traite des vaches, d’aide-ménagers, du retapage des écuries, des granges, des clôtures et des routes, d’emmener paître les troupeaux. Les colonos étaient également responsables du transport et de la commercialisation des denrées de l’hacienda. Bien que certains colonos se plaignaient de la difficulté du travail, davantage encore se plaignaient du fait que ces tâches devaient être accomplies à leurs propres dépends : ils devaient acheter la corde pour empaqueter la récolte, utiliser leurs propres animaux pour le transport et fournir leurs propres outils pour la semence et la récolte de la terre du propriétaire. Dans les cas où les propriétaires achetaient les tracteurs, les colonos devaient souvent payer l’essence. Durant les périodes de festivités religieuses, les colonos devaient préparer la chicha (une boisson faite à partir de maïs fermenté) et beaucoup se plaignaient du fait qu’ils devaient souvent sacrifier leurs propres animaux lors de telles festivités. Selon des récits de colonos, le travail le plus harassant se faisait dans les villes puisque les colonos devaient fournir leur propre transport, travailler douze heures par jour et n’avait pas d’endroit où dormir. L’exploitation d’un individu affectait la condition de toute la famille. Comme les colonos n’avaient presque pas le temps de cultiver leurs propres parcelles, leurs femmes, descendants et leurs parents pauvres jouaient un rôle crucial pour la subsistance de la famille. En plus de tout cela, on trouvait que nombre de propriétaires terriens forçaient les colonos à payer des taxes imposées sur leurs haciendas. En échange de leur travail dans l’hacienda, les colonos avaient accès à des parcelles qu’ils utilisaient pour leurs cultures de subsistance et, parfois, pour des produits agricoles à vendre sur le marché. Ils avaient également accès aux pâturages et aux forêts à des fins domestiques. Pourtant, l’utilisation de ces zones n’était pas toujours gratuite. Dans plusieurs haciendas, les colonos devaient payer le propriétaire avec un animal ou deux chaque année. Les affaires judiciaires agraires montrent que l’utilisation des pâturages et forêts par les colonos était au cœur d’un conflit entre ces derniers et les propriétaires.
Afin de garder le système colonato en place, les propriétaires terriens ont conservé un strict contrôle sur les corps des colonos. Les châtiments corporels étaient largement utilisés afin de renforcer la discipline : la confiscation de biens ou de maisons était un autre mécanisme de punition habituel. Les colonos se plaignaient souvent du fait que les propriétaires se saisissaient de leurs habits, de leur récolte ou de leurs animaux afin de les punir d’erreurs mineures. L’éviction était un autre moyen de punition dont disposaient les propriétaires terriens. Ces derniers ont expulsé un certain nombre de leurs ouvriers afin de réprimer les grèves d’occupation des colons au début des années 1940 ainsi que leurs soulèvements à la fin des années 1940. Les colonos ont accusé nombre de propriétaires terriens d’incendier les foyers de dirigeants paysans (nommés cabecillas) et de les évincer de leur propriété, ce qui les a contraints à rechercher du travail dans les mines ou dans les haciendas.
Ce système ignominieux de travail a pris fin après 1953. Et il n’est guère surprenant de trouver des dirigeants paysans parler de la révolution comme du moment où les paysans ont gagné leur liberté. Malgré les changements incontestables qui ont eu lieu dans les ères rurales après 1952, il est vrai que les paysans/indigènes ont continué à représenter l’un des secteurs les plus appauvris de la société. Les quelques changements qui ont eu lieu dans les domaines de la santé, de l’éducation ou des opportunités d’emploi au cours de la seconde moitié du 20e siècle se sont concentrés dans les villes, quittant les campagnes marginalisées. Comme l’ont montré de nombreux chercheurs, la révolution nationaliste – malgré sa rhétorique politique – n’a mis fin ni au racisme ni aux fortes disparités économiques entre classes sociales. Bien que l’on ne puisse ignorer ni minimiser ces fortes critiques, mon travail souligne l’importance de ces changements qui ont eu lieu après 1952 et il souligne le rôle que les Indiens et les paysans ont joué dans ce processus.
- Dans son livre Red October (Brill, 2011), Jeffrey R. Webber se concentre sur les luttes indigènes extra-parlementaires en Bolivie entre 2000 et 2005. Dans ce livre, Webber utilise la définition que donne Suzana Sawyer de l’identité ethnique comme « processus de négociation constante quant aux sens collectifs d’être qui naturalise certains attributs (de la couleur de la peau jusqu’à la religion) comme des possessions naturelles découlant d’une histoire mythique », arguant que l’ethnicité est un « rapport, non une chose » et que le fait de savoir qui est indigène et qui ne l’est pas est un acte politique. Comment caractériseriez-vous l’évolution de l’indigénité en Bolivie depuis la révolution bolivienne ?
Oui, je souscris à cette perspective. On ne peut comprendre l’identité ethnique en Bolivie si ce n’est comme un processus constant de négociation, construit en rapport avec les autres. Dans mon propre travail, j’étudie le rapport étroit entre identité ethnique et lutte pour l’accès à la terre. Le décret de réforme agraire de 1953, en plus de dicter l’expropriation de vastes domaines non cultivés, approuvait des cas de restitution terrienne. Le décret pour la réforme agraire d’août 1953 et, plus tard, le décret pour la restitution terrienne de mai 1954, dictaient que toute la propriété communale indigène ayant été transformée en latifundio privé après 1900 serait rendue aux communautés. Afin d’implanter ces décrets, c’est-à-dire afin de gagner une affaire de restitution, les comunarios devaient démontrer que leurs liens communaux ethniques continuaient à exister. Cela signifiait qu’il était stratégique pour eux de souligner leur identité indienne plutôt que leur identité de classe. La promulgation de ces décrets, qui étaient la réponse du gouvernement à la pression politique des dirigeants indigènes qui demandaient le retour des terres de la communauté qu’ils avaient perdues avec l’expansion de l’hacienda, a donc poussé les ex-comunarios (les descendants des membres de la communauté indigène) à continuer de maintenir leur identité indigène, leurs liens à la communauté et leurs autorités traditionnelles après la révolution nationale de 1952. Il y avait d’autres raisons concrètes pour expliquer pourquoi les paysans voulaient souligner leur identité de classe. Il existait des différences importantes dans la taille de la parcelle de terre à laquelle les paysans pouvaient accéder s’ils gagnaient une affaire de restitution terrienne contre une affaire d’expropriation terrienne. Habituellement, les colonos pétitionnaient pour l’expropriation de la parcelle de terre sur laquelle ils travaillaient, tandis que les ex-comunarios demandaient la restitution de toute la terre qu’ils avaient perdue, qui était bien plus vaste qu’une parcelle assignée à un colono. En moyenne à Omasuyos, les colonos recevaient entre 5 et 10 hectares par tête de famille. Dans les affaires de restitution, les anciens comunarios pouvaient obtenir les 60 à 80 hectares qui appartenaient à leurs grands-parents. De plus, dans les affaires d’expropriation, les propriétaires terriens pouvaient soumettre des revendications de compensation économique pour les colonos, tandis que les anciens comunarios regagnaient la terre sans payer de compensation pour les propriétaires terriens. Ceci explique pourquoi il était si important pour les anciens comunarios de défendre leur identité indigène même face à la pression gouvernementale pour promouvoir l’identité mestizo.
Ce rapport entre l’identité ethnique et les revendications terriennes n’est pas inhabituel. La loi agraire actuelle de Bolivie (l’article 43 de la Ley de Reconducción Comunitaria, approuvé sous le gouvernement du président Evo Morales) prescrit que l’État accorde la terre de préférence aux communautés indigènes et paysannes. Ceci explique pourquoi les immigrés paysans des hauts-plateaux jusqu’aux plaines, plutôt que d’insister sur leur identité de classe, préfèrent souligner leur identité ethnique et prendre le nom de « comunidades interculturales » afin de consolider leurs revendications des terres.
- Comment la question agraire a-t-elle évolué en Bolivie de 1952 jusqu’à aujourd’hui ?
Le décret pour la réforme agraire de 1953 a eu un effet profondément redistributeur quant au régime foncier sur les hauts-plateaux boliviens (La Paz, Oruro et Potosi) ainsi que dans les vallées (Cochabamba, Tarija et Chuquisaca). Mais ses effets n’ont pas été les mêmes dans toutes les régions. Dans les plaines (les plaines boliviennes et l’Amazone, le nord de La Paz, l’est de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija et les départements étendus de Santa Cruz, Beni et de Pando), la politique agraire du MNR ne différait quasiment pas de l’état d’esprit civilisateur des élites du 19e siècle. Le décret pour la réforme agraire de 1953 a présenté les peuples indigènes des plaines comme étant inaptes à l’acquisition d’une propriété et comme ayant besoin d’être soumis à une tutelle. L’article 129 du décret pour la réforme agraire affirmait : « Les groupes des plaines […] qui sont dans un état sauvage et ont une organisation primitive sont sous la protection de l’État. » Le MNR pensait que les plaines étaient des territoires vides, car il n’y avait que des sauvages qui y vivaient, le gouvernement promouvait leur colonisation en transplantant les populations paysannes des hauts-plateaux vers les plaines. La colonisation a engendré l’expulsion et la marginalisation progressives des populations indigènes de leurs anciens territoires.
Le plus vaste processus d’occupation terrienne et d’accumulation dans les plaines s’est fait dans les années 1970 et au début des années 1980 sous les dictatures du général Hugo Bánzer Suarez (1971-1978) et Luis Garcia Meza (1980-1981). Ces deux généraux ont concédé de grandes subventions terriennes à des personnes privées en tant qu’arrangements et faveurs politiques. L’anthropologue Nancy Postero note que le général Bánzer a accordé environ dix millions d’hectares à des individus privés dans le seul département de Santa Cruz. Contrairement aux politiques terriennes dans les highlands où les paysans et les petits fermiers ont eu droit à des parcelles de cinq hectares, dans les plaines, 72 % de la terre appartenait à des propriétés de plus de 1000 hectares[8].
À la fin des années 1980, il était clair que la Bolivie faisait face à un nouveau processus de concentration terrienne (un néo-latifundio) dans ces zones. En réponse, les peuples indigènes des plaines, qui n’avaient jusque là qu’une visibilité politique limitée, ont émergé comme de forts acteurs politiques, dénonçant l’expulsion violente de leurs terres. Ces groupes indigènes ont organisé une confédération nommée Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), la Fédération indigène de la Bolivie orientale, en 1982. Initialement, les revendications de la CIDOB n’ont pas été acceptées au niveau national. Toutefois, en 1990, ils ont organisé la première marche pour le territoire et la dignité, lors de laquelle ils ont marché de la ville de Trinidad jusqu’à La Paz, durant plus de trente-deux jours. La marche a eu un impact puissant sur la politique nationale. Elle a fait des peuples indigènes des plaines – ainsi que de la CIDOB – des acteurs politiques majeurs au niveau national. Elle a contraint le président Jaime Paz Zamora (1989-1993) à signer trois décrets garantissant aux peuples indigènes le droit de posséder des territoires.
Les revendications indigènes ont émergé en Bolivie à une époque de profonde crise institutionnelle pour le CNRA. Des nouvelles quant à la corruption dans le processus de titrage de la terre et de l’appropriation illégale de terres emplissaient les journaux. En 1992, le député Miguel Urioste, le directeur de Fundación Tierra, une ONG spécialisée dans la terre et le développement rural, dénonçait le ministre de l’Éducation pour avoir utilisé son pouvoir politique afin de s’offrir une grande propriété à Santa Cruz. En réponse à ces accusations de corruption et à la mobilisation politique en cours de la part des peuples indigènes dans les plaines, le président Paz Zamora a saisi les bureaux du CNRA, a interdit tous les titrages de propriété afin de stopper toute allocation future de terres et a appelé à la rédaction d’une nouvelle loi agraire. La fermeture du CNRA, en 1992, a marqué la fin de la réforme agraire des années 1950.
En 1996, le président néolibéral Gonzalo Sánchez de Lozada a acté une nouvelle loi agraire, nommée loi Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA). La loi INRA ne constituait pas seulement une réponse aux crises internes boliviennes, mais s’inscrivait également dans un processus généralisé de réforme, promu par la Banque Mondiale dans beaucoup de pays d’Afrique et d’Amérique latine. Parmi les mesures de privatisation néolibérale de l’économie dans les années 1990, les officiels de la Banque Mondiale ont encouragé de nouveaux programmes de réforme agraire qui ouvriraient la terre aux marchés, considérant que l’organisation et la clarification de la propriété légale des propriétaires fonciers étaient cruciales pour établir un marché terrien sain.
Bien que l’objectif fondamental de la loi INRA ait été de consolider un registre terrien national qui s’attaque à la superposition de propriétés terriennes, la loi a fait d’importantes concessions aux groupes indigènes des plaines. Cette nouvelle loi reconnaissait les territoires collectifs du peuple indigène, nommé TCO (Tierra Comunitaria de Origen). C’était-là une remarquable réussite pour la CIDOB.
En une décennie, l’INRA n’avait achevé (que) 35 % du titrage de la terre. Sur ce total, environ 40 % de la terre revenait aux populations indigènes des plaines, 36 % étaient déclarés propriété de l’État et 12 % revenait aux communautés indigènes des hauts-plateaux. La distribution de la terre aux groupes indigènes des plaines, qui s’est faite entre 1996 et 2005, avait certainement limité l’expansion continue des éleveurs de bétails et bûcherons à ces zones indigènes. Pourtant, les migrants paysans des hauts-plateaux (nommé colonizadores) ont également perçu le processus de titrage de la terre en faveur des groupes indigènes des plaines comme une concurrence vis-à-vis de leurs revendications de terre. Depuis la fin des années 1990, les conflits entre le peuple indigène et les colonizadores se sont intensifiés dans le nord de La Paz, à l’est de Cochabamba et dans les départements de Beni, Pando et Santa Cruz. La tension entre ces deux groupes ne s’est intensifiée qu’après 2006, lorsqu’Evo Morales a été élu président, comme je l’expliquerai dans la réponse à la question suivante.
- Quel est l’état actuel des communautés indigènes en Bolivie ? Dans quelle mesure sont-elles politisées ? Quels ont été leurs rapports à la présidence Morales et au récent changement à la tête de l’État bolivien ?
Evo Morales est arrivé au pouvoir en décembre 2005. Morales était un dirigeant représentant le mouvement des producteurs de feuilles de coca (les cocaleros). Sa rhétorique anti-capitaliste, anti-impérialiste et environnementaliste lui a garanti le soutien des mouvements politiques et sociaux de gauche, des organisations indigènes des hauts-plateaux comme des plaines, des colonizadores, des cocaleros et de la classe moyenne urbaine. Initialement, la politique de Morales quant à la terre cherchait à répondre de manière égale aux demandes des diverses forces sociales qui l’ont amené au pouvoir – les paysans, les indigènes et les colonizadores.
Durant ses premières années au pouvoir, le président Morales a promulgué une nouvelle loi sur la réforme agraire, nommée Ley Reconducción Comunitaria. Cette troisième loi sur la réforme agraire a apporté d’importants changements à la Ley INRA. La nouvelle loi a remplacé le terme Tierra Comunitaria de Origen (TCO) par Territorio Indigena Originario Campesino (TIOC). Ce nouveau terme a permis aux colonizadores et cocaleros d’accéder au même statut légal et aux mêmes droits que les groupes indigènes des plaines avaient acquis sous la TCO. La TIOC a donné aux colonizadores et aux cocaleros l’opportunité de revendiquer les terres au même niveau que les indigènes des plaines.
L’administration Morales a également cherché à honorer son engagement environnemental. En 2009, Morales a signé une nouvelle constitution promouvant le développement durable. L’article 33 de cette nouvelle constitution proclamait : « Le peuple a droit à un environnement sain, protégé et équilibré. L’exercice de ce droit doit permettre aux individus et aux collectivités des générations présentes et futures, tout comme aux autres êtres vivants, de se développer normalement et de manière permanente. » En 2010, le gouvernement a également approuvé la loi 071 sur les droits de la Terre Mère. La législation a consolidé un nouveau cadre légal afin de protéger les droits des peuples indigènes et paysans et de promouvoir les droits de la nature.
Mais l’administration Morales a rencontré d’importants obstacles dans la mise en œuvre de cette législation. L’un des conflits les plus importants auquel son parti a dû faire face a été la dispute avec les élites des plaines. La crise a émergé en 2008, lorsque les gouverneurs de cinq des neuf départements en Bolivie – Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando et Chuquisaca – ont rejeté le projet constitutionnel promu par le président et ont demandé l’autonomie. La demande d’autonomie, qui n’avait rien de neuf à Santa Cruz, a permis aux élites locales d’articuler le soutien aux secteurs les plus conservateurs du pays afin de mettre un frein aux politiques nationales du gouvernement. L’appel à l’autonomie a masqué les griefs économiques, ethniques et idéologiques. Premièrement, les plus grandes réserves d’hydrocarbones se trouvent dans l’est du pays et les élites locales voulaient avoir le contrôle sur les revenus du gaz. Deuxièmement, ces élites régionales, qui s’identifiaient comme blanches ou mestizo, se sentaient menacées par la montée d’acteurs indigènes et de paysans renforcés par le gouvernement Evo Morales. Troisièmement, l’élite agro-industrielle défendait le néolibéralisme, le modèle économique que le gouvernement Morales cherchait à détruire.
Finalement, Morales a géré la crise après avoir fait d’importantes concessions à ces élites régionales. Ces concessions se sont terminées par la consolidation et le renforcement du modèle économique néolibéral sévèrement critiqué par le MAS. Débutant en 2010, l’administration Morales a défait nombre des principes approuvés dans sa précédente législation en faveur de la Terre Mère et de la protection des droits fonciers des indigènes et paysans. Le politiste Ken Eaton a relevé trois changements majeurs. Premièrement, le gouvernement Morales a freiné les aspirations du mouvement des paysans sans terre (MST, Movimiento Sin Tierra). En 2013, le gouvernement a signé une loi contre l’empiétement et l’intrusion sur la propriété, punissant de trois à cinq ans de prison ceux envahissant les terres. Deuxièmement, le gouvernement a établi la limite maximum d’une propriété de taille moyenne à 8000 hectares, au lieu de 5000 hectares comme cela avait été établi dans la constitution de 2009. Troisièmement, Morales a perdu le contrôle de l’abattage, une pratique répandue ayant contribué à la déforestation, qui s’est faite entre juillet 1996 et décembre 2011. La nouvelle loi nécessitait que les bénéficiaires paient une redevance unique en tant que sanction administrative contre la déforestation sans autorisation. Chacune de ces décisions a montré que Morales a réussi à reprendre le contrôle politique du pays en altérant l’essence même du « processus de changement », le terme utilisé par Morales pour se référer à son gouvernement[9].
En 2011, Morales a dû faire face à un autre conflit politique lorsque les groupes indigènes vivant dans le territoire indigène Isiboro Sécure et dans le parc national (TIPNIS) ont commencé à protester contre la décision du gouvernement de construire une route traversant leur territoire. Cette décision unilatérale a violé le principe de la consultation précédente que la constitution de 2009 avait garanti aux indigènes. Ce désaccord n’a pas seulement engendré un conflit entre les groupes indigènes vivant dans cette zone et le gouvernement, mais également entre les indigènes des plaines et les cocaleros vivant et produisant la coca dans les environs du parc. Les cocaleros constituaient la base sociale la plus solide du président. Les cocaleros défendaient la construction d’une route reliant les villes de Villa Tunari (Cochabamba) et de San Ignacio de Moxos (Beni) à travers le parc national alors que les Indiens des plaines affirmaient que ce projet fragiliserait de manière permanente l’écosystème fragile du secteur.
La décision du gouvernement de poursuivre la construction de cette route malgré les protestations a secoué l’opinion publique, à l’échelle nationale et internationale. Plusieurs analystes ont critiqué la contradiction entre le discours de Morales de respect des droits indigènes et de la Terre Mère, tenu par le président Morales au niveau international, et les méthodes non démocratiques qu’il a utilisées au niveau national pour faire taire les protestations et manifestations contre la route. Le 26 septembre 2011, le gouvernement est violemment intervenu dans la manifestation indigène qui représentait un coup sévère porté à la rhétorique démocratique du gouvernement Morales.
Après le conflit dans le TIPNIS, Morales a ouvertement soutenu les cocaleros contre les indigènes des plaines, démantelant toute une partie du soutien politique l’ayant amené au pouvoir. Les deux conflits ont laissé une tâche sur le gouvernement MAS et ont redéfini la politique initiale de Morales quant à la question de la terre. Depuis 2011, les dirigeants indigènes des plaines ont remis en question le deux poids deux mesures du président Morales – un dirigeant autoproclamé des droits environnementaux dans les forums internationaux qui continue à approuver une politique lésant l’environnement et les territoires indigènes au sein de son pays.
Cela signifie que l’on ne peut traiter du rapport entre les peuples indigènes en Bolivie et me président comme s’il s’agissait d’un groupe homogène. L’influence politique des planteurs de coca vivant à Chapare s’est développée sous la présidence Morales, pourtant d’autres groupes, comme les groupes indigènes des plaines ont perdu l’accès à la terre et à l’espace politique sous le gouvernement Morales.
Le conflit TIPNIS a également reflété un dilemme dépassant les frontières boliviennes. Tous les gouvernements de gauche émergeant en Amérique latine depuis les années 2000 ont dû faire face à des dilemmes similaires. Malgré leur rhétorique initiale soutenant un agenda environnementaliste, aucun gouvernement n’a été capable de trouver des alternatives à l’extractivisme (pétrole, mine, construction de route, centrales hydroélectriques, etc.). Le besoin d’un revenu immédiat, plutôt qu’un plan sur le long terme, continue de guider les politiques publiques.
Le gouvernement d’Evo Morales, loin de protéger les droits de la Terre Mère, a promu l’expansion continue de la frontière agricole et de l’agriculture et l’exportation de graines de soja, bien que cela marginalisait et ignorait les droits du peuple indigène. En fait, comme l’a affirmé Gonzalo Colque, un spécialiste des études agraires en Bolivie, malgré la confrontation politique initiale avec l’élite agro-industrielle, le dynamisme de l’économie du soja a poursuivi son accélération sous le gouvernement Morales. Colque note que les cultures industrielles comptaient pour 70,1 % de la production agricole entre 2005 et 2006 et pour 80,4 % entre 2010 et 2011. 76 % du volume total se développant dans la production agricole entre 2005 et 2011 était principalement de la graine de soja (40 %) et de la canne à sucre (36 %). Waldemar Wesz ajoute que l’expansion d’une économie basée sur le soja a eu des implications dramatiques quant à la souveraineté alimentaire, car la culture qui se développait dans des zones de végétation et de culture alimentaire indigènes a été remplacée par le soja.
Tout aussi agressive vis-à-vis de l’environnement était la législation approuvée par le gouvernement Morales en termes d’hycrocarbones. En avril 2018, le gouvernement a approuvé trois contrats pour l’exploration d’hyrocarbones à Tariquia, une réserve naturelle de faune et de flore, malgré l’opposition des communautés vivant dans cette zone. Tariquia est une zone importante en termes d’eau. Les experts sont d’accord sur le fait que toutes les zones protégées de Bolivie sont menacées étant donné que Morales les a ouvertes à l’exploration des hycrocarbones.
Entretien par Selim Nadi
[1] Le récit de Robert Alexander fut l’un des premiers et des plus influents sur la révolution bolivienne en anglais. Alexander, Bolivian National Revolution, 6. Par la suite, d’autres chercheurs ont continué à souligner le fait que les paysans étaient passifs avant et pendant la révolution. Voir, par exemple, Guillermo Lora qui affirme que les paysans étaient des parasites prépolitiques du mouvement ouvrier. Lora, « La clase obrera », 186. René Zavaleta Mercado affirme que l’isolation et l’exil culturel auxquels les propriétaires terriens ont assujetti les paysans résultaient de leur infériorité pratique. Selon lui, les soulèvements indigènes des premières décennies du vingtième siècle consistaient en une terreur sans aucune promesse (ni aucun objectif) et l’acteur incontestable de la révolution bolivienne était le prolétariat minier. Zavaleta Mercado, « El desarrollo de la conciencia nacional » in Zavaleta Mercado et Souza Crespo, Obra completa 1, p. 151-152.
[2] Patch, « Social Implications », 51. Voir également Patch, « Bolivia : The Restrained Revolution », 128.
[3] Heath, Erasmus et Buechler, Land Reform, 371.
[4] Dandler, El sindicalismo campesino, 7, 17–23, 39.
[5] Pour une histoire du THOA, voir Stephenson, « Forging an Indigenous Counterpublic Sphere », 101. Pour une étude récente des luttes des dirigeants indigènes pour recouvrir et populariser les histoires des rébellions passées, voir Dangl, Five Hundred Year Rebellion.
[6] Rivera Cusicanqui, Oprimidos ; Mamani, Taraqu ; Taller de Historia Oral Andina, El indio Santos Marka T’ula ; Choque Canqui and Ticona Alejo, Jesús de Machaqa.
[7] Rivera Cusicanqui, « Liberal Democracy », 115.
[8] Postero, Now We Are Citizens, 47.
[9] Ken Eaton, Territory and Ideology in Latin America, Policy Conflicts between National and Subnational Governments (Oxford, Oxford University Press, 2017), 169