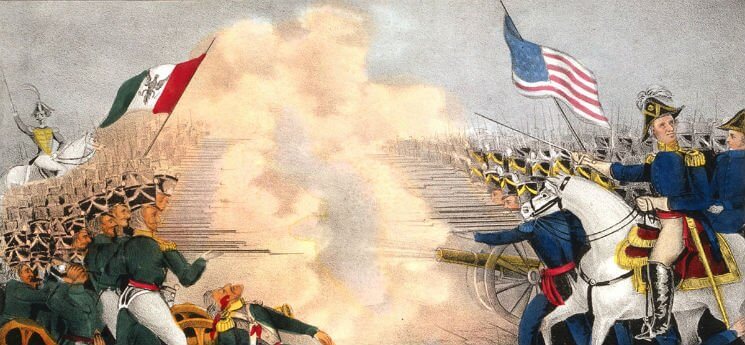16 octobre 2020. La France découvre, stupéfaite, l’assassinat de Samuel Paty dans des conditions monstrueuses.
Très rapidement, la machine politique s’emballe. Les déclarations des responsables publics fusent, le Gouvernement se mobilise, le Président de la République se rend même sur place.
Il semblerait qu’il s’agisse d’un énième attentat commis par un Musulman. Il faut des réponses, fortes et rapides, pour affirmer l’autorité de l’État.
Trois jours plus tard, le Ministre de l’intérieur propose la dissolution du CCIF, et de BarakaCity, « associations ennemies de la République » selon lui.
Le collectif se défend de toute implication dans la mort de Samuel Paty, laquelle implication ne sera d’ailleurs jamais établie.
L’Exécutif poursuit néanmoins sont entreprise et, après avoir notifié son projet de dissolution au CCIF et avoir recueilli les observations de son président sur celui-ci, par un décret du 2 décembre 2020, Emmanuel Macron a prononcé la dissolution de l’association.
Le CCIF avait cependant déjà prononcé son auto-dissolution le 27 novembre 2020 et, en réalité, le décret du 2 décembre 2020 a prononcé la dissolution du Collectif en tant que « groupement de fait ».
Par une requête du 31 janvier 2021, le CCIF a demandé au Conseil d’État d’annuler le décret du 2 décembre 2020.
Mais cette demande a été rejetée par une décision du 24 septembre 2021. Ce faisant, le Conseil d’État valide un nouvel assaut contre la résistance indigènes au motif fallacieux que la lutte contre l’islamophobie constituerait un appel à la haine raciale.
Briser les résistances indigènes
Car c’est bien à une forme de résistance indigène que le pouvoir vient de s’attaquer.
Pour mémoire, le CCIF a été fondé en 2003 par Samy Debah dans un contexte de regain de la fièvre anti-musulmane en France : affaire du collège de Creil en 1989, sortie du livre Les territoires perdus de la République en 2002 et création de la commission Stasi de réflexion « sur l’application du principe de laïcité dans la République ».
Le Collectif s’est alors attaché, pendant ses nombreuses années d’activité, d’une part, à faire connaître et reconnaître les nombreuses discriminations subies par les Musulmans et, d’autre part, à lutter contre celles-ci.
A cette fin, le CCIF s’appuyait sur un rapport annuel répertoriant les actes islamophobes et s’engageait dans des actions judiciaires pour défendre, en autres, le droit pour les mères portant le voile d’accompagner leurs enfants en sortie scolaire, le droit de porter un burkini sur la plage ou à la piscine ou encore le droit de porter un voile en entreprise.
Mais ce qui était en premier lieu reproché au CCIF, et ce qui justifiera par la suite qu’il sera désigné comme ennemi public, était sa définition de l’islamophobie. Celui-ci définissait ce terme comme « l’ensemble des actes de violence verbal ou physique, de discrimination, à l’encontre d’une institution, d’une personne morale ou d’une personne physique, en raison de son appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane »[i].
Si le terme-même d’islamophobie a dès l’origine fait l’objet de nombreuses résistances « théoriques » quant à son objet ou son origine (voire notamment les réactions de Pascal Bruckner[ii] ou de Caroline Fourest[iii]), c’est son aspect institutionnel, dénonçant l’islamophobie comme étant le produit d’un racisme d’État, qui a fait réagir le pouvoir politique.
C’est ce que manifeste l’événement – rare selon les termes mêmes du président de l’établissement – organisé le 16 novembre 2016 à l’ENS Ulm et ayant réuni le politologue Gilles Kepel et le Ministre de l’intérieur alors en exercice, Bernard Cazeneuve.
A cette occasion, Kepel soutenait l’idée selon laquelle, si les terroristes n’ont pas réussi à fracturer la société française, « une conversion a été opérée » depuis l’affaire du burkini puisque le CCIF, en mettant en avant la question de l’islamophobie, a « fait oublier les attentats » et « fait passer la France, particulièrement dans la presse anglo-saxonne, comme un goulag pour musulmans ». Le Ministre l’approuvera : « La thèse développée par le CCIF doit être combattue » car « les Français ne sont pas islamophobes »[iv].
En bref, ce qui était reproché au CCIF, c’était de politiser l’islamophobie et d’organiser les Musulmans autour de cette lutte.
Le discrédit idéologique de la lutte contre l’islamophobie n’ayant cependant pas réussi, en témoigne la Marche contre l’islamophobie du 10 novembre 2019 qui avait réussi à réunir nombre de partis politiques de gauche et d’organisations syndicales derrière ce mot d’ordre, l’Exécutif en a été réduit à devoir procéder à la disparition forcée de l’organisation qui en était le porte-étendard.
Pour ce faire, Emmanuel Macron n’a pas seulement cédé aux sirènes de l’extrême droite, comme Riposte Laïque[v] ou le Front national[vi], qui depuis plusieurs années déjà militait pour la dissolution du CCIF, mais a également fait usage d’une arme tout à fait républicaine : la loi du 10 janvier 1936, devenue aujourd’hui l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.
Cette loi a été adoptée dans un contexte particulier qui est celui de l’enracinement de la République en France. La révision constitutionnelle du 14 août 1884, achevant l’avènement de la IIIe République, venait en effet d’inscrire la règle selon laquelle « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision ».
Cependant pour asseoir l’effectivité de cette proclamation, le pouvoir devait se doter d’outils permettant de lutter matériellement contre les potentielles atteintes à la République. La loi du 1er juillet 1901 sur la liberté d’association comprenait ainsi – et comprend toujours – un article 3 disposant que « Toute association (…) qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet ».
Mais la procédure de dissolution n’était encore que judiciaire (c’est-à-dire ne pouvant être prononcée que par un tribunal, après un procès) et donc trop longue. C’est alors la multiplication des actions des ligues fascistes, destinées à renverser le système parlementaire par la force si nécessaire, et en particulier la crise du 6 février 1934 qui donnera lieu à une attaque du Palais-Bourbon par les Royalistes de l’Action française, qui encouragea les parlementaires à doter l’Exécutif d’un pouvoir de dissolution administrative, plus rapide car sans procès préalable.
Néanmoins, si cet outil a été officiellement adopté pour combattre les milices d’extrême droite, le premier décret ayant fait usage de cette nouvelle prérogative pour dissoudre la Ligue d’Action Française, la Fédération nationale des Camelots du Roi et la Fédération nationale des étudiants d’Action Française[vii], qui avaient participé à une attaque récente contre Léon Blum, il sera très rapidement utilisé également pour faire disparaître les organisations indépendantistes indigènes.
Un an à peine après l’adoption de la loi du 10 janvier 1936, le Front Populaire prononça, par décret du 26 janvier 1937[viii], la dissolution de l’Étoile Nord-Africaine, organisation promouvant l’indépendance de l’Algérie et qui à cette époque s’opposait frontalement au projet Blum-Violette destiné à maintenir l’Empire colonial.
Une masse d’autres organisations connurent par la suite le même sort, tout particulièrement pour permettre à l’État de lutter contre le processus de décolonisation sous la IVe République : la Délégation générale des Indochinois[ix], le Parti national malgache[x], le Mouvement démocratique de la rénovation malgache[xi], l’organisation dite Jeunesse Nationaliste[xii], l’Association générale des étudiants vietnamiens en France[xiii], l’Union des vietnamiens de France[xiv], l’Association nationale des rapatriés d’Indochine[xv], l’Association France-Vietnam[xvi], le Mouvement national algérien[xvii], le Front de libération nationale[xviii], l’Union générale des étudiants musulmans algériens[xix], l’Amicale générale des travailleurs algériens résidant en France[xx], l’Union des populations du Cameroun[xxi], le Mouvement populaire de la Côte française des Somalis[xxii], le Front commun antillo-guyanais[xxiii], le Rassemblement démocratique des populations tahitiennes[xxiv] ou encore le parti politique dénommé Pupu Tiama Maohi[xxv].
Dans l’écrasante majorité des cas, le Conseil d’État valida ces dissolutions.
Près de soixante ans après les indépendances officielles des anciennes colonies, le pouvoir français continue de chercher, avec la dissolution aujourd’hui du CCIF, mais aussi de BarakaCity ou de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie (CRI), à briser les résistances indigènes.
La lutte contre l’islamophobie, un appel à la haine ?
Il convient de préciser que le motif de dissolution n’est pour autant plus le même. Si les organisations indépendantistes avaient vu leur dissolution justifiée pour « atteinte à l’intégrité du territoire national » (puisque l’indépendance aboutit à ce que l’État perde sa souveraineté sur une partie de son territoire), celle du CCIF est motivée, selon le Conseil d’État, par une « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une religion ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager ».
En revanche, le Conseil d’État censure l’appréciation de l’Exécutif selon laquelle le CCIF se serait livré à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme. Mais, à ses yeux, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales justifie à elle seule la dissolution.
Ce dernier motif n’était à l’origine pas prévu par la loi du 10 janvier 1936, qui ne se préoccupait à l’époque que des groupes de combat, des milices privées et des groupements sécessionnistes ou anti-républicains.
C’est la loi Pleven du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme qui, en plus de créer les délits spécifiques d’injure et diffamation à caractère raciste et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales, permit de procéder à la dissolution administrative des organisations « racistes ».
Ainsi, par un formidable retournement, une loi destinée à lutter contre le racisme sert de support à la dissolution d’une organisation antiraciste !
Pour aboutir à cette conclusion, le Conseil d’État a suivi le raisonnement suivant, qu’il convient de citer in extenso pour en saisir la portée :
« (…) il ressort des pièces du dossier que le CCIF, par la voie de ses dirigeants et de ses publications, tient depuis plusieurs années des propos sans nuance visant à accréditer l’idée que les autorités publiques française mèneraient, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un combat contre la religion musulmane et ses pratiquants et que, plus généralement, la France serait un pays hostile aux musulmans. Le CCIF entretenait toujours, à la date du décret attaqué, des liens étroits avec des tenants d’un islamisme radical invitant à se soustraire à certaines lois de la République. En particulier, M. F…, qui a été le porte-parole de l’association de 2010 à 2014, puis son directeur exécutif de 2016 à 2018, et qui en était toujours, avant la dissolution de l’association, membre d’honneur, a tenu publiquement des propos tendant à relativiser, voire à légitimer, les attentats contre le musée juif de Bruxelles en 2014 et contre le journal Charlie Hebdo en 2015, et promu l’idée d’une suprématie de la communauté musulmane. Le CCIF a fait, encore en 2020, la promotion des thèses de M. G…, ancien trésorier de l’association djihadiste Anâ-Muslim auto-dissoute en 2014 après le gel de ses avoirs, qui a légitimé à plusieurs reprises le recours au terrorisme. Le CCIF suscite régulièrement, par les messages qu’il délivre sur ses comptes ouverts sur les réseaux sociaux, des commentaires antisémites et hostiles aux autres croyances auxquels il n’apporte aucune modération. (Ces agissements) étaient de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une religion ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager. Ils sont ainsi de nature à justifier la dissolution de l’association CCIF sur le fondement du 6° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sans que puissent y faire obstacle les circonstances qu’aucun de ces agissements n’avait fait l’objet, à la date du décret attaqué, de condamnations ou de poursuites pénales et que l’association aurait jusqu’alors entretenu de bonnes relations avec les autorités publiques. »
Si les accusations d’entretien de relations étroites avec « des tenants d’un islamisme radical invitant à se soustraire à certaines lois de la République » et d’absence de modération des commentaires « antisémites et hostiles aux autres croyances » prêtent largement le flan à la critique, une autre accusation sort cependant du lot : la dénonciation de l’islamophobie d’État.
Pour raccourcir le raisonnement de la Haute juridiction, « des propos sans nuance visant à accréditer l’idée que les autorités publiques française mèneraient, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un combat contre la religion musulmane et ses pratiquants et que, plus généralement, la France serait un pays hostile aux musulmans » sont de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une religion ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager.
Ces termes font étrangement écho aux propos de Gilles Kepel, relatés supra, selon lesquels le CCIF devrait être combattu au motif qu’il « fait passer la France (…) comme un goulag pour musulmans »…
En d’autres termes encore, dire que l’État français est raciste, c’est du racisme.
L’on serait tentés de rire franchement devant le grotesque de la situation, si elle ne constituait pas un précédant qui entraînera des conséquences qui s’avèreront graves pour le camp des dominés.
Déjà, la dénonciation de l’islamophobie d’État devient, grâce à cette décision du Conseil d’État, un nouvel argument pouvant justifier une dissolution administrative. C’est en effet fort de cet arrêt que Gérald Darmanin a initié la dissolution du CRI au motif, entre autres que « sous couvert de dénoncer des actes d’islamophobie, la CRI distille par ses publications en ligne et l’instrumentalisation de tout évènement mettant en cause des personnes de confession musulmane ou affectant, d’une manière ou d’une autre, l’image de l’islam, un message incitant à percevoir les institutions françaises comme islamophobes, alimentant ainsi un soupçon permanent de persécution religieuse de nature à attiser la haine, la violence ou la discrimination envers les non-musulmans »[xxvi].
Mais plus encore, il est à craindre que la dénonciation du racisme d’État ne s’autonomise et ne devienne, à l’avenir, un motif justifiant à lui seul qu’il soit procédé à une dissolution. Dans sa décision du 24 septembre 2021 validant la dissolution du CCIF, le Conseil d’État a pris le soin « d’enrichir » ce qui caractérisait selon lui un appel à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, en prenant la peine de mentionner également les liens entretenus par le Collectif avec des groupes « islamistes radicaux » et l’absence de modération de sa page sur les réseaux sociaux. Mais jusqu’à quand ?
Plus que jamais, la bataille des idées doit être menée pour démontrer et convaincre le champ politique indigène, mais aussi et surtout le champ politique blanc, que la lutte contre l’islamophobie, loin d’être un appel à la discrimination ou à la haine, est un projet émancipateur.
Qu’à l’heure où l’extrême droite récolte plus d’un tiers des intentions de vote aux prochaines présidentielles, dire que la présence du voile et des immigrés dans l’espace public n’est pas un problème est émancipateur.
Qu’alors que l’universalisme français, refusant de reconnaître l’existence des races sociales sur son territoire, rend la France aveugle aux discriminations pourtant subie par les Musulmans qui y vivent, faire connaître et reconnaître l’islamophobie est émancipateur.
Que pendant que l’armée française déploie ses forces à l’extérieur pour maintenir sa présence sur le sol de nombreux pays africains et musulmans sous couvert de « lutte contre le terrorisme », exiger le retrait des troupes et le plein respect de l’autodétermination des peuples est émancipateur.
La dissolution du CCIF doit en outre nous servir de leçon quant à l’échec, prévisible, d’une stratégie intégrationniste. En l’état actuel des rapports de force politique, l’identité nationale française, telle qu’elle résulte de l’histoire coloniale de l’État-nation, réserve sa citoyenneté véritable aux seuls de ses ressortissants qui sont reconnus comme « Blancs ». Les Musulmans, en l’état actuel des choses, ne sont pas (aussi) la Nation, et doivent s’auto-organiser et instaurer un rapport de force politique qui leur est favorable pour y parvenir.
Si le CCIF s’est lancé dans une politique de respectabilité, en étant reconnu à l’international par l’Organisation des Nations Unies (ONU) et en interne par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), ces relations n’ont pas suffi à le sauver.
Comme le dit le Conseil d’État lui-même, les agissements reprochés au CCIF sont de nature à justifier sa dissolution, « sans que puissent y faire obstacle les circonstances (…) que l’association aurait jusqu’alors entretenu de bonnes relations avec les autorités publiques ».
Yanis Sedrati
[i] CCIF, Rapport annuel 2020, https://issuu.com/ccif/docs/rapport_ccif_2020.
[ii] P. Bruckner, « Le chantage à l’islamophobie », Le Figaro, 5 novembre 2003, http://www.juif.org/blogs/14195,le-chantage-a-l-islamophobie-par-pascal-bruckner.php.
[iii] C. Fourest et F. Venner, « Ne pas confondre islamophobes et laïcs », Libération, 17 novembre 2003, https://www.liberation.fr/tribune/2003/11/17/ne-pas-confondre-islamophobes-et-laics_452092.
[iv] https://www.liberation.fr/france/2016/11/17/terrorisme-le-ministre-et-le-professeur_1528968.
[v] https://ripostelaique.com/pourquoi-il-faut-dissoudre-le-ccif-et-expulser-ses-dirigeants.html.
[vi] https://rassemblementnational.fr/communiques/manuel-valls-doit-initier-la-dissolution-du-ccif.
[vii] Décret du 13 février 1936, JO du 14 février 1936, p. 1882.
[viii] JO du 27 janvier 1937, p. 1077.
[ix] Décret du 18 octobre 1945, JO du 19 octobre 1945, p. 6684.
[x] Décret du 10 mai 1947, JO du 11 mai 1947, p. 4389 et rectificatif JO du 15 mai 1947, p. 4524.
[xi] Décret du 10 mai 1947, JO du 11 mai 1947, p. 4389 et rectificatif JO du 15 mai 1947, p. 4524.
[xii] Décret du 10 mai 1947, JO du 11 mai 1947, p. 4389 et rectificatif JO du 15 mai 1947, p. 4524.
[xiii] Décret du 14 juin 1950, JO du 15 juin 1950, p. 6317.
[xiv] Décret du 28 septembre 1950, JO du 30 septembre 1950, p. 10158.
[xv] Décret du 16 avril 1953, JO du 17 avril 1953, p. 3566.
[xvi] Décret du 16 avril 1953, JO du 17 avril 1953, p. 3566.
[xvii] Décret du 29 juin 1957, JO du 30 juin 1957, p. 6501.
[xviii] Décret du 29 juin 1957, JO du 30 juin 1957, p. 6501.
[xix] Décret du 27 janvier 1958, JO du 30 janvier 1958, p. 1091.
[xx] Décret du 23 août 1958, JO du 24 aout 1958, p. 7889.
[xxi] Décret du 13 juillet 1955, JO du 14 juillet 1955, p. 7055.
[xxii] Décret du 13 juillet 1967, JO du 14 juillet 1967, p. 7080.
[xxiii] Décret du 22 juillet 1961, JO du 25 juillet 1961, p. 6784.
[xxiv] Décret du 5 novembre 1963, JO du 6 novembre 1963, p. 9887.
[xxv] Décret du 5 novembre 1963, JO du 6 novembre 1963, p. 9887.
[xxvi] Décret du 20 octobre 2021, JO du 21 octobre 2021.