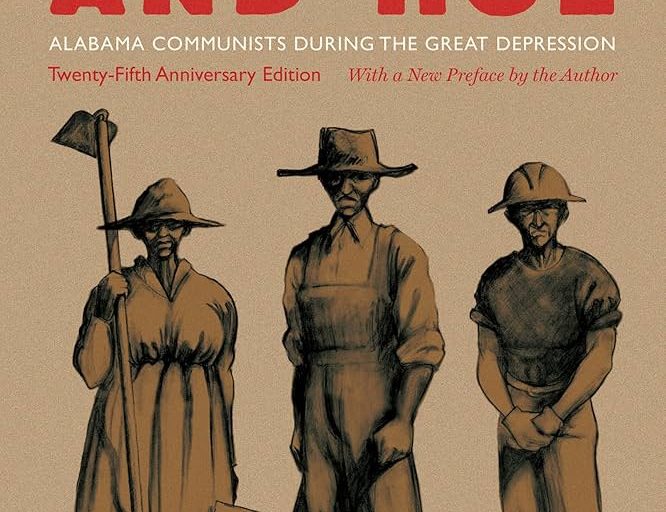À propos du livre Les Territoires conquis de l’islamisme de Bernard Rougier.
Il est rare qu’un livre qui se veut universitaire bénéficie d’une telle couverture médiatique et pourtant, tel a été le cas pour Les territoires conquis de l’islamisme, rédigé sous la direction de Bernard Rougier. Il faut dire que cet ouvrage entre pile dans l’inquiétude du moment autour du « problème » de l’Islam de la (ou en) France et des polémiques sur le « communautarisme » et le « séparatisme » musulman. Accompagné de ses étudiants, Bernard Rougier a la ferme volonté, selon ses dires, d’aborder la question de manière frontale, sans fioriture ou angélisme. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait peu de cas de toute rigueur scientifique ou éthique.
Une prétention non idéologique et une méthodologie qui interroge
Dès les premières lignes, Bernard Rougier (politologue et spécialiste du Moyen-Orient, de l’islam et notamment du salafisme) nous annonce l’objectif principal du livre : rompre avec tous les travaux autour des thèmes de l’islam, de l’islamisme et de la radicalisation. Ces derniers favoriseraient trop « la dimension psychologique et intrafamiliale au détriment d’une analyse sociologique et idéologique » (p. 9), car ils auraient le souci, nous dit-il, de ne pas fournir de la matière à l’extrême-droite dans leurs discours idéologiques. D’après lui, cette focale sur la radicalisation individuelle empêcherait de cerner les évolutions de l’islamisme en France et de faire un « diagnostic objectif et empirique sur les situations locales les plus inquiétantes en termes de cohésion nationale » (p. 9), tout en occultant les liens avec l’islamisme qui sévirait au Moyen-Orient et au Maghreb. Pire encore, cette approche du phénomène de la « radicalisation » serait instrumentalisée par les jihadistes eux-mêmes, puisqu’elle leur fournirait « un mode de défense clé en main » (p. 10), profitant ainsi de l’aveuglement des chercheurs, bien heureux de trouver confirmations de leurs hypothèses.
À peine trois pages et nous nous confrontons déjà à l’un des soucis majeurs du livre : le parti pris contre tous les travaux de sciences humaines menés jusque-là sur le thème de la radicalisation[1] à tendance islamique, sous le prétexte qu’ils n’oseraient pas aller au fond de la question par crainte des répercussions politiques et/ou par paresse intellectuelle. Certes, ces accusations sont graves et elles nous rappellent les réprimandes sur la « bien pensance » chère à l’extrême-droite, mais nous aurions pu accorder le bénéfice du doute aux attaques portées par Bernard Rougier si seulement ses accusations étaient accompagnées d’un minimum de démonstration. Mais il n’en est rien. Aucune source, aucun exemple, aucune illustration de ce qui, selon lui, poserait problème dans ces travaux. Cela reste un mystère.
Le livre lui-même souffre d’un manque criant de sources scientifiques. Il n’y a pas de bibliographie à la fin de l’ouvrage ou à la fin de chaque chapitre, et on peut comprendre facilement ce choix tant les références sont faméliques dans une grande partie des contributions. Que les auteurs décident de ne pas s’appuyer sur la riche production des sciences humaines autour du thème de la radicalisation et du terrorisme parce que celle-ci serait trop complaisante avec le phénomène islamiste et trop « idéologique » passe encore… Néanmoins, il est incompréhensible de noter qu’il n’y a pas non plus, ou alors très peu, de références aux écrits autour de la sociologie du phénomène religieux, et pas seulement islamique, ou bien autour de la sociologie des classes et quartiers populaires, puisqu’ils sont le public et le territoire visés, ou bien encore de diversification des sources au niveau des théologiens et islamologues, surtout lorsqu’on a pour objectif de traiter de certains courants religieux, comme le salafisme. Ainsi, nous avons l’impression que les auteurs sont simplement armés de leurs prénotions, apparemment directement nourries par le discours médiatique et politique autour de cette thématique, et qu’ils analysent d’une façon triviale des sujets pourtant particulièrement sensibles et complexes.
La méthodologie interroge tout autant. D’abord parce qu’à de rares exceptions près, nous n’avons pas de description détaillée de la méthodologie employée et on semble davantage se rapprocher de l’enquête policière que de l’enquête sociologique. Ensuite, parce que les auteurs font parfois fi de toute la rigueur scientifique que demande un tel travail, surtout académique, et qu’ils nous assènent des analyses dignes des pires intellectuels médiatiques s’exprimant sur « l’islamisation » : « Argenteuil est sans doute l’une des villes les plus islamisées de France. […] Il suffit de se déplacer en pleine journée dans les rues d’Argenteuil pour constater que les tenues islamiques sont non seulement portées par les femmes, ce qui est de plus en plus courant en France, mais aussi par beaucoup d’hommes, ce qui est moins répandu dans l’Hexagone. » (p. 185) Enfin, les faiblesses méthodologiques et conceptuelles doivent d’autant plus être soulevées que le livre a la prétention d’être totalement « neutre » du point de vue idéologique, les différents chapitres dépeignant un tableau « objectif » et sans concession de l’emprise de l’islamisme en France. La revendication d’une « neutralité » idéologique est même l’argument majeur de Bernard Rougier pour assurer la spécificité de son ouvrage sur la question.
Il est important, avant de parler plus en détail du livre, de revenir sur le terme « idéologique » qui revient à plusieurs reprises au cours de l’ouvrage et est même le titre de la première partie. Le mot est essentiellement utilisé péjorativement, dans le but de discréditer soit la manière dont la « radicalisation » a été traitée jusque-là en sciences humaines, soit la manière dont certains musulmans, jugés trop « radicaux », conçoivent l’islam. Toutefois, malgré sa répétition, nous n’avons jamais de définition claire de ce que les auteurs entendent par « idéologie », qui s’avère être cantonnée à une forme négative, désignant une action intéressée politiquement ou intellectuellement. Il est étonnant de voir un politologue, dans un ouvrage publié dans une maison d’édition universitaire, avoir un usage aussi hasardeux du terme « idéologique ». Il est encore plus problématique de constater que Rougier s’imagine être épargné par le danger de tomber dans une analyse « idéologique », sous le seul prétexte de sa bonne foi. L’ouvrage serait totalement neutre et objectif, débarrassé de toute velléité idéologique, et c’est pour cela qu’il trancherait dans le vif, d’où son intérêt.
Malheureusement pour les auteurs, ce n’est pas le cas. Mais comment cela aurait-il pu l’être ? La déconstruction du mythe de la neutralité du chercheur est normalement un fait accompli pour tout élève ayant une licence en sciences sociales. Nous ne pouvons pas passer outre le fait qu’un professeur d’Université tombe dans un tel piège, surtout lorsqu’on a l’impression que le but est de donner du crédit aux discours islamophobes actuels, car tel est bien l’objectif de ce livre. Au lieu de prendre leurs distances avec le discours commun, étape primordiale de tout chercheur un tant soit peu sérieux, Bernard Rougier et ses élèves préfèrent, au contraire, en être la caution académique.
La « conquête islamiste », de la théorie à la pratique
Le livre est divisé en trois parties, les deux premières, nommées « Idéologies » et « Quartiers », visent à décrire respectivement la théorie et la pratique des islamistes en France. Elles s’articulent et fonctionnent de pair. Avant de montrer de quelle manière les islamistes ont « conquis » des territoires français, les auteurs nous proposent de plonger dans leurs idéologies. Ces deux parties révèlent les autres grandes limites du projet de Rougier et Cie, en mêlant généralisation abusive, sophisme par association et surtout approximations et méconnaissances sur l’islam, ses croyants, ses pratiques et ses significations. Ce point est d’autant plus problématique que le livre se targue d’être rédigé soit par des personnes spécialistes de la question, en premier lieu Bernard Rougier, soit par des personnes concernées par l’islam, étant elles-mêmes musulmanes. La troisième partie, intitulée « prison », est plus anecdotique, mais, paradoxalement, l’avant-dernier chapitre illustre par contraste de nombreuses faiblesses dans les autres productions.
La production et diffusion de l’idéologie islamiste
La partie « Idéologie » traite du contenu et de la production théorique des « islamistes », mais aussi sa diffusion et les débats internes. Si Rougier possède des connaissances factuelles sur tous les débats, tensions, et controverses qui peuvent exister entre des cheikhs dans la production théologique de divers courants que l’on pourrait qualifier de « rigoristes », on regrette néanmoins que cela reste brouillon et superficiel. Les écrits de ces savants sont explorés de façon trop expéditive et caricaturale. On se perd dans l’énumération des noms, sur lesquels on ne s’attarde jamais, et sur tous les conflits qui peuvent exister entre eux, notamment entre les multiples courants que les auteurs ont tendance à mélanger de manière grossière : les frères musulmans (de quel pays ?), le salafisme (quelle tendance ?), le wahhabisme, le takfirisme, etc. La confusion est accentuée par l’affirmation des auteurs selon laquelle ils tendent tous vers le jihadisme. Nous parvenons tout de même à comprendre qu’il existe une production théologique d’un islam rigoriste, littéraliste, réactionnaire et profondément conservateur en provenance du Moyen-Orient qui imprègnerait maintenant le quotidien des musulmans de France.
L’une des principales idées du livre est que la production idéologique islamiste est réalisée dans le Maghreb et le Moyen-Orient, avant d’être transmise en France, par plusieurs voies. La première est celle des imams, soit en provenance du monde arabe, soit nés en France, mais ayant suivi leur formation dans cette région. La seconde est la production littéraire, un chapitre y est consacré et c’est la seule fois où nous pourrons profiter d’un minimum d’outils statistiques pour étayer les hypothèses – quand bien même la catégorisation des livres pose question. Enfin, le troisième moyen de diffusion sont les réseaux sociaux et internet : forums, sites internet, pages Facebook, mais aussi applications de communication comme WhatsApp.
S’il y a effectivement une transmission – à l’heure de la mondialisation et des nouveaux outils de communication, comment en serait-il autrement ? –, il aurait été davantage pertinent d’interroger les manières par lesquelles ces discours sont réceptionnés par le public musulman français : comment reçoivent-ils ces discours ? Quelles interprétations en font-ils ? Quel jugement portent-ils dessus ? Quel est le degré d’adhésion ? À quels niveaux ? Existe-t-il un rejet ? Comment cela se répercute sur leur façon de concevoir et pratique leur religion ? Etc. À ces questions, nous n’avons aucune réponse. À en croire les contributeurs, les musulmans constituent une masse amorphe, un simple réceptacle sans capacité d’agir, de réagir ou de réfléchir, qui incorporent sans broncher, entièrement et tel quel, toute la théologie réactionnaire en provenance du Moyen-Orient – dont on nous livre l’image caricaturale d’une région absolument dominée par les « islamistes » et leur théologie rétrograde –, nous donnant comme seule illustration des enquêtés allant dans le sens de leur assertion.
Salafisme partout, définitions nulle part
Malgré cet inquiétant tableau d’une France et de tout un monde arabo-musulman imprégnés d’un salafisme conquérant, une question reste toujours en suspens : qu’est-ce que le salafisme ? Le livre ne nous donne aucune réponse réellement claire. Nous avons, par-ci par-là, au gré des chapitres, des bribes de définitions, mais celles-ci sont tellement vagues et générales, et parfois même contradictoires, que l’on demeure dans le flou. Il est impossible de distinguer un islam salafiste d’un islam non salafiste. Au fil des pages naît en nous cette étrange impression que les auteurs n’ont pas une grande connaissance de la pratique de l’islam, en particulier en France, et catégorisent énormément de choses, souvent à tort, comme du « salafisme ». C’est une lacune particulièrement fâcheuse pour un ouvrage quasiment consacré à ce sujet.
La confusion autour de cette question est en grande partie liée à la conception dichotomique qu’ont les auteurs de l’islam et de sa pratique. Il existerait ainsi deux camps principaux, deux lectures, deux interprétations de la religion islamique : l’une est libérale et plus « spirituelle », cantonnant la religion à la sphère du privé dans une relation exclusivement individuelle à Dieu. Elle serait aussi ouverte aux diverses interprétations, souple et tolérante en termes de pratique, séculière, et surtout, dans cette conception, l’islam n’occuperait pas une place centrale pour les croyants. Cette conception bénéficie du regard bienveillant des auteurs. L’autre est « salafiste », elle accorderait une importante primordiale à la pratique, avec une approche rigoriste, littéraliste et traditionnelle. De plus, elle aurait une conception « communautaire » de l’islam, dans laquelle la religion occuperait une place centrale pour les fidèles, rythmant leur quotidien et se pratiquant de façon visible, donc « prosélyte » si l’on adopte le point de vue des auteurs, qui s’y opposent frontalement.
Nous pouvons constater une tendance grandissante dans le champ politique et médiatique, et donc même académique comme nous le voyons ici, à voir dans une pratique « trop » régulière, marquée ou visible de l’islam un signe de « salafisation ». Dans Territoires conquis de l’islamisme, les exemples cités laissent souvent perplexe, comme lorsqu’ils notent comme signe de « salafisme » l’achat de produits « islamiques » pourtant populaires chez les musulmans, tels le musc, le siwak, le djelbab (portée par de nombreuses musulmanes non voilées pour la prière ou pour se rendre à la mosquée) (p. 34), etc. ; ou bien le fait de se rincer le nez de façon « démesurée » (p. 204), ce qui nous pousse à nous demander quels sont les critères d’évaluation d’un rinçage de nez, et l’échelle de mesure permettant jauger s’il est « démesuré » ou non.
L’ouvrage fait alors écho à toutes les polémiques politico-médiatiques du moment, et notamment aux désirs du gouvernement de réagir face au « communautarisme » et à « l’islamisme », notamment en appelant à une « société de la vigilance » pour faire face à la « radicalisation islamiste ». Impossible de ne pas faire le parallèle avec la liste des « signes de radicalisation » dressée par Christophe Castaner, puisque l’ouvrage en adopte certains, comme la pratique régulière de la prière, le port de la barbe ou une pratique plus intense du ramadan. Or, cela correspond parfois aux piliers mêmes de la religion musulmane. La quasi-totalité des fidèles reconnaît la prière comme une obligation, quand bien même ils ne la respectent pas. Le ramadan est aussi un exemple éclairant puisqu’il est un mois sain durant lequel les musulmans se doivent d’être plus intensifs dans leur dévotion à Allah, sans oublier qu’il est un évènement majeur et très suivi dans la communauté musulmane, même par les moins pratiquants. À ce rythme, respecter les 5 piliers de l’islam à la lettre pourrait presque être considéré comme du salafisme. La pente glissante de l’amalgame apparaît sous nos yeux, le livre nous explique que du salafisme, même quiétiste, au jihadisme il n’y a qu’un pas, et en même temps sa définition nébuleuse nous laisse à penser qu’un pratiquant un peu trop zélé est un salafiste en puissance…
Une vision conspirationniste de la « conquête islamiste »
Contrairement aux allégations de Rougier, l’ouvrage est loin d’être « neutre » idéologiquement parlant. Il emprunte plutôt sa phraséologie et ses raisonnements aux discours islamophobes, que ce soit dans la généralisation, la méconnaissance, l’amalgame de toutes pratiques au salafisme, et du salafisme au jihadisme. De même qu’il adopte une vision quasi conspirationniste de l’infiltration des « islamistes » dans la vie militante – dont l’un des chevaux de Troie serait le Comité Contre l’Islamophobie en France (CCIF) –, et dans la vie politique, notamment dans les « territoires conquis » que seraient les « quartiers ». Après avoir placé la focale sur la théorie, la deuxième partie de l’ouvrage s’attache à dévoiler la pratique, c’est-à-dire la manière par laquelle les islamistes conduisent leur stratégie de conquête. Dans cette partie, l’amalgame est accentué, nul besoin de sonder les habitudes religieuses des personnes citées – on pourrait d’ailleurs questionner l’éthique de l’enquête en matière de dévoilement des noms –, puisque le simple fait de revendiquer son islamité, ou alors d’avoir un prénom à consonance musulmane suffit à faire peser sur elles, dans le meilleur des cas, le soupçon de la collaboration naïve à l’islamisme.
Le soupçon est d’ailleurs ce qui pèse perpétuellement sur les musulmans, indépendamment de leurs croyances, pratiques, ou même propos. Les auteurs ont comme présupposé que les « islamistes » ont conquis des territoires français et sont parvenus à imposer leur conception de l’islam. À partir de là, toutes les données dont ils disposent sont utilisées pour appuyer leurs hypothèses. Lorsque des musulmans paraissent corroborer leurs prénotions, ils les citent fidèlement et les croient sur parole, sans prendre de distance avec ce que l’enquêté leur dit. Mais lorsque ces mêmes musulmans sont plus nuancés, ou entrent en contradiction avec l’idée directrice du livre, comme lorsque des imams condamnent certaines dérives dans la pratique, dans l’intolérance religieuse, ou s’opposent ouvertement aux jihadistes, les chercheurs mettent en doute ces déclarations, les renvoyant à des formes de taqiya (accusation bien courante dans la droite et l’extrême-droite), c’est-à-dire une dissimulation plus ou moins élaborée de leurs intentions réelles derrière des propos d’ouverture et de tolérance. C’est le cas lorsqu’ils accusent les « Frères musulmans » de faire mine de vouloir lutter contre la radicalisation, alors qu’ils chercheraient en réalité à « élargir leur influence auprès des pouvoirs publics » (p. 27), ou bien lorsque Bernard Rougier et Hector Dubois nous expliquent que le groupe qu’ils étudient « n’est pas ʺjihadisteʺ au sens où l’entend la nomenclature académique et policière », mais l’est quand même un peu, car « ils ne cachent pas leur ambition de livrer une guerre culturelle à la société et à l’État au nom de leur conception de l’islam. » (p. 197).
La focalisation sur « l’islamisme » aux dépens des autres problématiques
Tous ces défauts sont aggravés par le fait que les chercheurs ne font mention à aucun moment de l’atmosphère islamophobe actuelle. Pire que cela, ils en contestent le terme et son utilisation à plusieurs reprises. Sentant l’accusation d’islamophobie peser sur son ouvrage, Rougier s’imagine que la prédire dès le début du livre lui permet de s’en défaire à moindres frais, certifiant qu’elle est pour lui d’ores et déjà infondée. Il se targue avant tout d’avoir dans ses contributeurs une majorité de personnes musulmanes. Comme il l’explique dans une interview, mettre en avant l’origine ethnico-religieuse de ses élèves le met mal à l’aise, mais il parvient à surmonter cet obstacle puisque cela lui permet d’avoir des cautions pour se disculper de tout racisme. Ensuite, si la présence de « premiers concernés » dans l’ouvrage ne suffit toujours pas à faire taire tout soupçon autour du livre, Bernard Rougier a un argument massue : il ne peut être islamophobe puisqu’il a vécu une grande partie de sa vie dans le monde arabe[2]. Enfin, si le doute persiste, les auteurs n’en ont cure, car le terme « islamophobie » est tout bonnement récusé. Effectivement, il serait, en réalité, une arme aux mains des islamistes et de leurs idiots utiles imagine-t-on, permettant « de faire avancer un agenda islamiste » (p. 21) et « d’intimider ceux qui, de plus en plus rares, s’efforcent de rattraper le temps perdu en reconstituant un savoir objectif sur ce qui se passe réellement dans les quartiers des grandes villes, avant que divers courants religieux n’investissent le terrain et en gagnent les esprits et les cœurs » (p. 15).
Ce rejet du terme « islamophobie » et le silence assourdissant autour des discriminations sociales et raciales dont sont victimes les musulmans expliquent surement pourquoi l’antiracisme politique et le mouvement décolonial français se voient consacrer un article dans la partie « Idéologie ». Après nous avoir fait un descriptif très sombre des discours réactionnaires qui animeraient le quotidien des musulmans de France, le livre essaie tant bien que mal de créer un lien avec tout le champ militant antiraciste et décolonial, ce qui laisse perplexe. En effet, des organisations comme le Parti des Indigènes de la République (PIR) ou le CCIF sont accusées soit d’être islamistes, soit de vouloir s’allier avec eux. Les attaques à leur encontre témoignent d’une malhonnêteté intellectuelle manifeste, caricaturant leurs positions politiques et idéologiques, voire tronquant certains de leurs propos pour en donner des interprétations parfois opposées à l’idée de base. À titre d’exemple, l’auteur cite l’article d’Houria Bouteldja « Mohamed Merah et moi », mais en donne une version hachée, ne laissant apparaître que les moments où elle se compare à Mohammed Merah, sans jamais préciser qu’elle si dissocie à la fin et qu’elle condamne son acte. Nous sommes même parfois à la limite du diffamatoire lorsqu’il est écrit qu’il existe « des liens organiques entre militants décoloniaux et mouvements jihadistes » (p. 77). Cependant, la démonstration des tentatives d’approche entre les deux camps est bancale. Une telle alliance est peu probable entre ces deux univers, tant leurs façons de concevoir la politique s’avèrent différentes. C’est d’ailleurs la conclusion de l’article en question, qui ajoute même que l’antiracisme politique est divisé entre, d’une part, une approche dans laquelle la « question raciale » est centrale, comme au PIR, et d’autre part, l’approche intersectionnelle du Comité Justice et Vérité pour Adama – un collectif qui lutte contre les violences policières. On en vient donc à se demander quel est l’intérêt de cet article, placé dans la partie « Idéologie », si ce n’est de discréditer à peu de frais tout un champ militant qui lutte notamment contre l’islamophobie.
C’est pourquoi il n’est pas étonnant de voir la question des discriminations pesant sur les musulmans en France, mais aussi dans le monde, occuper peu de place dans le livre. Celles-ci sont renvoyées à des « causes victimaires » (p. 121) ou des « griefs à caractère communautaire » (p. 128). Pourtant, les auteurs nous expliquent que les musulmans tendent à opter pour une approche de l’islam prônant une rupture avec le modèle républicain français, donnant la part belle au séparatisme et au communautarisme. L’affirmation reste encore à démontrer, mais, si cela était effectivement le cas, est-il correct d’en trouver la cause uniquement du côté d’une prédication islamiste ? Certes, les auteurs font parfois état des conditions socio-économiques précaires des enquêtés, soulignant que les « quartiers conquis » sont aussi des zones où habitent des populations pauvres ou dans lesquelles les services publics sont absents, mais les principaux coupables de cette situation délétère restent les islamistes et les pouvoirs publics trop complaisants à leur égard. Toutefois, il y aurait très certainement des explications à trouver à cette volonté de « rupture » que peuvent émettre des musulmans si l’on cherche du côté des diverses discriminations qu’ils subissent – chômage, violences policières, échecs scolaires, stigmatisation, etc. -, les amenant à penser qu’ils sont traités comme des citoyens de seconde zone et que le pacte social et républicain a d’abord été rompu par l’État et les responsables politiques.
Des territoires pas si conquis…
Si l’on se fie au livre, l’islamisation paraît bien avancée, en témoigne ces titres sans équivoques : « Marne-La-Vallée à l’heure Yéménite », « Construction d’un écosystème islamique : le cas d’Aubervilliers », « Toulouse : la machine de prédication, ou la fabrication sociale du jihadisme ». Tout est fait pour créer une atmosphère anxiogène et inquiétante dans laquelle l’emprise des « islamistes » sur ces villes serait totale et conduirait à ce que les « Français d’origine européenne » n’osent plus se rendre dans certains quartiers (p. 157). Pourtant, lorsque nous regardons de plus près, nous voyons que le phénomène se concentre sur des petits groupes de musulmans. Le cas de chapitre sur le « Yémen » est à ce titre révélateur du procédé discutable qui est emprunté. Il est vrai que dans un travail de sociologie nous devons parvenir à une montée en généralité, mais dans le cas présent, celle-ci prend une proportion assez déroutante. En effet, dans le chapitre en question l’étude n’est pas portée sur les pratiques et mode de vie des musulmans de Marne-La-Vallée qui tendraient de plus en plus à emprunter à ceux des Yéménites – et il faudrait alors nous expliquer en quoi cela pose problème –, mais plutôt sur une petite partie d’entre eux qui entretiendrait plus ou moins des liens avec les luttes politiques et théologiques au Yémen. Mais, sans que l’on sache pourquoi, ce groupe, de taille réduite, serait représentatif de la communauté musulmane de la ville et disposerait d’un pouvoir politique et idéologique important. Le même procédé est appliqué à chaque fois.
Cependant, au fil des lignes, on comprend que les « conquêtes » sont fortement à nuancer : elles ne se matérialisent pas véritablement par des victoires politiques concrètes et nous restons tout au plus dans le symbolique. Comme nous l’avons souligné plus haut, le livre fait écho aux polémiques actuelles autour des listes dîtes « communautaires » – terme qu’il est urgent d’interroger, celui-ci semble être réservé aux listes avec une forte propension de personnes issues de l’immigration postcoloniale et/ou ne cachant par leur islamité –, et la lecture des Territoires conquis de l’islamisme peut difficilement convaincre d’autres personnes que celles déjà convaincues de la prégnance de l’islamisme dans les mairies des « banlieues » françaises.
Le cas de l’article sur la ville d’Aubervilliers est à ce titre exemplaire : il est un condensé de toutes les approximations et limites méthodologiques, scientifiques et éthiques de l’ouvrage. L’auteur de l’article nous parle du clientélisme, un problème assez répandu qui touche de nombreuses communes, en particulier en période d’élections municipales, mais dans le cas d’Aubervilliers on saisit que le problème est plus grave encore puisqu’il s’agit de clientélisme « communautariste » voire « islamiste ». Sans nier la part de clientélisme qui peut y exister, le terme peut parfois être utilisé ici à mauvais escient. Peut-on réellement considérer comme du « clientélisme » le fait que, dans une commune dans laquelle réside une forte communauté musulmane, les responsables politiques soient à l’écoute des demandes et réclamations de cette population ? Le rôle de ces élus n’est-il justement pas de tenter de répondre aux besoins de ses habitants ? Enfin, l’accusation de « salafisme », « islamisme » ou bien de complicité ou collaboration, est portée à l’encontre d’acteurs de la ville, jamais anonymisée, sans que cela ne paraisse être justifié, principalement lorsque l’auteur se permet de porter des insinuations plus que douteuses sur leurs intentions et leurs actions, les accusant de pratiques délinquantes : « un système de pouvoir autonome a vu le jour avec lequel les responsables de la mairie doivent par la suite composer, sous peine de subir des sanctions collectives (incendies de véhicule, émeutes) ou individuelles (menaces physiques, agressions) » (p. 124). Ces attaques sont d’autant plus graves que, comme nous l’avons souligné, les noms des enquêtés ne sont pas anonymisés. Ce choix interroge surtout lorsque l’on sait que la majorité des contributeurs du livre ont opté pour des pseudos, de crainte, nous dit Rougier, de recevoir des menaces. On ne peut que regretter que celui-ci n’ait pas été aussi regardant à l’encontre des musulmans interrogés, surtout lorsque l’on sait à quel point les actes islamophobes se font de plus en plus violents.
Conclusion : les territoires conquis de l’islamophobie…
Le livre se conclut sur une troisième partie consacrée à la prison, qui relève un peu, malgré elle, le niveau de l’ouvrage, en particulier l’avant-dernier chapitre de François Castel de Bergerac. Certes, il souffre de lacunes habituelles que l’on trouve au fil de la lecture, notamment la surinterprétation par l’islamisme, ce qui le conduit à penser que si ces prisonnières s’insurgent contre les fouilles corporelles parfois abusives qu’elles peuvent subir, ou bien lorsqu’elles demandent le droit à davantage de douches, c’est seulement parce qu’elles ont embrassé une pratique salafiste de l’islam dans laquelle la pureté du corps serait une chose cruciale, alors que ces plaintes et ces demandes doivent certainement être partagées par de nombreux prisonniers non musulmans. Néanmoins, l’article se démarque un tant soit peu et révèle les faiblesses et carences des précédentes contributions. Il dénote tout d’abord par sa méthodologie et son cadre analytique : il est le seul à nous donner accès à une ressource bibliographique relativement conséquente et à nous faire un exposé clair et détaillé de la démarche, du cadre de l’enquête, de la façon dont les données sont récoltées, analysées, etc. De plus, il pose les bases et les délimitations de sa recherche, puisqu’il n’est nullement question de montrer la soi-disant emprise du « salafo-jihadisme » en France, mais simplement de mener une étude auprès des prisonnières condamnées pour des actes de radicalisation et de terrorisme.
C’est justement la critique principale que nous pouvons faire à Bernard Rougier et ses contributeurs. Que des Français musulmans puissent adhérer aux discours « jihadistes » prônant un islam ultra-violent, nous n’en doutons point, et si Rougier et Cie avaient fixé comme objet de recherche ce type de public et leur production idéologique, en précisant que cela est un phénomène plutôt minoritaire et qu’il est difficile d’en mesurer l’influence sur le reste des musulmans, l’ouvrage pourrait presque présenter un intérêt scientifique. Mais ce n’est pas le cas. Les auteurs ont une tout autre prétention, celle de démontrer que l’idéologie « islamiste » est populaire chez les musulmans de France, et qu’elle est même parvenue à conquérir certaines zones géographiques, en imposant sa loi, sans qu’ils ne nous apportent des éléments de preuves réellement sérieuses et tangibles. Enfin, ironie du livre, les profils des prisonnières interrogées que dressent François Castel de Bergerac – des femmes jeunes, ayant connu des ruptures familiales et/ou professionnelles et/ou scolaires, et tombant rapidement dans un islam radical, sans avoir eu de pratique religieuse relativement régulière et marquée avant cela – paraissent corroborer les pistes d’analyses de beaucoup de travaux en sciences humaines sur la question, ceux-là mêmes que Rougier a véhément attaqué en introduction.
En terminant ce livre, nous avons l’étrange impression qu’il a pour fonction de donner du crédit « académique » à toutes les polémiques islamophobes actuelles, en faisant fi de toute la rigueur méthodologique, analytique et éthique qu’exige ce genre d’exercice. Qu’un tel ouvrage ait pu être publié aux Presses Universitaires de France interroge tout autant. Plutôt que de nous montrer l’emprise de plus en plus grandissante de « l’islamisme » sur les « territoires perdus de la République », l’ouvrage nous montre plutôt à quel point l’islamophobie conquiert de plus en plus d’espace, s’imposant même dans le champ académique et universitaire.
Notes
[1] Nous utiliserons durant cet article le terme de « radicalisation », bien que nous ayons conscience que le terme lui-même doit être interrogé, notamment quant au potentiel raciste qu’il contient, mais aussi dans la fonction qu’il peut remplir. Voir Esmili Hamza, « La radicalisation n’existe pas, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne soit rien. Les sciences sociales à l’appui d’une nouvelle raison d’État », Jef Klak, 2019
La radicalisation n’existe pas, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne soit rien
[2] ibid.