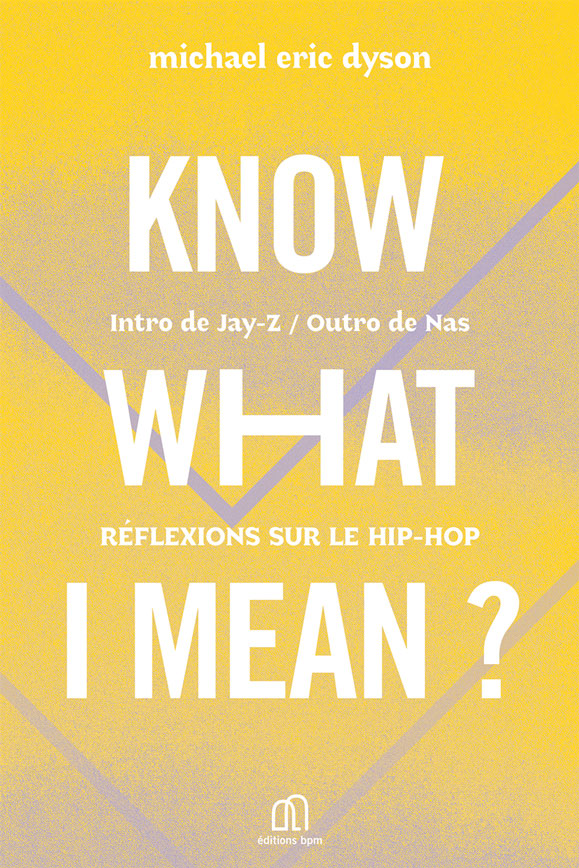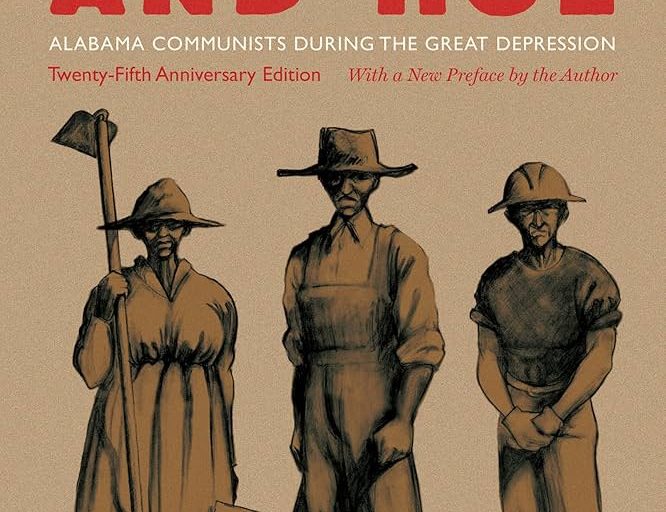A propos de : Michael Eric Dyson, Know What I Mean? Réflexions sur le Hip-Hop, éditions BPM, Paris, 2022.
Les jeunes éditions BPM ont publié, en 2022, la première traduction française d’un classique de la littérature sur le rap américain : Know What I Mean ? Réflexions sur le hip-hop de l’immense Michael Eric Dyson. Initialement publié en 2007, préfacé par Jay-Z et postfacé par Nas, il est certain que cet ouvrage mériterait d’être réactualisé en prenant en compte les évolutions récentes du rap outre-Atlantique. Pour avoir une meilleure idée du paysage rapophonique de 2007, c’est l’année ou sont sortis des albums comme The Offering de Killah Priest (à écouter d’urgence pour ceux qui ne connaissent pas), Graduation de Kanye West ou encore 8 Diagrams du Wu-Tang Clan (pas leur meilleur album, mais ça se laisse écouter). En France sortaient Autopsie. Vol. 2 de Booba et Jusqu’à la mort de la Mafia K’1 Fry. La parution étatsunienne de ce livre remonte donc à une autre époque du hip-hop, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Toutefois, la traduction de cet ouvrage n’est pas sans intérêt, loin de là. Dyson part de la non-légitimité du hip-hop dans la sphère artistique :
« En niant sa complexité musicale et artistique, les critiques anti-hip-hop arrivent à jouer sur deux tableaux : ils peuvent d’une part nier le statut artistique légitime du rap, tout en profitant d’autre part de son omniprésence pour prouver à quel point il a un effet terrible sur la jeunesse. » (p. 21)
Cette non légitimité du hip-hop est bien moins vraie aujourd’hui – sauf pour des caricaturistes à la Zemmour – celui-ci semble, au contraire, s’être davantage institutionnalisé. Cette institutionnalisation pousse par ailleurs les puristes (« Le rap c’était mieux avant ») à fouiller les combles de l’underground afin de dénicher tel ou tel rappeur totalement inconnu et en refusant de reconnaître la pertinence musicale de certains rappeurs « installés ».
En s’appuyant sur des intellectuels étatsuniens de premier plan, Dyson se propose d’étudier le hip-hop sans pour autant le « lisser ». En effet, si des rappeurs comme Lupe Fiasco, aux Etats-Unis, ou Médine en France, par exemple, n’ont aucun mal à être discutés dans les universités (Lupe Fiasco au M.I.T et Médine à l’ENS), ces discussions laissent souvent de côté les rappeurs mainstream ou de ce que Jean Messiah nomme le « rap haineux[1] ». Le risque d’un tel livre était donc que l’intellectualisation du rap laisse de côté les rappeurs qui sont souvent cités par ceux-là même qui veulent délégitimer ce style musical.
L’objet de ce livre n’est, pour l’auteur, pas en premier lieu de s’opposer aux conservateurs blancs pour qui le hip-hop a toujours été une cible. Il tente, bien plutôt, de répondre aux critiques d’une certaine intelligentsia noire étatsunienne qui accuse le hip-hop d’aller à l’encontre du mouvement post-droits civiques, d’une certaine tradition artistique noire qui serait, elle, respectable, etc. En effet, comment rattacher un mouvement artistique qui puise allégrement dans les stéréotypes et le sexisme à la longue tradition de luttes des noirs aux Etats-Unis ?
Pour répondre à cette question, Dyson s’interroge, entre autres, donc sur la notion d’authenticité dans le hip-hop (par exemple à travers le fameux cliché de l’affrontement entre le « hip-hop underground et le hip-hop commercial »), la misogynie dans le rap, les influences de « l’Atlantique noire » sur le rap, la place du pouvoir blanc sur les moyens de production au sein de l’industrie musicale, le rap dit « conscient », etc. … Pour les passionnés de rap – ou de musique en générale – cet ouvrage est donc une vraie mine d’or intellectuelle.
Un point particulièrement pertinent pour le lecteur francophone est le chapitre 3 « It’s Trendy to be the Conscious MC », dans lequel Dyson dialogue avec le réalisateur Thomas Gibson. Dyson écrit ainsi :
« Premièrement, la jeunesse noire est constamment accusée d’être dépolitisée et victime d’apathie sociale. En arrière-plan de ce refrain, c’est l’ensemble des Noirs américains qui sont montrés du doigt comme une population politiquement morne. Mais nous devons nous méfier de la tentation de romancer les années 1960. En effet, même à la grande époque du mouvement des droits civiques et de libération noire, les activistes n’étaient qu’une minorité et tout le monde ne descendait pas dans la rue. Deuxièmement, nous devons admettre que ce n’est pas forcément le hip-hop qui doit être tenu pour responsable du manque de rap politisé, c’est un problème plus profond. C’est l’échec de notre imagination politique et de celle des élites et militants noirs qui prétendent pouvoir déclencher et diriger nos mouvements sociaux. » (p. 88).
Si ce livre a été écrit en 2007, la question de la nécessité d’un rap politisé, ou du moins « conscient », reste assez actuelle – que ce soit dans le rap US ou français. Tout au long de son livre, Michael Eric Dyson n’a de cesse de reconnaître la validité de certaines critiques (sur la superficialité de certains textes, ou leur misogynie), tout en insistant sur le fait que la scène hip-hop ne saurait se réduire à ces clichés de rappeurs. Tout cela soulève une question, le rap non-conscient (voire « inconscient ») n’aurait-il pas une portée esthétique – donc, dans une certaine mesure, politique – plus importante que le rap conscient ? Le fait qu’il soit « injuste d’accuser le hip-hop d’être responsable d’un échec politique avec lequel il n’a rien à voir » (p. 89) est tout à fait exact. Mais pourquoi rejeter le rap ordurier – y compris lorsqu’il véhicule des clichés misogynes – en bloc, sans se pencher sur sa valeur esthétique ? De ce point de vue, Rester barbare, de Louisa Yousfi est une merveille d’analyse du rap français. Lorsqu’elle analyse le cas de Booba, par exemple, elle écrit que celui-ci veut « [r]éussir en barbare, réussir en pirate[2]. » :
« Booba se veut le cauchemar de l’Occident : à la fois la réalisation de ses fantasmes racistes et leur conjuration. Le corps sculpté comme une armure, il sera voyou, dealer, tueur, animal. Il sera une figure du Mal qu’ils ont fait et qui vient régler la note, boucler la boucle[3]. »
Sur PNL, elle écrit :
« PNL, c’est la banlieue qui tourne en vase clos, la banlieue-zoo vécue comme un prolongement de la prison. En son cœur, un écosystème est né, avec ses propres codes, sa propre langue. (…) La banlieue de PNL ne fait pas de rap ‘’conscient’’, n’interpelle aucune institution, ne sensibilise aucune conscience. Elle n’attend plus rien de l‘extérieur, ne veut plus rien avoir à lui dire. Quelque chose s’est brisé, mais il est trop tard pour en parler[4]. »
Si l’univers du rap US est fort différent du rap français à bien des égards, on pourrait tout de même écrire des choses similaires à propos du groupe d’Atlanta, Migos. Si les paroles oscillent entre une apologie de l’argent (surtout du fait de devenir riche avant de devenir célèbre), de femmes dévêtues ou encore de drogues, leur évolution – jusqu’à leur séparation et la mort de Takeoff – marque également une certaine prise de distance d’avec l’extérieur. Cela est particulièrement explicite dans leur mixtape, au titre parlant, Back to the Bando Vol. 2 :
« Fuck the mansion, go back to the bando, we don’t want no company nigga, no company
No more interviews, no more discussions, I’m closing door on these niggas
I don’t even wanna talk to these niggas. » (extrait de Came from Nothing)
La trap et la drill de Chicago ou de Grande-Bretagne ont également apporté un véritable renouveau au hip-hop – y compris en France. Au-delà des insultes d’un Stormzy (surtout connu en France pour un featuring avec Aya Nakamura) envers l’ancien Premier Ministre britannique Boris Johnson, la trap—qui traite surtout de drogues et de deal – et la drill – qui parle surtout de violence et de gang – sont surtout discutées pour leur aspect violent et sale. En 2018, le Guardian qualifiait ainsi la drill de tendance menaçante du hip-hop et le Sunday Times liait directement la drill (qualifiée de musique démoniaque) aux meurtres décimant la jeunesse populaire de Londres et d’autres villes anglaises – insistant également sur le fait qu’Outre-Atlantique, Chicago serait devenue une ville ultra-violente en même temps que la drill faisait son apparition.
Pour revenir à Dyson, celui-ci écrit – en réponse à une question de Gibson – que si la jeunesse disposait d’une connaissance claire des origines du rap, cela pourrait stimuler « sa conscience des usages et des significations politiques du hip-hop » (p. 92). Si le livre de Dyson est brillant à bien des égards, pourquoi faudrait-il que le hip-hop soit « conscient » ? Au contraire, on pourrait arguer que le hip-hop est bien plus parlant et esthétiquement pertinent lorsqu’il ne se fait pas le simple relais d’une prise de position sur telle ou telle sujet. Il est, par ailleurs, essentiel de ne pas réduire le hip-hop aux paroles, mais de prendre en compte son esthétique de manière totale. Car si la drill et la trap, pour reprendre cet exemple précis, font grincer des dents, ce n’est pas qu’à cause des paroles (sinon, pourquoi ne pas condamner tel roman ou tel film mettant en scène une certaine violence – Tarantino est, par exemple, largement célébré par la bourgeoisie blanche malgré la violence de ses films). En effet, la mise en accusation générale du rap provient, notamment du fait que cette « barbarie » est assumée esthétiquement par des noirs ou des arabes, pour la plupart issus de quartiers populaires. Le Wu Tang Clan, par exemple, collectif sans doute le plus remarquable de la scène rap US et faisant assez largement consensus chez les auditeurs de rap des années 1990 et 2000, a marqué une rupture nette au niveau des sons. Si le Wu Tang avait également des paroles assez violentes (parlant de crimes et de drogues – de la fin des années 1990 jusqu’à la mort d’ODB en 2004, le FBI a d’ailleurs assez largement enquêté sur le groupe), c’est pour le son si particulier de ses titres qu’il s’est fait connaître. Dans sa magistrale biographie du groupe – qui est également un livre majeur sur l’histoire sociale du hip-hop US – S.H. Fernando Jr. écrit qu’à une époque où l’industrie musicale corporate contrôlait le rap, poussant les ventes de pop ou de la G-funk lisse pour la consommation de masse, le Wu Tang Clan a ramené le rap à la rue – pas seulement par leurs paroles, mais également par leurs sons[5]. Par ailleurs, il importe de ne pas oublier que certains genres musicaux étaient également largement marginalisés avant de s’institutionnaliser par la suite. Ainsi, si le Jazz semble aujourd’hui être une musique que les blancs écoutent en sirotant un verre de vin dans leurs beaux costumes, l’histoire de ce genre musical n’est pas non plus dénuée d’attaques envers un genre musical considéré comme proche de la pègre et véhiculant une certaine forme de violence. Dans les années 1960, par exemple, le propriétaire de l’un des jazz club les plus réputés de Los Angeles, John McClain était également l’un des plus importants vendeurs de drogues de la ville. Il est également célèbre pour avoir servi de mentor au promoteur Dick Griffey qui fonda également le label Solar Records – qui permis à Suge Knight de mettre un pied dans l’industrie musicale. Si l’on remonte plus loin encore, alors que le jazz commençait à apparaître dans la Nouvelle Orléans de la fin du XIXe siècle – via des influences mexicains, cubaines et africaines – cette musique se développera concomitamment avec l’éclosion de bordels, fréquentés par les plus basses couches sociales[6]. Mais ce qui dérangera également les observateurs sera la rupture entre le jazz et la musique établie (certains jazzmen assumaient d’ailleurs le fait de ne pas savoir lire la musique).
En bref, si la violence se manifeste à travers les paroles (ce qui est parfaitement analysé et discuté par Dyson), l’histoire sociale et les rythmes mêmes du rap expliquent également les attaques qui s’acharnent contre cette musique. L’importance qu’accorde Dyson au rap conscient (sans jamais caricaturer le rap dans son ensemble) s’explique sans aucun doute par son ancrage générationnel ainsi que le contexte d’écriture du livre. Son livre, traduit pour la première fois en français par les éditions BPM, dont nous n’avons évoqué qu’une infime partie, est un ouvrage important pour les militants, les artistes et les mélomanes. Aujourd’hui, toutefois, les musiciens et artistes auraient tout intérêt à se pencher sérieusement – et sans a priori – sur le rap ordurier – dont la drill et la trap sont d’excellents exemples. Au lieu de chercher à donner des lettres de noblesse au rap, autant assumer son caractère « sale » et violent, qui n’obéit pas à l’idéal politique des militants de gauche – y compris lorsque cette musique est récupérée par l’industrie musicale.
Sélim Nadi
[1] https://www.valeursactuelles.com/societe/pour-sauver-la-jeunesse-vidons-la-fosse-septique-du-rap-haineux-anti-francais
[2] Louisa Yousfi, Rester barbare, éditions La Fabrique, Paris, 2022, p. 72.
[3] Ibid., p. 75.
[4] Ibid., p. 92.
[5] S.H. Fernando Jr., From The Streets to Shaolin. The Wu-Tang Saga, Hachette books, New-York, 2021, p. 8.
[6] Sur l’histoire du jazz, il importe de lire le magnifique livre de Gerald Horne, Jazz and Justice. Racism and the Political Economy of the Music, Monthly Review Press, New-York, 2019.