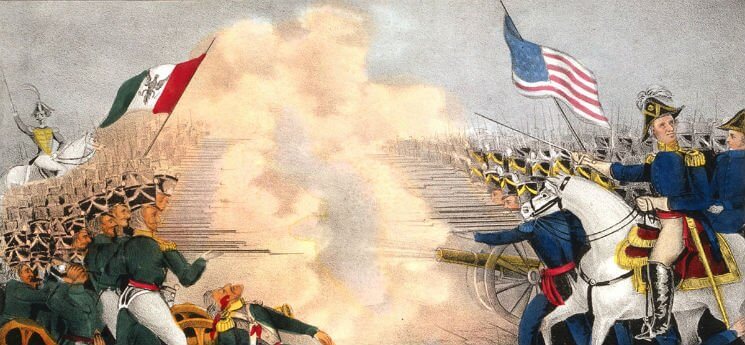Le droit administratif est autant ignoré qu’il est essentiel. Les espaces militants n’échappent pas à cette méconnaissance, alors-même qu’ils ont conscience de l’importance que revêt le droit, et en particulier le droit pénal, puisque ce dernier est particulièrement mobilisé par l’appareil d’État pour poursuivre et punir la contestation sociale. Les militants ont alors appris à mieux connaître le droit pénal pour se défendre face à « l’autorité judiciaire ».
Pourtant, le droit administratif devrait faire l’objet du même intérêt en ce qu’il a trait au premier des pouvoirs d’État, le « pouvoir exécutif ». La connaissance du droit applicable à l’action administrative est par ailleurs d’autant plus impérieuse que son champ ne cesse de s’étendre, notamment en ce qui concerne les nouvelles attributions confiées aux préfets dans la prévention de la commission d’actes de terrorisme et dont le contrôle de légalité est dévolu aux tribunaux administratifs[1].
Cette chronique a vocation à mieux faire connaître le droit administratif, voire le droit public dans son ensemble, pour faciliter son usage. Ce premier billet intervient pour interroger les fondements historiques du droit administratif contemporain.
*
Le droit administratif est défini, dans son acception la plus large, comme « l’ensemble des règles définissant les droits et obligations de l’Administration, c’est-à-dire du gouvernement et de l’appareil administratif »[2]. L’action gouvernementale est en effet encadrée par des règles particulières, différentes de celles qui régissent les rapports entre particuliers, dans la mesure où elle soulève des problématiques ayant trait aux rapports entre l’État et le citoyen, l’autorité et la liberté, la société et l’individu[3].
L’Administration intervenant dans de multiples champs (l’économie, les relations internationales, etc.), le droit administratif l’a accompagnée pour la soutenir et lui assigner des limites. L’on retrouve donc un « droit public économique », un « droit international public » et, notamment, lorsque l’administration coloniale existait encore, ce qu’on a appelé le « droit (public) colonial ».
Le droit public colonial constituait l’ensemble des règles définissant les droits et obligations de l’Administration coloniale. Il est donc né en même temps que les institutions coloniales, et a officiellement pris fin à l’issue du processus de décolonisation, les territoires anciennement colonisés ayant soit obtenu leur indépendance, soit intégré le régime politique et juridique français.
Le droit colonial ne serait dès lors plus qu’un vestige du passé. Pourtant, l’étude du droit administratif contemporain démontre, au contraire, l’omniprésence encore aujourd’hui de la colonialité, tout particulièrement dans son fondement.
Pour retrouver les bases du droit administratif, il suffit de se référer à ce qui constitue la référence incontestée en la matière : Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA). Créé à l’initiative de membres du Conseil d’État et d’universitaires, cet ouvrage est présenté comme recensant les décisions de justice qui « constituent l’ossature »[4] du droit administratif.
La prégnance de la colonialité dans cet ouvrage, et a fortiori dans le droit administratif, est alors perceptible à deux niveaux : dans sa composition et dans le discours qu’il porte.
La composition des grands arrêts : une fondation partielle du droit administratif sur le fait colonial
La composition du GAJA révèle que l’ossature du droit administratif est composée en partie par des solutions directement issues du conflit colonial, et qui continuent paradoxalement d’exister aujourd’hui.
Sur les 118 arrêts que comporte l’ouvrage, 4 proviennent directement du fait colonial. Si bien plus d’arrêts ont été rendus dans un contexte colonial (par exemple l’arrêt Tomaso Grecco[5], rendu à propos d’un coup de feu tiré par un gendarme pour immobiliser un taureau échappé à Souk-el-Arbas en Tunisie, ou encore l’arrêt Société commerciale de l’Ouest africain[6], rendu au sujet de l’exploitation de lagunes par la colonie de Côté d’Ivoire), ce contexte peut être considéré comme accidentel, comme un décor, les faits de l’espèce ayant tout aussi bien pu avoir lieu sur le territoire métropolitain. En revanche, les quatre arrêts ci-après présentés l’ont été au sujet d’un conflit colonial, de sorte que les solutions dégagées par le juge n’auraient pas pu l’être dans d’autres espèces. Le fait colonial est alors indissociable de l’arrêt rendu.
Le premier est l’arrêt Couitéas[7], rendu le 30 novembre 1923.
Dans cette affaire, le sieur Couitéas était devenu l’héritier de plusieurs dizaines de milliers d’hectares de terres en Tunisie, sur lesquelles étaient établis plus de 800 indigènes qui s’en considéraient de temps immémorial comme les légitimes occupants. Le sieur Couitéas s’étant vu reconnaître la qualité de propriétaire légal des parcelles en question, le tribunal civil de Sousse avait ordonné l’expulsion des tribus occupantes.
Les indigènes avaient cependant fait savoir qu’ils ne se laisseraient pas faire, plus de 300 d’entre eux ayant notamment accueilli une première visite de l’huissier de justice avec une pluie de pierres. Le sieur Couitéas avait donc sollicité des autorités le concours de la force publique pour déloger les occupants. Le Gouvernement avait cependant refusé d’envoyer ses hommes par crainte des très sérieuses résistances qu’auraient pu rencontrer les soldats.
Le sieur Couitéas avait alors contesté ce refus en justice. Le Conseil d’État décida alors que le Gouvernement n’avait pas commis d’illégalité en refusant de prêter le concours de la force publique dès lors que « des troubles graves » auraient pu naître à cette occasion, mais qu’en contrepartie le sieur Couitéas aurait droit au bénéfice d’une indemnité pour réparer le préjudice subi et tenant à une privation partielle de son droit de propriété.
Depuis, la jurisprudence Couitéas sert toujours de référence au principe dit d’« égalité devant les charges publiques », qui permet d’engager la responsabilité de l’État sans faute du fait des décisions administratives régulières qu’il prend.
Le deuxième est l’arrêt Frampar[8], en date du 24 juin 1960.
En l’espèce, le préfet d’Alger avait ordonné la saisie du numéro de France-Soir daté des 30-31 décembre 1956 et des numéros des 6 et 7 janvier du Monde, de France-Soir et de Paris-Presse, qu’il estimait susceptibles de provoquer des troubles à l’ordre public.
Pour se faire, le préfet s’était alors fondé sur l’article 10 du code d’instruction criminelle, alors que ce dernier n’était applicable qu’aux actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et délits contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l’État et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Le Conseil d’État jugea que le préfet d’Alger avait commis une illégalité en recourant à une procédure qui ne pouvait servir à la saisie de journaux.
Cet arrêt Frampar reste encore célèbre en matière de distinction entre mesures de police administrative et mesures de police judiciaire.
Les troisième et quatrième sont l’arrêt Rubin de Servens[9] du 2 mars 1962 et l’arrêt Canal du 19 octobre 1962[10]. Les deux affaires partagent des ressemblances qui justifient qu’elles soient analysées ensemble.
Par deux décisions, en date du 3 mai 1961 et du 1er juin 1962, le Président de la République Charles de Gaulle avait institué un Tribunal militaire et une Cour militaire de justice. Le premier avait notamment vocation à réprimer les participants au putsch d’Alger d’avril 1961, et le second à condamner des membres de l’Organisation de l’armée secrète (OAS). La Cour militaire de justice avait à ce titre condamné le sieur Canal, trésorier de l’OAS et chef de sa branche métropolitaine (« l’OAS Métro »), à la peine de mort.
Plusieurs mis en cause devant ces juridictions d’exception avaient saisi le Conseil d’État pour lui demander d’annuler les décisions du Président de la République qui les instituaient. Il ne fit cependant que partiellement droit à ces demandes, refusant d’apprécier la légalité de la création du Tribunal militaire mais acceptant d’annuler l’acte portant création de la Cour militaire de justice.
Ces jurisprudences Rubin de Servens et Canal demeurent incontournables en matière de législation d’exception.
Si le GAJA présente l’ossature du droit administratif, force est donc de constater que certaines vertèbres demeurent fondamentalement rattachées au fait colonial.
Reste que la seule présence de quatre arrêts dans les fondations du droit administratif ne saurait suffire à considérer ces dernières comme étant, dans leur ensemble, de nature coloniale. Cette caractéristique peut toutefois être mise en exergue au regard du discours porté par le GAJA.
Le discours des grands arrêts : une consolidation du droit administratif en période coloniale
Quand est né le droit administratif ? À en croire les auteurs du GAJA, en 1873.
C’est par une décision Blanco[11] rendue le 8 février 1873 par le Tribunal des conflits que débute la présentation, chronologique, des grands arrêts. Il est communément admis qu’un véritable mythe entoure cet arrêt, par lequel le Tribunal des conflits jugea notamment que la responsabilité extracontractuelle de l’État échappe au champ d’application du Code civil et est soumise à des règles adaptées au service public.
C’est sous la plume de Marcel Waline, au sortir de la 2nd Guerre mondiale, en 1946, que l’arrêt Blanco sera considéré comme « la pierre angulaire de tout le droit administratif »[12]. Cette approche fera école tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, en étant reprise par exemple par René Chapus[13] ou le doyen Vedel[14].
Le droit administratif serait né en 1873, par un arrêt fondateur. Pourtant, cet arrêt n’a nullement été accueilli comme tel par les juristes de l’époque, qui le considéraient comme un arrêt parmi d’autres, de simple technique juridique (devant quel juge doit être portée une action en responsabilité contre l’État ?). Edouard Laferrière[15] lui-même rappelait que la solution de l’arrêt Blanco était déjà celle donnée par le Conseil d’État sous le Second Empire[16].
L’histoire de l’arrêt Blanco s’est ainsi forgée « par un rejet et/ou un oubli de l’histoire antérieure à 1873 »[17]. Dont acte. Le discours selon lequel le droit administratif est né le 8 février 1873, ou à tout le moins a été consolidé à cette date, doit être pris en compte en ce qu’il porte un récit performatif.
C’est ainsi que, prenant naissance officiellement en 1873, le droit administratif devient ipso facto républicain, ce qui n’allait pas de soi. Son producteur, le Conseil d’État, est en effet une institution qui prend naissance sous le Consulat napoléonien et qui surtout gagne son prestige sous le Second Empire[18]. Cette histoire a d’ailleurs mis sa viabilité en danger lors de l’avènement de la IIIe République, les républicains Léon Gambetta et Jules Simon ayant proposé de supprimer le Conseil d’État[19]. S’il devient fidèle à la IIIe République, le Conseil d’État se compromettra ensuite avec le régime de Vichy. Au sortir de la 2nd Guerre mondiale, l’enjeu pour l’institution est alors de renouer avec le rétablissement de la légalité républicaine. Le choix pour les auteurs du GAJA, en 1956, de s’approprier la thèse de la naissance du droit administratif en 1873 sert ainsi, par la normativité de ce discours, à réinscrire la jurisprudence administrative dans le cadre républicain.
Or, la IIIe République n’est pas que le régime de la stabilisation républicaine. C’est aussi le régime du renouveau de l’impérialisme colonial, notamment sous la figure de Jules Ferry. C’est le passage de la Tunisie et du Tonkin sous le statut de protectorat français, la participation à la Conférence de Berlin destinée à encadrer la division et le partage de l’Afrique, l’expansion en Afrique noire à partir du Sénégal et du Congo, ou encore les expéditions de Madagascar.
C’est plus fondamentalement le régime où se développe l’idéologie coloniale, et en particulier la mission civilisatrice de la France, la colonisation n’étant alors plus vue comme une simple manne mercantille et de prestige militaire. C’est ce dont manifeste la création, en 1892, du parti colonial et de l’École coloniale.
En parallèle, la période 1870-1914 est considérée comme un « âge d’or »[20] du droit administratif. Celui où « Le Conseil d’État construit ses fondations »[21]. Sont posés les contours du droit administratif par rapport au droit privé, les bases du régime de légalité des actes administratifs en matière économique ou de police, ainsi que les outils de contrôle de l’action administrative par le juge.
En définitive, au-delà même de quelques décisions issues du fait colonial qui se retrouvent dans l’ossature du droit administratif, celle-ci fait en réalité corps, dans ses fondations, avec la République coloniale. Ces considérations ouvrent ainsi des champs nouveaux d’approche du droit administratif, permettant de déceler peut-être, dans certains arrêts récents, un écho avec l’histoire coloniale.
Notes
[1] Code de la sécurité intérieure, articles L. 228-1 à L. 228-7.
[2] P. Weil, D. Pouyaud, Le droit administratif, Que sais-je ?, PUF, 25e éd., septembre 2017.
[3] Ibid.
[4] M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 22e éd., août 2019.
[5] Conseil d’État, du 10 février 1905, Tomaso Grecco, n° 10365, publié au recueil Lebon.
[6] Tribunal des conflits, du 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain, n° 00706, publié au recueil Lebon.
[7] Conseil d’État, du 30 novembre 1923, Couitéas, n° 38284 48688, publié au recueil Lebon.
[8] Conseil d’État, Assemblée, du 24 juin 1960, Société Frampar et société France éditions et publications, n° 42289, publié au recueil Lebon.
[9] Conseil d’État, Assemblée, du 2 mars 1962, Rubin de Servens et autres, n° 55049 55055, publié au recueil Lebon.
[10] Conseil d’État, Assemblée, du 19 octobre 1962, Canal, Robin et Godot, n° 58502, publié au recueil Lebon.
[11] Tribunal des conflits, du 8 février 1873, Blanco, n° 00012, publié au recueil Lebon.
[12] M. Waline, Manuel élémentaire de droit administratif, 4e éd., Sirey, Paris, 1946, p. VII.
[13] R. Chapus, Droit administratif général, 14e éd., Montchrestion, Paris, 2000, tome 1, p. 1-2.
[14] G. Vedele et P. Delvolvé, Droit administratif, 13e éd., PUF, « Thémis », Paris, 1997, tome 1, p. 66.
[15] Vice-président du Conseil d’État entre 1886 et 1898, il est considéré comme l’un des pères fondateurs du droit administratif contemporain.
[16] E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Berger-Levrault, Paris, 1887-1888, tome II, p. 173-174 ; v. par ex. CE, 6 décembre 1855, Rotschild c. Larcher et administration des postes, n° 26953, publié au recueil Lebon.
[17] G. Bigot, note sous Tribunal des conflits, 8 février 1873, n° 00012, Blanco, in Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative, LGDJ, 2019, p. 42.
[18] Les origines du Conseil d’État.
[19] L. Fougère, Le Conseil d’État, son histoire à travers les documents d’époque (1799-1974), Éditions du CNRS, 1974.
[20] B. Stirn, Le service public dans la jurisprudence du Conseil d’État français, colloque d’Athènes « Service(s) public(s) en Méditerranée », 19 et 20 octobre 2017.
[21] Ibid.