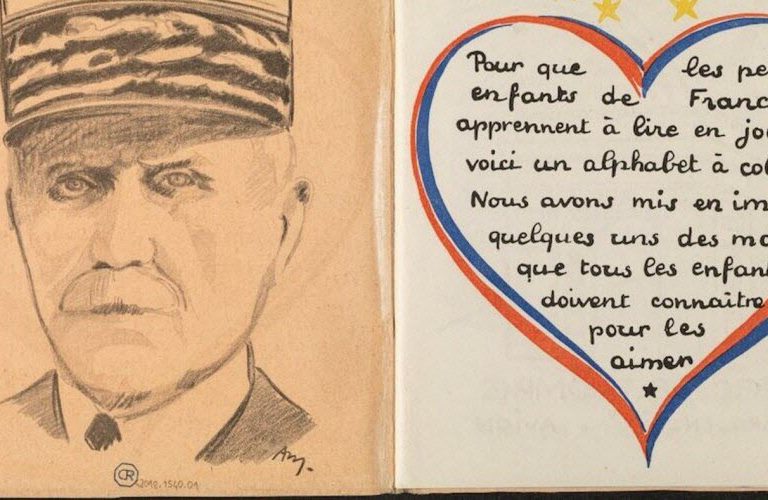Alors qu’un jeune homme de quinze ans vient d’être abattu froidement à Bondy et que deux collégiens ont été tués durant des affrontements « entre bandes rivales » dans l’Essonne, le paysage politique se divise principalement entre ceux (plutôt de droite) qui appellent à un durcissement sécuritaire et ceux (plutôt de gauche) qui, lorsqu’ils ne se rangent pas derrière la droite, se terrent dans un silence embarrassé ou ne prennent la parole que pour expliquer que la répression n’est pas la solution à la délinquance et à la violence des jeunes. Car comment continuer à considérer ces jeunes comme de potentiels sujets politiques s’ils s’entre-tuent ? Il ne s’agit pas ici de vols à l’étalage dont le but premier est la survie – ce qui pourrait être excusé par cette gauche qui éprouve de l’empathie pour cette forme de délinquance. Dans le cas présent, il s’agit de toute autre chose. Une violence inouïe, ayant coûté la mort à des enfants. Christine Garnier, la maire DVD de Quincy-sous-Sénart, pointe du doigt la banalisation de la violence via les réseaux sociaux et les clips de rap. La mise en cause de la « culture » de ces jeunes n’est pas vraiment une nouveauté. On se souvient qu’outre-Atlantique, au moment de la tuerie dans le lycée de Columbine (1999), le chanteur Marylin Manson avait été accusé d’avoir inspiré les tueurs tout comme certains jeux vidéo. On pourrait même remonter plus loin et se souvenir de la méfiance suscitée par le jazz – de nombreux jazzmen avaient en effet débuté leur carrière dans des bordels, à l’époque de la prohibition, et entretenaient des liens avec la pègre. En bref, on l’aura compris, la recherche d’explications à cette violence juvénile se limite souvent à la dénonciation de l’environnement culturel de ces jeunes. Or, le fait que cette violence (qui n’est pas un phénomène nouveau) apparaisse sur le devant de la scène publique est un point qui mérite toute notre attention. Nous pourrions nous contenter de souligner le racisme inhérent aux diverses réactions – et que l’on ne peut que difficilement nier – ou encore le fait que ces jeunes viennent des quartiers populaires et qu’ils sont donc traités en conséquence, mais cela ne suffirait pas à trouver des pistes de compréhension aux réactions qu’ont suscités ces affrontements, la question principale étant : pourquoi fait-on le choix de leur sur-médiatisation quand rien ne vient étayer leur progression ?
En 1978, un groupe de chercheurs, autour de Stuart Hall, posait la question de l’explosion du phénomène de mugging (terme qui n’a pas vraiment d’équivalent français, mais que l’on pourrait traduire par « agression ») en Grande-Bretagne. Or, plutôt que de se demander pourquoi ce phénomène existe, ce groupe de chercheurs a préféré se poser la question suivante : pourquoi la société britannique réagit-elle au mugging précisément dans telle ou telle conjoncture historique, alors que ce n’est pas un phénomène nouveau ? Pourquoi une sorte de panique morale s’empare-t-elle des médias et des politiques sur cette question – mais également d’une bonne partie de la société ? Sans entrer dans le détail de leurs recherches, les auteurs montrent que cette panique morale s’ancre dans une panique générale dans le rapport aux « crimes » depuis les années 1960 – une panique dont l’objet réel n’est, en réalité, pas le crime en lui-même. Les Britanniques percevaient en fait ces crimes comme un signe de la désintégration de la vie sociale, de la déchéance du mode de vie britannique. En d’autres termes, c’est le signe d’une société en crise. Finalement le terme de mugging condense en lui-même les concepts de « crime », de « jeunesse » et de « race » qui servent à organiser les réactions face à cette crise – que les auteurs présentent comme une crise d’hégémonie. C’est, selon les auteurs, cette accumulation de contradictions, cette profonde rupture dans la vie politique et économique, qui explique en partie ces réactions et le fait que ce problème passe d’un simple fait-divers à un enjeu social.
Il est évident que la Grande-Bretagne des années 1970 n’est pas la France de 2021, pourtant force est de constater que la menace des « jeunes » apparaît le plus souvent dans des périodes de crise – au moins potentielles. Dans sa célèbre étude sur les blousons noirs, publiée en 1962, Émile Copfermann insistait, par exemple, sur l’importance du contexte colonial pour expliquer la psychose collective qui s’était emparée de la société française face aux phénomènes de bandes. Il insistait avant tout sur les problèmes psychiques engendrés par ce contexte.
Il ne s’agit pas ici de nier l’existence de cette violence – et plus largement de la délinquance juvénile qui est vraiment inquiétante – mais de se demander : de quoi les réactions à ce phénomène sont-elles le nom ? Les jeunes, tout comme la violence, ont toujours été là. La plupart des chercheurs s’accordent sur son caractère cyclique. Or, la panique morale accompagnant celle-ci n’occupe pas nécessairement le devant de la scène à chaque fois. Cette panique est donc bien plus pertinente à prendre en compte pour ce qu’elle dit d’elle même que les affrontements en tant que tels.
Alors qu’actuellement, les articles se succèdent pour affirmer que ce phénomène des affrontements entre bandes de jeunes serait en expansion – ce qui reste à prouver – il peut être utile ici de revenir à une étude menée en 2009 (il y a plus de dix ans donc) par Marwan Mohammed qui, en guise d’exemples, citait nombre de cas d’affrontements dans la région parisienne durant la première décennie des années 2000 – tout en expliquant qu’« à partir de 1991, la Direction Centrale des Renseignements Généraux (DCRG) s’est engagée dans la surveillance et la quantification annuelle des affrontements. Elle s’est de fait imposée comme la seule source, qu’élus et journalistes reprennent généralement sans grande distance[1]. » Il n’est donc pas aisé d’évaluer si, oui ou non, ce phénomène est en augmentation. Ce qu’il importe d’appuyer, c’est que la mise en avant de ce phénomène revient par vagues, dans des conjonctures précises : les moments où l’État est en crise et où il doit justifier son autoritarisme et son contrôle sur la population.
Notes
[1] Marwan Mohammed, « Les affrontements entre bandes : virilité, honneur et réputation », Déviance et Société, 2009/2 (vol. 33), p. 173-204.