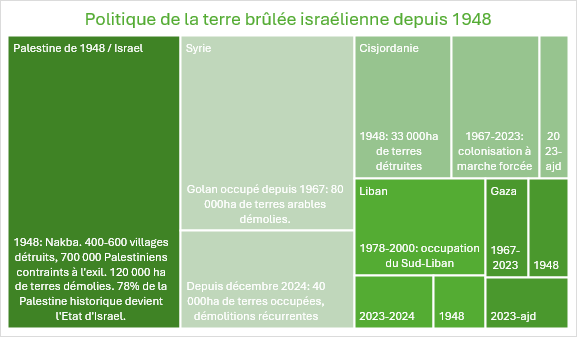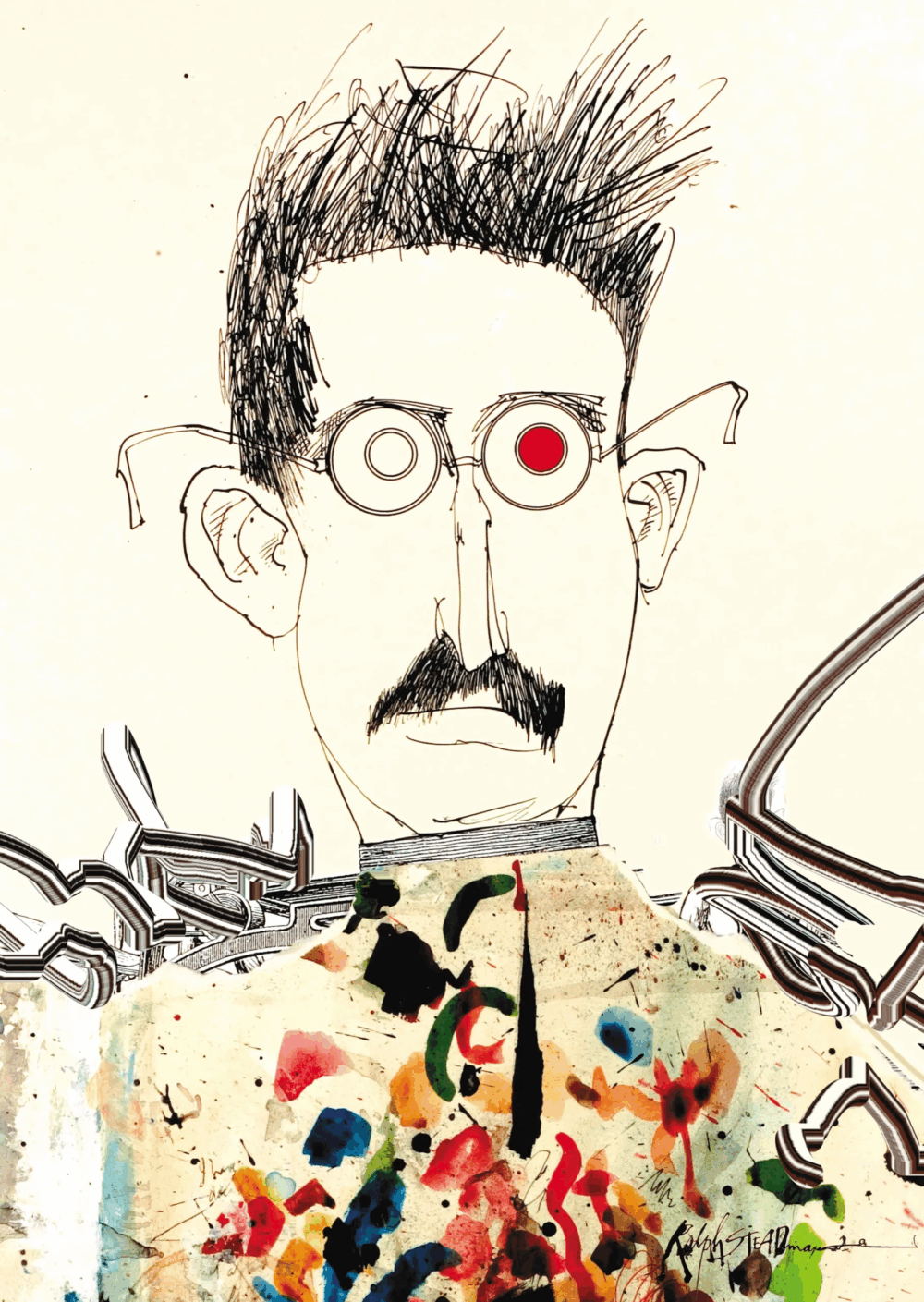Une victoire improbable dans le ventre de la bête
Inconnu il y a encore un an, Zohran Mamdani vient de réussir ce qu’aucun observateur n’aurait jugé possible : conquérir la mairie de New York, ville-monde par excellence et bastion historique du capitalisme américain. Dans un système politique où seules les candidatures « bankables » — adoubées par les donateurs milliardaires et les lobbies — ont droit de cité, la percée de Mamdani relève du séisme.
Son secret ? Une campagne bâtie par le bas, financée exclusivement par de petits dons individuels — un record historique, autant en nombre de contributeurs qu’en montant total levé — et portée par une mobilisation populaire sans précédent. Quartiers après quartiers, une armée de volontaires a sillonné la ville, frappant à chaque porte, discutant, convainquant. À la clé : une victoire écrasante, avec près de 50 % des suffrages, malgré une campagne de dénigrement orchestrée par les grands médias, les puissances de l’argent, ses adversaires démocrates et républicains, et jusqu’à Donald Trump lui-même, multipliant les attaques et les menaces contre lui et les New-Yorkais.
Le retour du peuple sur la scène politique
Mamdani comble un vide béant. Les classes laborieuses, moyennes et populaires — blanches et racisées, indigènes et immigrées — se sont depuis longtemps détournées d’un système politique vidé de sens. Dégoûtées par l’élite démocrate et ses guerres impérialistes, par les compromissions du parti avec la bourgeoisie capitaliste, et par son silence complice dans le génocide palestinien, elles s’étaient massivement abstenues lors de la présidentielle de 2024.
Mais cette victoire prouve qu’elles n’attendaient qu’une raison d’y croire à nouveau, à condition qu’on leur propose autre chose qu’un énième visage du statu quo.
Rompre avec le « tokenisme »
Et cette alternative, Mamdani l’incarne. Musulman, appartenant à la “socialiste” du parti démocrate, critique du capitalisme, assumant ouvertement son statut d’immigré récemment naturalisé américain, il a refusé de jouer le rôle de « token », ce personnage racisé que le pouvoir exhibe pour se donner bonne conscience. Il rompt ainsi avec la lignée d’élites noires et racisées cooptées par le système pour servir le capital et l’Empire, chez les Républicains comme chez les Démocrates — de Condoleezza Rice à Barack Obama, en passant par Colin Powell et la dernière en date, Kamala Harris, battue à plate couture par Donald Trump à la présidentielle de 2024.
Mamdani, lui, s’assume sans complexe et ne trahit pas les siens. Il revendique son statut d’immigré indigène naturalisé, qu’il partage avec des millions d’autres habitants de New York, et assume la confrontation avec un pouvoir fédéral raciste à l’heure où la traque des “sans papiers” dans les rues du pays atteint des niveaux de violence inouïs. A n’en pas douter, Mamdani incarne une nouvelle figure politique : celle du sujet post-colonial qui ne demande plus la permission d’exister.
Une rupture programmatique dans le cœur du capitalisme
Son projet politique tranche radicalement avec le consensus néolibéral. Dans un pays où le mot « collectif » est presque suspect, ses propositions — crèches municipales gratuites, surtaxation des riches, transports publics gratuits — relèvent d’un véritable crime de lèse-majesté.
Dans le New York de Wall Street, au cœur du système financier mondial, cette plateforme collectiviste a fait l’effet d’une gifle. Ses adversaires, le démocrate Andrew Cuomo (battu à la primaire mais quand même candidat : une leçon instructive pour les fétichistes français de ce sinistre dispositif) et le républicain Curtis Sliwa, ont incarné la résistance acharnée des élites à toute remise en cause de leurs privilèges.
Le tournant palestinien
Mais c’est sur le terrain de la Palestine que Mamdani a véritablement fait exploser le cadre. En plein génocide gazaoui, alors que chaque candidat se voyait sommé de prêter allégeance à Israël, Mamdani a refusé de plier. Lors d’un débat télévisé sur NBC, le 6 juin 2025, à la question du premier déplacement international qu’il effectuerait, il a répondu sobrement :
« Je ne quitterai pas New York. Ma priorité, c’est de répondre aux besoins des New-Yorkais. »
Ce refus de courber l’échine a marqué un point de non-retour. Mamdani a ensuite assumé pleinement ses positions anti-impérialistes, allant jusqu’à promettre d’arrêter Netanyahou s’il devait poser le pied sur le sol new-yorkais.
S’en est suivie une vague de haine raciste et islamophobe : accusations d’antisémitisme, injonctions à condamner le Hamas, insinuations incessantes de complicité avec le djihadisme mondial. Mais il a tenu bon — avec calme, dignité, et humour.
L’amour révolutionnaire comme programme
Dans un contexte mondial saturé de haine raciale, islamophobe et coloniale, le simple fait pour Mamdani d’aimer ce qu’il est, d’aimer ses parents étrangers, de parler l’arabe, de soutenir la Palestine, relève déjà d’un acte révolutionnaire.
Son sourire et sa joie contagieuse rappellent que le véritable moteur de toute révolution, c’est l’amour : l’amour des peuples, l’amour des opprimés, l’amour de la vie.
Leçon d’histoire
New York, ville traumatisée par le 11 septembre, épicentre et point de départ de la « guerre des civilisations » ayant amené à la destruction de larges pans du monde arabo-musulman, élit aujourd’hui un maire incarnant le tant décrié islamo-gauchisme. Ce camouflet infligé à l’internationale fasciste est un événement historique dont on ne peut que se réjouir.
Reste à savoir si Mamdani sera à la hauteur de ses ambitieuses promesses et saura résister aux tentatives d’appropriation déjà à l’œuvre du côté de Sanders ou d’Ocasio-Cortez, figures “socialistes” largement disqualifiées par leur complaisance avec le sionisme et, dans le cas de d’AOC, par sa mue en professionnelle de la politique, tristement centriste. Mamdani reste membre du Parti Démocrate, une redoutable machine de guerre impérialiste dirigée par les pires néoconservateurs (Chuck Schumer, Anthony Blinken, Jake Sullivan, Lloyd Austin, tous proches d’Israël et partisans de l’interventionnisme “humanitaire”) qui ne tolèrent la “rupture” qu’à condition qu’elle reste décorative.
L’habitude des déceptions et des défaites impose la distance critique et la circonspection. Certaines des figures qui gravitent autour de Mamdani, représentantes typiques de cette bourgeoisie libérale spécialisée dans la transformation de tout potentiel subversif en bouillie radical chic inoffensive, ne peuvent qu’inspirer la méfiance. En témoigne par exemple le soutien qui lui a été apporté par le “philanthrope progressiste” Alexander Soros, celui-là même qui avait soutenu activement la sinistre Hillary Clinton il y a moins d’une décennie dans la course à la Maison Blanche.
Et la suspicion est d’autant plus justifiée que certaines inflexions dans le discours de Mamdani, en particulier sur la question policière, ne manquent pas d’inquiéter ses soutiens de la première heure. En 2020, à la suite de meurtre de George Floyd par la police dans le Minnesota, il s’était distingué par un discours très radical, aligné sur celui du mouvement “Defund the police” revendiquant de redéfinir en profondeur la manière dont la sécurité publique est conçue aux Etats-Unis. Il avait aussi mis le doigt sur un sujet sensible, à savoir l’étroite collaboration entre la police new-yorkaise et l’armée israélienne, documentée mais peu connue, avec cette phrase choc : « Lorsque la botte de la police de New York vous serre le cou, c’est sous l’influence de l’armée israélienne ».
Aujourd’hui, il exprime publiquement son souhait de ne pas se séparer de Jessica Tisch, actuelle commissaire de la New York City Police Department, tenante d’une ligne sécuritaire dure alors même qu’elle est l’architecte d’un des dispositifs de surveillance municipaux les plus étendus et technologiquement intégrés au monde, le Domain Awareness System.
Par ailleurs, au-delà de la nécessaire prudence à l’endroit de Mamdani, le fait est que le rapport de force dans lequel vont l’attirer la Maison Blanche et l’Etat de New York va être déséquilibré et le forcer à des compromis. Donald Trump a déjà annoncé vouloir couper les financement fédéraux à Mamdani, tandis que l’État de New York, incarné par la gouverneure Kathy Hochul, s’oppose à son plan de surtaxation des foyer les plus aisés et a les moyens institutionnels de le faire tomber à l’eau.
Toutefois, en dépit de toutes ces salutaires précautions, une chose est sûre : l’élection de Mamdani marque le retour du possible. Elle prouve que même au cœur de l’Empire, l’étincelle du communisme décolonial peut encore jaillir.
Et peut-être faut-il y voir plus qu’un symbole américain. Car cette flamme est née depuis les marges, depuis les populations indigènes, immigrées, qui redéfinissent l’universel à partir de leur propre expérience d’oppression et de résistance. C’est probablement de ces territoires de lutte — de ces périphéries décoloniales — que surgira demain la proposition politique radicale et enthousiasmante capable de réconcilier les classes populaires avec la politique.
Enseignements hexagonaux
En France, les leçons à tirer de l’élection de Mamdani ne manquent pas. La principale est sans doute la suivante : le salut politique du camp “progressiste”, et la conjuration de la barbarie qui vient, viendront aussi des franges indigènes de la population — en mesure d’insuffler une dynamique authentiquement révolutionnaire dans le camp populaire, pour une raison très simple : il en va de leur survie et de celle des leurs, ici et dans le Sud global.
Et pendant que des figures du PS et des Verts — Tondelier, Faure, macronistes qui s’ignorent — saluent avec componction la victoire de Mamdani, elles oublient qu’elles démoliraient sans hésiter un candidat de son acabit s’il avait l’outrecuidance de se présenter à la mairie d’une grande ville française. Imaginons une seule seconde leur réaction si un candidat musulman à la mairie de Paris assumait vouloir arrêter Netanyahou* en cas de visite officielle… Le réflexe d’exclusion, de suspicion et de diabolisation serait immédiat, révélant à quel point cette gauche-là est restée prisonnière de l’ordre impérial qu’elle prétend combattre.
Que ce soit directement à travers des figures issues de ces mondes, comme Mamdani, ou en transformant en profondeur des organisations blanches de rupture, comme la France Insoumise, les populations indigènes ont assurément un rôle à jouer dans le renouveau des ambitions transformatrices du camp émancipateur. L’association entre cette proposition politique et un mouvement social français particulièrement combatif — des Gilets jaunes au mouvement contre la réforme des retraites — est la seule capable de faire naître une dynamique qui érigerait le camp populaire en bloc hégémonique, et donc de changer le cours de l’Histoire.
*Cette promesse est sujette à caution, dans la mesure où les Etats-Unis ne sont pas membres de la Cour Pénale Internationale et l’arrestation d’un chef de gouvernement étranger relèverait de toute façon des prérogatives de l’Etat fédéral.
Yazid Arifi (membre de Parole d’honneur)