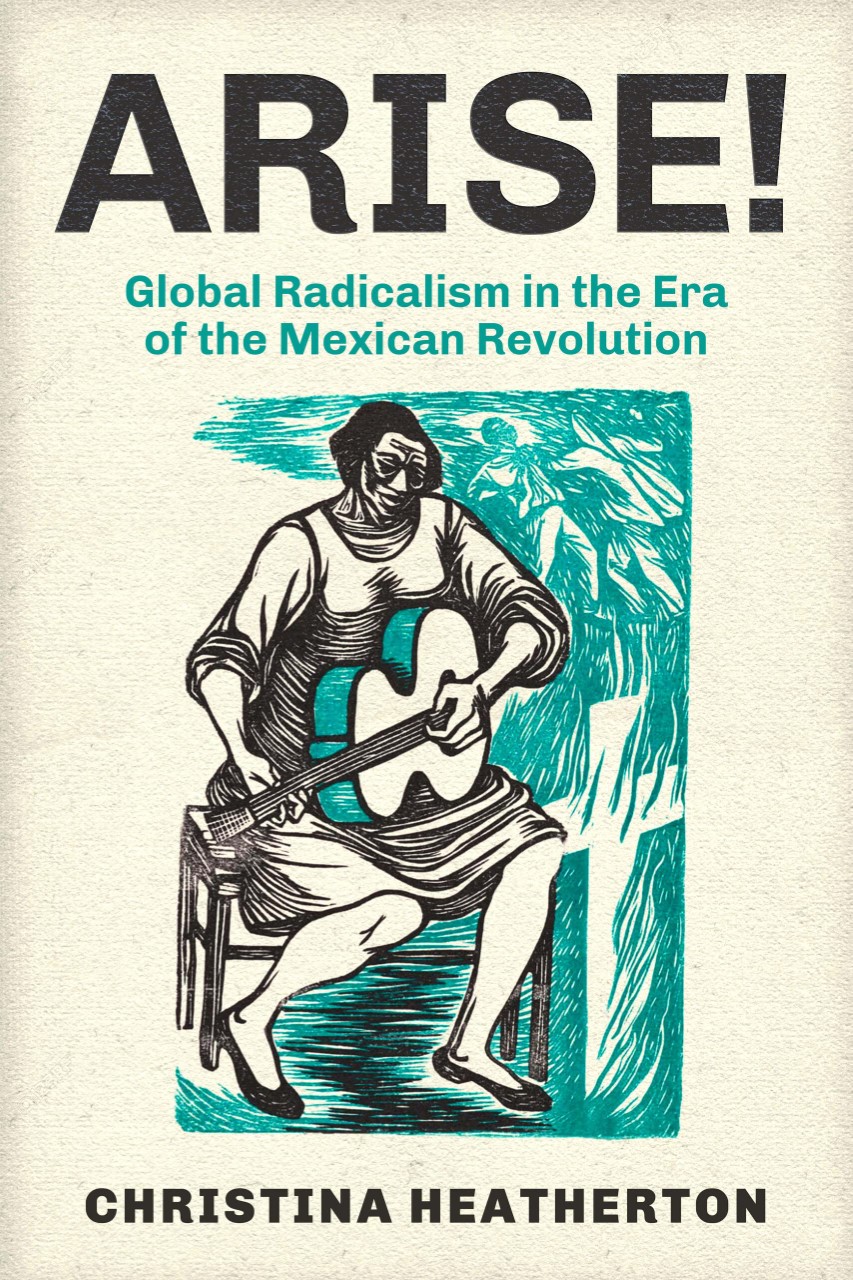Ce texte est tiré d’une communication présentée lors du séminaire « Acteurs et mouvements sociaux », le 1er avril 2021, à Sciences Po Paris, par Selim Nadi, membre de la rédaction du QG décolonial. Son titre entier :
« Autonomie, grève et luttes des travailleurs immigrés : Pour une histoire raciale de l’après « miracle économique » allemand »
N’étant ni un spécialiste des luttes de l’immigration, ni des grèves d’usine – même si ce sont deux sujets qui m’intéressent –, c’est en écrivant ma thèse sur l’histoire transnationale des tiers-mondismes ouest-allemands et français entre le milieu des années 1950 et le milieu des années 1970 que j’ai rencontré ce sujet. Je connaissais quelque peu la question concernant la France, car j’ai un peu travaillé sur le Mouvement des Travailleurs Arabes, mais la question des luttes de l’immigration en l’Allemagne de l’Ouest m’était totalement inconnue au moment où j’ai commencé à m’intéresser un peu au sujet. Ce qui m’a intéressé, c’est la signification des années 1970 dans l’histoire des luttes antiracistes et de l’immigration. Au-delà des luttes outre-Atlantique, on peut penser, concernant la France, au Mouvement des Travailleurs Arabes (MTA), mais également aux grèves des ouvriers maghrébins, sénégalais, maliens, réunionnais, etc. En Grande-Bretagne, il y a eu les différents mouvements des travailleurs originaires des Antilles et d’Asie (comme le fameux Black Star), etc. En Allemagne de l’Ouest, s’il n’y a pas réellement eu de mouvement organisé en tant que tel (comme le MTA ou le Black Star), les années 1960 et le début des années 1970 ont réellement marqué l’éclosion des luttes de l’immigration – surtout dans les usines. Il faut donc prendre la communication d’aujourd’hui pour ce qu’elle est – non pas l’œuvre de plusieurs années de recherche, mais bien plutôt le début de recherches sur la question.
Pour me concentrer sur l’Allemagne donc, il est important de rappeler que la question du racisme était bien évidemment présente dans les deux Allemagnes des années 1960 et 1970 (on pourrait même remonter avant, concernant les Algériens s’étant exilés en RFA pendant la Révolution algérienne). Quinn Slobodian, par exemple, dans son étude sur la question raciale en Allemagne de l’Est, explique que dès sa création, en 1949, la RDA présentait le racisme comme un phénomène appartenant à l’ancienne Allemagne nazie ou à l’Allemagne de l’Ouest – et plus généralement aux pays occidentaux. Le mythe du « chromatisme socialiste[1] » – terme qu’utilise Quinn Slobodian afin de traiter des représentations de la question raciale en RDA, représentations qui mettaient en avant les différences liées à la couleur de peau ou à d’autres caractéristiques physiques – camouflait pourtant une réalité toute différente, bien que le racisme ne s’exprimait sans doute pas de la même façon qu’en RFA.
La question qui m’intéresse aujourd’hui concerne l’Allemagne de l’Ouest (RFA) et plus précisément la condition des immigrés turcs dans la RFA de la première moitié des années 1970 et leur rapport à la gauche radicale – du moins à une partie de celle-ci. Je pense que ce point éclaire assez bien certains enjeux politiques de la période suivant le fameux Wirtschaftswunder (miracle économique). Toutefois, c’est notamment à travers une forme d’action précise que les immigrés turcs prendront le devant de la scène durant ces années : les grèves sauvages[2]. Le caractère « sauvage » de ces grèves n’est pas anodin, puisque celles-ci se font le plus souvent sans organisations de gauche ou syndicats pour encadrer la grève. La grève dont nous allons traiter ici, celle des ouvriers turcs de l’usine Ford de Cologne en 1973, exprime de manière claire les contradictions internes à la classe ouvrière, mais également les difficultés qu’avait alors une partie non négligeable de la gauche ouest-allemande à se saisir des questions auxquelles les travailleurs immigrés donnaient la priorité. A mon sens le cas des luttes des immigrés en Europe occidentale dans les années 1970 est une illustration assez intéressante de la structuration raciale de ce que les opéraïstes italiens nommaient « l’ouvrier-masse » qui, pour reprendre ce qu’en écrit Steve Wright, possédait trois attributs :
- Il était massifié.
- Il accomplissait un travail non qualifié.
- Il était situé au cœur du processus de production immédiat.
« Individuellement interchangeable, mais collectivement indispensable » (Steve Wright), c’est cette condition qui me semble être très bien mise en lumière par les grèves sauvages de la RFA des années 1970.
Avant tout, je voudrais dire que j’utilise le terme « sauvage » par simplicité. Mais c’est un terme qui a été discuté, voire remis en question, par les grévistes eux-mêmes – qui insistaient sur le fait de qualifier leur action de grève. C’est ce qu’écrit Delphine Corteel, dans l’un des rares articles disponibles en français sur la question :
« […] pour les ouvriers de Ford, la question du nom donné à la lutte engagée est un point de bataille qui va devenir essentiel. Les ouvriers revendiquent le nom de « grève » alors que le conseil d’entreprise, organe légal de représentation des salariés dans l’entreprise, refuse d’utiliser ce mot[3]. »
Bien évidemment, je ne voudrais pas donner l’impression que cette grève s’est déroulée dans une sorte de vide politique. Elle s’inscrit non seulement dans une série de grèves sauvages au début des années 1970 ainsi que dans les grèves des années 1960. Dans un premier temps, je voudrais donc évoquer le contexte qui a amené les travailleurs immigrés – ces fameux Gastarbeiter – à se lancer dans des grèves sauvages. Dans un deuxième temps, il me semble important de revenir sur la grève elle-même afin d’en expliquer les enjeux. Je terminerai par évoquer la réception de cet enjeu de l’immigration dans la RFA de l’époque, non seulement par les médias mainstream, mais aussi par toute une partie de la gauche.
Contexte
Avec les accords migratoires (Anwerbeabkommen) de 1955, avec les pays européens, la RFA a ouvert son marché du travail à une main-d’œuvre étrangère. Dès août 1961, la frontière entre la RFA et la RDA a été fermée, mettant fin aux quelques 150 000 à 300 000 travailleurs de l’Est qui venaient travailler à l’Ouest. Ce qui a entraîné d’autres accords migratoires, notamment celui d’octobre 1961, avec la Turquie. Jusqu’en 1973, date à laquelle un frein a été mis à l’immigration (Anwerbestopp), il y a donc toujours eu plus de Gastarbeiter en RFA. En 1961, on comptait, officiellement, 700 000 personnes non allemandes en RFA ; en 1970, ce chiffre s’élevait à presque 3 millions. Bien évidemment, ce que démontre Abdelmalek Sayad (dans L’immigration ou les paradoxes de l’altérité) concernant les travailleurs immigrés en France vaut également pour la RFA : le caractère provisoire de ces Gastarbeiter (littéralement : « travailleurs invités ») n’a été pensé comme provisoire que par la société d’immigration, mais s’est toujours accompagné de l’installation durable des personnes qui ont émigré et de leurs familles.
Guère étonnant, donc, que les travailleurs immigrés aient joué un rôle essentiel dans les grèves sauvages des années 1960 et 1970. C’est là un aspect essentiel à souligner, car, comme l’a brillamment démontré Peter Birke, dans son histoire comparée des grèves sauvages en RFA et au Danemark, l’époque de ce que l’on a appelé « miracle économique » a été imprégnée par les luttes des travailleurs et travailleuses – des luttes pas toujours organisées par des syndicats ou par une organisation centrale. Entre 1955 et 1973, il y a donc eu un nombre grandissant de grèves sauvages et d’arrêts du travail. Birke insiste notamment sur le fait que ces luttes s’inscrivaient dans une opposition à la « paix sociale » entre les patrons, les syndicats et la classe politique ouest-allemande. D’ailleurs, quelques années après la fin de cette période de grèves sauvages, Kurt Steinhaus – qui a été l’élève de Wolfgang Abendroth dans la célèbre école de Marburg et qui faisait partie du SDS – publiait un petit livre sur les grèves des années 1960 et 1970 dans lequel il rappelait que la RFA apparaissait alors souvent, pour les observateurs, comme le cas classique d’une intégration pacifique au capitalisme. Pour illustrer son propos, il compare dans un tableau le nombre de grévistes et les jours de grèves de Grande-Bretagne, de France et de RFA – la RFA arrivant à des chiffres ridiculement bas. Or, Steinhaus se base là sur les chiffres officiels, des grèves légales, délaissant soigneusement, du moins dans ces tableaux, les grèves sauvages de ces années. Birke rappelle d’ailleurs à quel point ces grèves sauvages allaient à l’encontre du schème traditionnel de toute une partie de la gauche partisane et syndicale ouest-allemande – non seulement par leur aspect « spontané », mais également par la participation centrale des immigrés et des femmes – ces acteurs et actrices allaient souvent à l’encontre des directives syndicales, syndicats souvent dominés par les hommes qui avaient des postes qualifiés. Or, ces grèves sauvages ont joué un rôle moteur dans les quelques améliorations obtenues par la classe ouvrière ouest-allemande. C’est là à mon avis, un point essentiel de la recherche historique sur les luttes de la classe ouvrière : la manière dont des luttes spécifiques (ici les luttes de l’immigration) mettent en jeu le sort de l’ensemble de la classe ouvrière. C’est également ce qu’a montré le travail du politiste – spécialiste des luttes ouvrières – Michael Goldfield dans son ouvrage The Southern Key, dans lequel il montre notamment les conséquences de la défaite des luttes antiracistes des années 1930 et 1940 dans le Sud des États-Unis pour l’ensemble des ouvriers.
Pour en revenir à ce qui nous intéresse ici, je souhaitais simplement insister sur le fait que la grève sur laquelle je vais me pencher dans la 2e partie, n’est qu’un cas d’étude d’un ensemble de grèves sauvages qui se sont enclenchées durant la seconde moitié des années 1950 – à une époque où l’économie allemande s’était accélérée et dont le taux de croissance annuel du produit national brut était l’un des plus haut en Europe (6,6 %). Cela impliquait donc une mobilisation accrue de force de travail – y compris des plus vieux et des femmes mariées. Et donc, également d’une main-d’œuvre étrangère. Les grèves sauvages se sont surtout développées autour de la question de la « qualification » des travailleurs – un enjeu profondément marqué par la question raciale. Ainsi, en août 1955, plusieurs grèves locales ont éclaté autour de l’asymétrie d’augmentation de salaire entre ouvriers qualifiés et non qualifiés. La première de ces grèves a été lancée par des ouvriers du chantier naval de l’entreprise publique Howaldtwerke de Hambourg. Sans revenir sur toutes ces grèves, celles-ci n’ont fait que croître tout au long de ces années – autour de questions comme les salaires et le rythme de travail notamment. Dès le début des années 1960, ce sont les travailleurs immigrés qui ont pris l’initiative de plusieurs grèves sauvages – contre leurs mauvaises conditions de travail notamment. Les sanctions et expulsions prises contre ces travailleurs immigrés en grève ont parfois engendré une véritable solidarité avec leurs collègues allemands. Dans son livre sur l’internationalisme et l’antiracisme en RFA entre les années 1960 et 1980, très justement intitulé Vergessene Proteste, Niel Seibert prend, par exemple, le cas de la grève des travailleurs de la métallurgie dans le Baden-Württemberg, en 1963, où les travailleurs immigrés et allemands se sont solidarisés. Mais c’est vraiment à partir des années 1970 que les travailleurs immigrés se sont lancés dans les grèves sauvages. En mai 1973, par exemple, dans l’usine de carrosserie Karmann d’Osnabrück, 1600 travailleurs espagnols et portugais se sont mis en grève pour un rallongement de leurs congés. Cette grève faisait suite au licenciement de 300 Gastarbeiter qui étaient rentrés trop tard de vacances. Cette question des congés sera également centrale dans la grève de 1973 à Ford ces quatre semaines de vacances qui leur étaient accordées ne suffisant pas pour faire le voyage aller-retour dans leur pays natal. Le 16 juillet, 3000 ouvriers immigrés des usines Hella à Lippstadt et Paderborn se sont lancés dans une grève sauvage pour obtenir « 50 pfenning de plus pour tous » après que les ouvriers qualifiés allemands (800 des 2000 ouvriers allemands) aient obtenu une indemnité de 15 pfenning contre l’augmentation de la vie.
Il ne s’agit là que d’exemples de la multitude de grèves sauvages qui ont parsemé l’Allemagne de l’Ouest en 1973. C’est d’ailleurs pour cette raison que je vais m’arrêter un peu plus sur la grève d’août 1973 de l’usine Ford de Cologne. D’une part, l’année 1973 marque un tournant important dans les grèves sauvages en Allemagne de l’Ouest. Manuela Bojadžijev écrit que
« 1973 était sans aucun doute l’année des « grèves sauvages », au total le travail a été abandonné dans environ 335 entreprises […]. Quelques exemples : en mai, chez Karmann à Osnabrück, des ouvriers espagnols et portugais, dont de nombreuses femmes, ont largement arrêté de travailler. […] Une « grève sauvage » chez John Deere, à Mannheim, durant laquelle […] une chasse aux sorcières pogromiques (pogromartige) a été lancée contre les grévistes et lors de laquelle les immigré.e.s ont été accusés d’être des « anarchistes, une foule étrangère, des communistes » […][4]. »
D’autre part, la grève sauvage de l’usine Ford de Cologne est sans doute la grève la plus célèbre de cette époque parmi celles impliquant des immigrés. Enfin, l’année 1973, avec l’arrêt de l’immigration de travail, marque le passage entre deux phases d’accumulation – pour reprendre la distinction faite par Etienne Balibar dans un texte de 1990 :
« Une phase d’accumulation « extensive », dans laquelle les travailleurs immigrés ont été massivement recrutés, mais cantonnés dans certains emplois spécialisés [et] une phase de crise et de chômage, suivie d’une nouvelle accumulation plutôt « intensive », qui réduit au minimum le travail non qualifié dans les industries et les services du « centre »[5]. »
D’où le fait que je revienne, désormais, sur cette grève sauvage de l’usine Ford.
Grève – 24 au 30 août 1973
Le déclencheur de cette grève a été le licenciement sans préavis de 300 travailleurs turcs rentrés trop tard de vacances. Ces ouvriers avaient droit à 4 semaines de vacances durant lesquelles ils retournaient en Turquie afin d’y voir leur famille et leurs proches. Ce qui échappait à la direction pourtant, c’est que les voyages étaient extrêmement longs – parfois jusqu’à deux semaines pour l’aller et le retour, ce qui ne leur laissait plus que deux semaines de véritables vacances. Le seul moment où ces ouvriers turcs pouvaient donc revoir leurs proches se trouvait extrêmement réduit. En août, donc, les ouvriers rentrés avec une semaine de retard perdirent leur travail, ce qui engendra le début d’une grève des ouvriers turcs restant à l’usine Ford – par solidarité, mais également par refus de faire le travail supplémentaire dû au licenciement de leurs collègues. Le 24 août, les ouvriers des chaînes du montage final, à 90 % des ouvriers de nationalité turque, ont refusé d’assumer la charge de travail supplémentaire due au licenciement de leurs collègues et ont cessé le travail. Cette grève dépassa assez rapidement la solidarité initiale avec les ouvriers licenciés afin de mettre en avant d’autres questions de manière plus globale, notamment les conditions de travail et de vie du prolétariat turc en RFA – les Turcs représentant environ 1/3 des travailleurs de l’usine, mais étant assez largement des travailleurs non qualifiés (Hilfsarbeiter). Outre les Turcs, de nombreux Italiens étaient également impliqués dans cette grève. Les revendications étaient : la réintégration de 300 camarades turcs mis à la porte, l’abaissement des cadences et « un mark de plus pour tous à l’heure ».
Ce qui m’a le plus intéressé dans cette grève, c’est l’attitude des ouvriers ouest-allemands face à la solidarité entre leurs collègues turcs. Une semaine avant le début de la grève, alors que les ouvriers turcs restants se solidarisaient avec leurs collègues renvoyés, les ouvriers allemands, eux, dans leur grande majorité ont accepté ces mesures disciplinaires, comme l’écrit Serhat Karakayalt :
« Les licenciements semblaient justifiés aux Allemands, qui, en tant que chef d’équipe, finisseurs (Fertigmacher) ou contremaîtres, occupaient souvent des fonctions supérieures au sein de l’entreprise : eux étaient toujours à l’heure, cela ne devait-il pas être également valable pour les autres ? »
Pourtant, lorsque la grève éclata, quelques ouvriers allemands (pas beaucoup) se mirent également en grève. Karakayalt explique que cette grève se différenciait de la tradition de grève allemande puisque les ouvriers ne faisaient pas grève depuis chez eux, mais que « [l]es Turcs, quelques Italiens et une poignée d’Allemands passèrent leurs nuits dans l’atelier de rembourrage du site Ford et organisaient leur grève depuis cet endroit ». Il s’agissait donc d’une grève assez spontanée qui impliquait aussi une occupation d’usine de fait.
Loin d’être totalement unitaire, le mouvement se scinda rapidement en deux, le syndicat et le conseil d’entreprise organisaient leurs propres manifestations, parvenant à gagner la sympathie de la plupart des ouvriers allemands. Selon Karakayalt, le mercredi 29 août 1973, il n’y avait plus que des apprentis et des travailleurs intérimaires parmi les travailleurs allemands qui soutenaient leurs collègues turcs. La division se faisait donc réellement sur la question de la qualification – un enjeu très largement marqué par la question raciale (voir notamment les travaux des opéraïstes ayant influencé la Sojourner Truth Organization aux États-Unis). Toutefois, cette division se faisait également sur le niveau de syndicalisation des ouvriers turcs par rapport aux Allemands, comme le rappelle une brochure, éditée en septembre 1973 par le groupe spontanéiste Gruppe Arbeiterkampf :
« Selon l’IGM [IG Metall], 80 à 90 % des collègues allemands de Ford sont syndiqués, chez les Turcs ce chiffre passe à 60-70 %. »
Cette brochure rappelle que, dans l’ensemble, y compris chez les ouvriers turcs syndiqués ou organisés politiquement, leur voix ne se faisait guère entendre lors des réunions. Les rapports conflictuels entre syndicats et travailleurs immigrés se faisaient également sentir à la même époque en France. Revenant sur une grève, en 1973, à Renault-Billancourt, René Gallissot, Nadir Boumaza et Ghislaine Clément (Ces migrants qui font le prolétariat) écrivent que : « les revendications égalitaires des OS et la mise à mal des grilles hiérarchiques de classification dérangeaient les organisations syndicales, habituées à négocier les augmentations salariales de façon hiérarchisée, notamment afin de ne pas contrarier leur base française. » (p. 114).
Les réactions à cette grève
La première réaction à noter est celle de la direction. Je trouve que ce qu’en écrit Karl-Heinz Roth est assez parlant, donc je vais simplement le citer (il parle du jeudi 30 août à 7h15) :
« Devant la porte III le chef du personnel Bergemann avait rassemblé la milice patronale au complet, des policiers habillés en ouvriers, des membres du Conseil d’entreprise et de la direction des « hommes de confiance » de l’IG Metall, des cadres moyens de l’entreprise, en tout plusieurs centaines d’hommes. Une banderole et des affiches portant l’inscription « Nous voulons travailler ! » avaient été dressées. Une unité de la police de sécurité du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie avait occupé des positions tactiquement favorables. […] il fallait donner l’impression d’une bagarre de grande envergure entre des travailleurs allemands désirant la reprise et des immigrés qui manifestaient […] Dès que la pseudo contre-manifestation atteignit une position favorable le chef du personnel Bergemann donna le signal : « Messieurs il est temps de combattre. » Combattre, car un seul jour de grève supplémentaire et toute la production d’Europe continentale de Ford se serait effondrée. En quelques minutes la manifestation des grévistes fut attaquée violemment avec des matraques et des instruments distribués aux parasites de Ford. […]
Le premier combat conséquent dirigé contre le travail capitaliste par les ouvriers-masse multinationaux en RFA avait échoué. Une importante vague de licenciements, longuement préparée à partir des listes noires des milices patronales de Ford commença. (p. 149) »
Je reviendrais, à la fin, sur cette notion « d’échec », qui me semble à discuter. Mais l’essentiel était que la grève a été réprimée. Venons-en maintenant aux réactions d’une partie de la gauche.
Serhat Karakayalt précise qu’à l’époque, la majeure partie de la gauche interprétait cette grève comme une tactique de la classe dirigeante pour diviser les ouvriers. Il apparaît donc qu’une large partie de la gauche allemande ne s’intéressait pas tellement aux divisions objectives du prolétariat, ce qui a justement engendré la scission du mouvement. Il est, par ailleurs, important de noter que le peu de cas fait des ouvriers turcs n’était pas qu’une question interne à l’usine Ford de Cologne, mais que c’est également à ce moment que la question de l’immigration turque a commencé à apparaître comme un problème, pour certaines franges de la gauche comme pour une partie de la presse.
Ainsi, fin juillet 1973, un peu moins d’un mois avant la grève de l’usine Ford, le journal Spiegel titrait : « Ghettos en Allemagne. Un million de Turcs ». Dans ce même numéro, on pouvait lire un article intitulé « Les Turcs arrivent, sauve qui peut ». Ce texte revenait sur l’augmentation du nombre d’immigrés turcs en Allemagne de l’Ouest, et les conditions de vie difficiles dans lesquelles ceux-ci vivaient. L’article comparait même, dans son chapeau introductif, la situation ouest-allemande à celle de certains ghettos aux États-Unis :
« Près d’un million de Turcs vivent en République fédérale, 1,2 million attendent chez eux de venir. L’affluence du Bosphore aggrave la crise qui couve depuis longtemps dans les centres urbains submergés d’étrangers. Des villes comme Berlin, Munich ou Francfort n’arrivent plus à gérer l’invasion : des ghettos se forment et les sociologues prophétisent déjà la décomposition des villes (Städteverfall), la criminalité et une plus grande misère sociale, comme à Harlem[6]. »
Quelques mois après, début septembre 1973, après la grève de Ford donc, le même Spiegel faisait sa une sur les grèves sauvages et publiait un texte qui faisait mention d’une nouveauté dans ces grèves : pour la première fois, des Gastarbeiter turcs participaient activement à ces grèves, allant jusqu’à les mener dans certains cas. La différence entre ces deux articles, celui de juillet et celui de septembre, est frappante et, bien que l’on ne puisse limiter l’analyse au Spiegel, le rôle de ces grèves, et notamment celle de Cologne, s’est fait sentir en ce que les travailleurs turcs n’étaient plus cantonnés au rôle de victimes, et de problèmes pour la RFA, mais apparaissent réellement comme des acteurs politiques, ayant des revendications propres et refusant leur situation.
Au-delà de la presse mainstream, certains groupes de la gauche radicale ont également publié des brochures sur cette grève. Nous avons déjà cité le Gruppe Arbeiterkampf, mais il importe également de mentionner le Gruppe Internationale Marxisten (GIM), la section allemande de la IVe Internationale. En effet, le journal du GIM, Was tun, publia une brochure entière sur cette grève. Cette brochure comportait un chapitre entier sur les travailleurs étrangers. Was tun propose ainsi un état des lieux des travailleurs immigrés de l’usine Ford de Cologne qui, dès le début des années 1960 a embauché nombre de travailleurs italiens et espagnols avant d’embaucher massivement des travailleurs turcs, avec le début de l’immigration turque de masse en RFA, à quoi se rajoutés, par la suite, des travailleurs yougoslaves. La brochure propose ainsi de revenir sur les conditions de vie de ces travailleurs, insistant notamment sur le fait que « [l]a majeure partie des contremaîtres allemands traite souvent les étrangers comme des sous-hommes[7] ». Cette brochure est extrêmement intéressante, car elle démontre une attention réelle portée aux divisions entre travailleurs allemands et étrangers :
« La situation est aujourd’hui plus que sérieuse. Il existe un fossé énorme entre les Allemands et les étrangers. Pendant toute la grève, ce fossé s’est approfondi heure par heure […]. Durant les derniers jours, la grève était réellement une « grève de Turcs »[8]. »
Une brochure du Gruppe Arbeiterkampf, éditée par les « éditions Rosa Luxemburg de Cologne », concluait sa brochure sur la grève de Cologne sur la scission du mouvement et sur la nécessité de mettre en avant le fait qu’une telle division était également néfaste pour les ouvriers allemands – qui devaient donc également s’opposer à la discrimination de leurs collègues turcs[9]. Cette expérience semble avoir été un apprentissage important pour une partie du mouvement ouvrier ouest-allemand de l’époque. C’est, entre autres, à cause de cette division interne au mouvement que cette grève peut être considérée comme un échec. Échec relatif puisque s’il est vrai que les revendications des travailleurs immigrés n’ont pas été entendues, leurs conditions de vie restant assez largement lamentables au cours des années 1980[10], leur rôle politique, lui, a très clairement été mis en lumière.
Conclusion
Si la grève de l’usine Ford de Cologne de 1973 est loin d’être une exception à cette époque, elle apparaît comme un épisode crucial de l’histoire de la lutte des classes en République fédérale allemande – ainsi qu’un point essentiel dans l’évolution de la question raciale outre-Rhin. De plus, si nous avons principalement traité de la question des ouvriers immigrés ici, il faut tout de même mentionner que cette année 1973 n’a pas seulement vue des grèves masculines, mais aussi certaines mobilisations d’ouvrières immigrées, comme à l’usine Neusser Vergaserfabrik de Pierburg par exemple[11]. Ces diverses expériences s’inscrivaient ainsi dans des mutations importantes quant à la composition de classe en Europe occidentale, ainsi qu’aux thématiques mises en avant dans les luttes sociales, durant les années 1970.
[1] SLOBODIAN, Quinn. « Socialist Chromatism: Race, Racism, and the Racial Rainbow in East Germany ». Comrades of Color : East Germany in the Cold War World, Berghahn Books, New-York, 2015, p. 23-39.
[2] Sur les grèves sauvages en Allemagne de l’Ouest et au Danemark, voir : BIRKE, Peter. Wilde Streiks im Wirtschaftswunder: Arbeitskämpfe, Gewerkschaften und soziale Bewegungen in der Bundessrepublik und Dänemark. Francfort, Campus verlag, 2007.
[3] Delphine Corteel, « 24-30 août 1973 : grève ouvrière à l’usine Ford de Cologne », in Jacqueline Costa-Lascoux et al., Renault sur Seine, La Découverte, Paris, 2007, p. 175.
[4] BOJADŽIJEV, Manuela. Die windige Internationale. Rassismus und Kämpfe der Migration. Münster : Westfälisches Dampfbot, 2012. p. 156
[5] Etienne Balibar, « ‘Es gibt keinene Staat in Europa’’ : racisme et politique dans l’Europe d’aujourd’hui » in Etienne Balibar, Les frontières de la démocratie, La Découverte, Paris, 1992, p. 183.
[6] « Die Türken kommen – rette sich, wer kann ». Der Spiegel, 30 juillet 1973, n°31, p. 24.
[7] « Der Streik bei Ford, vom 24.8.-30.8.1973 ». Was tun. Sonderdruck, 1973. p. 32.
[8] Ibid. p. 33.
[9] Betriebszelle Ford der Gruppe Arbeiterkampf. Streik bei Ford Köln. Cologne : Rosa Luxemburg Verlag, 1973. p. 208.
[10] Voir : WALLRAFF, Günter. Tête de Turc. Paris : La Découverte, 2013.
[11] Voir : ENGELSCHALL, Titus. « ‘’The Immigrant Strikes Back’’. Spuren migrantischen Widerstand in den 60/70er Jahren » WALLRAFF, Günter. Tête de Turc. Paris : La Découverte, 2013.p. 43-54. On peut également se référer à BRAEG, Dieter (dir.). Wilder Streik – das ist Revolution: Der Streik der Arbeiterinnen bei Pierburg in Neuss 1973. Berlin : Die Buchmacherei, 2012.
Selim Nadi