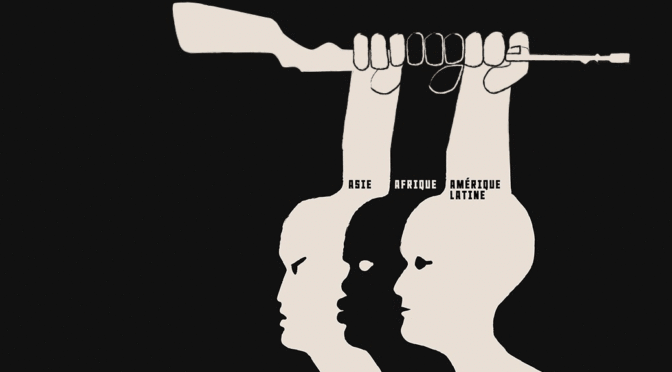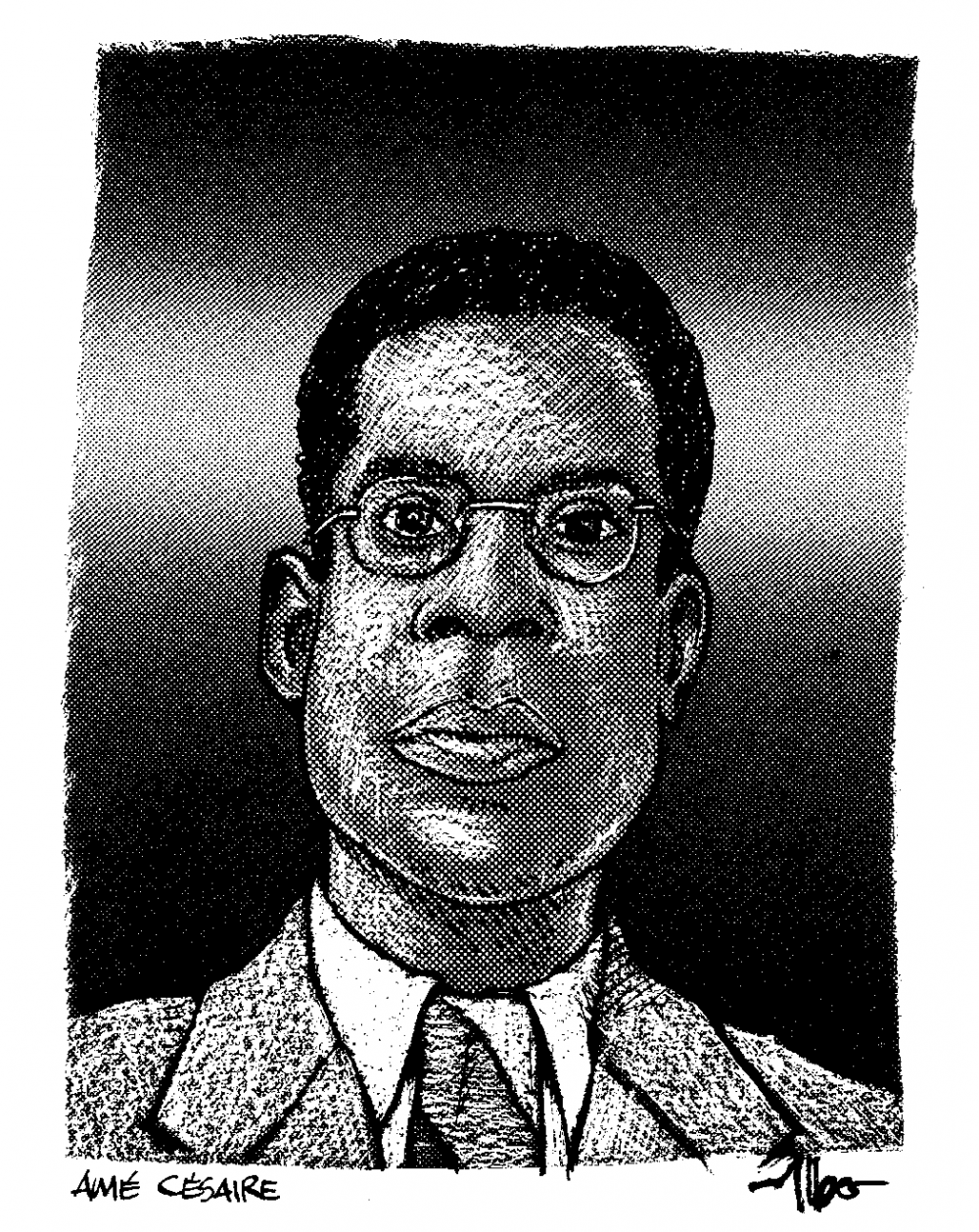La visite annulée de Jean Castex à Alger révèle la nouvelle détérioration des relations entre l’Algérie et la France après celle de juin 2020. Pourtant cette délégation devait, en plus du 1er ministre, comprendre le ministre des Affaires étrangères et celui de l’Économie et des Finances, preuve que Paris était prêt « à mettre le paquet » concernant la mise en œuvre d’un « nouveau partenariat » attendu depuis 3 ans. La presse française, unanime, revient sur le long feuilleton des relations agitées entre ces deux pays. Les uns et les autres de rappeler les sujets de discorde habituels parmi lesquels la question de l’immigration clandestine ou la position française par rapport à la question du conflit au Sahara occidental…Certains médias évoquent, quant à eux, la raison qui semble avoir été le véritable déclencheur de cette crise : la décision du parti d’Emmanuel Macron (LREM) d’ouvrir une représentation à Dakhla – une sorte de consulat français – dans les territoires sahraouis ce qui équivaut à une prise de position claire et sans ambages pour la partie marocaine du conflit. Tout cela s’ajoute aux déclarations de Le Drian qui s’est récemment dit favorable au plan d’autonomie marocain, en opposition frontale au règlement adopté par l’ONU, préconisé par la capitale algérienne : à savoir une consultation d’autodétermination sous égide internationale.
Bien sûr, on peut s’interroger sur l’opportunité d’ouvrir une représentation de LREM dans ces territoires juste au moment où sur le terrain les combats sont relancés. De plus on imagine mal à qui est destiné ce bureau de LREM en plein Sahara. Algéria Watch nous apprend que le député communiste Jean-Paul Lecoq a qualifié de « honte » l’ouverture de ce comité local et a accusé Macron lui-même d’être à l’origine de cette décision. En effet, il serait inconcevable de penser que le chef de l’Etat n’ait pas été consulté. On penche donc volontiers pour une politique parfaitement assumée, ce qui témoigne d’une grande confusion au niveau de l’exécutif français. D’un côté, il veut rétablir de nouvelles relations avec l’Algérie et de l’autre il adopte pleinement le point de vue la monarchie chérifienne sur le Sahara occidental.
Cependant un autre motif de brouille est aussi relevé par la presse des deux pays : la fameuse question mémorielle. Les « efforts » de Macron sur ce dossier semblent encore bien insuffisants au regard de ce qui est attendu de l’autre côté de la Méditerranée, à savoir non pas une repentance mais une reconnaissance en pleine et due forme des crimes de la colonisation. Les préconisations du fameux rapport Stora, ne convainquent pas, à juste raison. Pas plus que les « gestes » symboliques comme la restitution des corps de résistants algériens à la colonisation. Pour beaucoup on est encore loin du compte.
Il faut savoir qu’une reconnaissance pleine et entière de la responsabilité française pour une liste de crimes grosse comme le Ritz, ouvrirait la voie à de possibles poursuites devant des juridictions internationales. La France dans cette perspective aurait beau brandir la clause des accords d’Evian signés par les deux parties qui soldent les comptes de cette guerre y compris au plan judiciaire, la juridiction internationale concernant d’éventuels crimes contre l’humanité (par exemple l’utilisation de napalm contre des civils, les tristement célèbres « camps de regroupement », le massacre du 17 octobre 1961 ou encore la nucléarisation du Sahara au détriment des populations nomades) s’imposerait sur tout accord bilatéral antérieur. D’autant que la qualification de certains de ces crimes empêche toute prescription. Par ailleurs, circonstance aggravante, à la différence de la responsabilité française dans la déportation des Juifs de France commise par la dictature crypto- fasciste pétainiste, les crimes français en Algérie furent perpétrés sous deux républiques en plein exercice démocratique. Ce qui implique directement l’Etat français dans sa continuité actuelle.
C’est pourquoi, on a du mal à comprendre que cette question de la reconnaissance française dans ce long massacre de huit ans (de 132 ans disent certains) ne soit utilisée que comme une variable d’ajustement, par le gouvernement algérien, dans les crises successives entre les deux pays. Ce qui en dit long sur la manière dont l’histoire coloniale, l’indépendance et le sentiment national sont instrumentalisés par le pouvoir en place.
Tout comme on a du mal à comprendre que le gouvernement français, ne considère ce « conflit mémoriel », que comme un sujet de politique extérieure. Compte tenu du nombre très élevé d’Algériens et de bi-nationaux et du nombre important de populations directement issues des colonies françaises vivant dans l’hexagone, il s’agit bel et bien d’une question intérieure. Si l’on ajoute à cela les conflits idéologiques de haute intensité qui déchirent le pays : le triomphe des idées d’extrême droite d’un côté et les progrès de la conscience décoloniale de l’autre, il serait naïf voire inconscient de ne voir ces questions que sous l’angle des intérêts diplomatiques.
Heureusement, les hiraks marocains et algériens sont la pour nous rappeler, malgré les féroces répressions dont ils sont l’objet, qu’ils ne sont dupes ni de leur régime respectif, ni du rôle de l’ancienne et actuelle puissance coloniale. Quant à nous, anticolonialistes de France, il est temps de comprendre que la politique extérieure de la France n’est pas que l’affaire du pouvoir régalien. Elles nous concernent autant sinon plus.